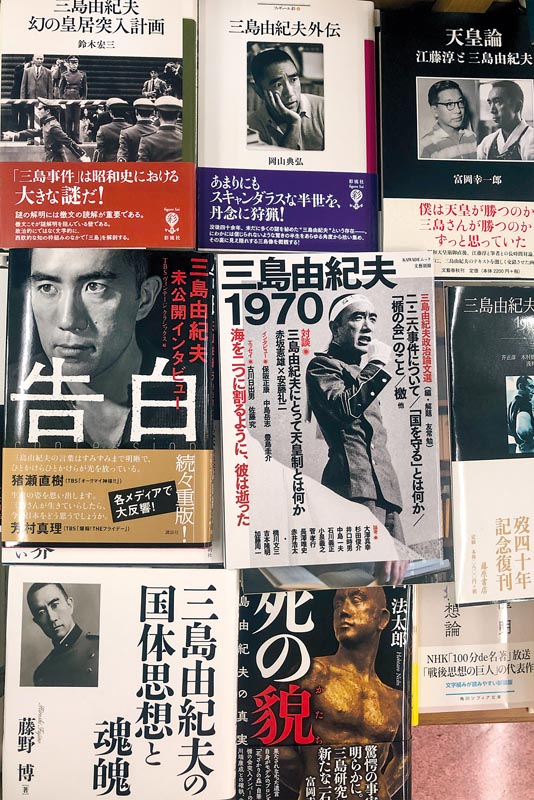
Eric Rechsteiner pour Zoom Japon Admirateur de l’œuvre de Mishima, le romancier Hirano Keiichirô en est aussi l’un des meilleurs spécialistes. Hirano Keiichirô, l’un des plus jeunes lauréats du prestigieux prix littéraire Akutagawa, affirme qu'il ne serait pas romancier sans sa rencontre avec l’œuvre de Mishima Yukio. Il est né en 1975, à une époque où les gens se souvenaient encore bien des circonstances dans lesquelles l’écrivain avait mis fin à sa vie. A l’école primaire, son instituteur avait évoqué l’existence d’un étrange écrivain nommé Mishima, qui s’était introduit au quartier général des forces d'autodéfense et avait commis un seppuku ou suicide rituel. Cette histoire a laissé une forte impression sur le jeune Hirano. Au collège, il a commencé à lire les chefs-d’œuvre de la littérature japonaise moderne, les uns après les autres, jusqu’à ce qu’il découvre, à 14 ans, Le Pavillon d’or. Il a tellement été absorbé par ce roman qu’il en a même oublié de manger et de dormir. Depuis, il est devenu un expert de tout ce qui concerne Mishima auquel il a consacré plusieurs essais. Vous faites partie des 13 personnes interviewées dans le documentaire de Toyoshima Keisuke, Mishima Yukio vs. Tôdai Zenkyôtô, 50 nenme no shinjitsu. Je dois avouer que j'ai trouvé le débat plus amical que je ne le pensais.Hirano Keiichirô : Même si le débat a été annoncé, de façon plutôt sensationnelle comme un match entre l’écrivain et le Zenkyôtô, la plupart des personnes qui ont assisté à l'événement du 13 mai 1969 étaient de simples étudiants. Ils étaient probablement en admiration devant Mishima, ou tout simplement nerveux et excités d’avoir la chance de le voir sur scène. Quant aux divergences apparemment irréconciliables entre les deux camps, il est vrai que Mishima voulait rendre son caractère sacré et sa dignité à l’empereur, mais il était également très critique à l’égard du Japon d'après-guerre. Il estimait que la nouvelle Constitution appliquée par les Etats-Unis avait dégradé le pays. En ce sens, il s’est montré compatissant avec les étudiants. Dans une certaine mesure, leurs idées étaient plus proches qu’on ne pourrait le penser. En outre, le rival de Mishima était peut-être le puissant Zenkyôtô, mais en fin de compte, les étudiants sont des étudiants. En ce qui concerne l’âge, Mishima aurait pu être leur père, et dans les images du débat, on peut voir que, sans être condescendant, il se montre doux avec eux alors que les étudiants, eux, lui témoignent un grand respect. Il se trouve que j’ai 45 ans maintenant – le même âge que lui quand il est mort – et je parle souvent aux jeunes, donc je peux m’identifier à son approche. Beaucoup de gens ont fait remarquer que le Mishima qui a rencontré les étudiants en 1969 et celui qui s’est suicidé un an plus tard étaient très différents. Cependant, vous ne semblez pas voir de contradiction entre les deux.H. K. : La personnalité de Mishima était extrêmement difficile à cerner. Il aimait dire et faire des choses contradictoires, confondre son public. J’ai eu l’occasion de parler à de nombreuses personnes qui l’ont connu de son vivant comme le graphiste Yokoo Tadanori (voir Zoom Japon n°79, avril 2018), le chanteur et acteur Miwa Akihiro ou encore l’homme politique de droite Suzuki Kunio. Chacun d’entre eux voit en lui une personne différente, un personnage différent, le seul trait commun étant qu’il le trouvait immensément charmant. Si vous avez cela à l’esprit, il est plus facile de comprendre son comportement de gentleman pendant le débat. Ce numéro de Zoom Japon se concentre sur la vie et l’œuvre de Mishima dans les années 1960, lorsque ses idées politiques ont pris le dessus. Cependant, il n’est pas facile de les séparer des dernières années de la première partie de sa vie.H. K. : Le passé de Mishima est certainement important pour approcher la vraie nature de son personnage. Par exemple, le fait qu’il soit devenu plus tard un culturiste passionné peut être relié à son enfance, lorsqu’il était un garçon malade et maigre. Et puis, il y a son expérience de la guerre. Entre 1931 et 1945, le Japon était en guerre. Cela signifie que Mishima, qui est né en 1925, a grandi dans cette atmosphère particulière. Il rêvait de se battre, et même de mourir, pour son pays. Puis, en 1944, à 19 ans, il a reçu un avis de conscription, mais il a été déclaré inapte au service militaire. Il est resté à la maison et a survécu alors que de nombreux garçons du même âge sont morts à la guerre. Je pense que l’expérience d’avoir été étiqueté par la nation comme “malade” et “inutile” a eu un impact énorme sur sa vie. Vous voulez dire qu’il s'est senti coupable de ne pas être allé à la guerre ?H. K. : Je pense qu’il s’est surtout senti “coupable d’être un survivant”, étant l’un des rares chanceux à avoir survécu quand beaucoup de ses amis et camarades de classe sont morts à la guerre. Vous devez comprendre que pour beaucoup, probablement la majorité des Japonais, la guerre du Pacifique était une guerre juste. Lorsque le Japon s’est emparé de la Mandchourie en 1931 et a ensuite envahi la Chine en 1937, nombreux sont ceux qui ont critiqué le gouvernement pour ce qui était considéré comme une guerre d’agression. Mais lorsque le Japon a attaqué Pearl Harbor en 1941, l’opinion générale était que le pays avait été forcé de lutter contre une puissance impérialiste. Tout d’un coup, la guerre est devenue une bonne chose et, surtout, le Japon a commencé à être considéré comme une victime et non comme un agresseur. Mishima partageait cette opinion. En fait, on ne trouve pratiquement aucune référence à la Chine dans ses écrits. En revanche, il n’a cessé d’être fasciné par l’héroïsme des soldats japonais, en particulier les kamikazes. Comment son expérience de la guerre a-t-elle affecté sa vie ultérieure ?H. K. : L’élément autobiographique se retrouve dans nombre de ses œuvres, à commencer par son roman révolutionnaire Confessions d’un masque, dont le protagoniste, comme Mishima, n’a pas fait la guerre. Ce qui préoccupe le héros, c’est qu’en tant que survivant, il doit utiliser son temps de manière satisfaisante et significative. C’est ce qu’il a lui-même ressenti à l’époque. Le problème était que le débat politique et social de l’après-guerre était monopolisé, une fois de plus, par ceux qui avaient eu une expérience directe des combats. Le romancier Ôoka Shôhei, par exemple,...
