
Le 25 novembre 1970, l’écrivain se donnait la mort de façon spectaculaire. Nous revenons sur ses dernières années.
La vie de Mishima Yukio peut être divisée en deux périodes, toutes deux caractérisées par la violence, la mort et les bouleversements politiques. Nous avons voulu nous concentrer sur la seconde moitié de sa vie, en particulier ses dix dernières années, et sur ses relations avec les mouvements les plus conservateurs.
Alors que l’agitation des années 1960 est généralement associée aux manifestations étudiantes de gauche et aux grèves ouvrières, le Japon fourmillait également de groupes ultra-nationalistes. Un rapport de police de 1956 recensait 95 groupes d’extrême droite, comptant au total 67 000 membres. La mobilisation contre le renouvellement du Traité de sécurité nippo-américain en 1960 a été le catalyseur de la formation de nouveaux groupes, si bien qu’en 1962, on en recensait 400, avec 100 000 membres. Les biographes et les commentateurs s’accordent à dire que 1960 fut une année cruciale dans la vie de l’écrivain, car elle a marqué un tournant majeur dans sa carrière. Il était obsédé par les manifestations contre le Traité de sécurité. Bien qu’il n’y ait jamais participé, il a suivi la couverture médiatique des affrontements quotidiens entre les manifestants, la police et les groupes d’extrême droite renforcés par les yakuzas, allant jusqu’à conserver des coupures de presse.
A ce moment-là, Mishima Yukio, chouchou des médias, était un écrivain célèbre et avait été pressenti pour le prix Nobel de littérature. Cependant, il n’avait rien écrit de spécifiquement politique jusqu’en juin 1960, lorsque l’un des principaux quotidiens nationaux, le Mainichi Shimbun, publia un article dans lequel il louait l’agitation, mais d’un point de vue nationaliste, comme un exemple de la façon dont les Japonais rejetaient le contrôle américain du pays.
Ce papier a inauguré une nouvelle phase dans sa vie où il a exprimé son conservatisme sur la politique et l’état de la société japonaise. Il a atteint un premier sommet avec la publication, en décembre 1960, de la nouvelle Patriotisme (Yûkoku in Dojoji et autres nouvelles, trad. de l’anglais par Dominique Aury, Gallimard, coll. Folio, 2002). Selon Nick Kapur, auteur de Japan at the Crossroads: Conflict and Compromise after Anpo (Harvard University Press, 2018, inédit en français), ces événements “ont éveillé chez lui une compréhension de la puissance du spectacle, et cette compréhension sera une force directrice dans les futurs écrits et son comportement public de la décennie suivante, jusqu’à sa mort spectaculaire, le 25 novembre 1970.”
La droite japonaise a dû se rendre compte de la même chose lorsqu’elle a soudainement cessé de théoriser et est passée à l’action avec une série d’attaques violentes contre des militants et des politiciens de gauche. Le 17 juin 1960, par exemple, Kawakami Jôtarô, un des leaders de l’opposition, fut blessé lors d’une attaque au couteau, et le 12 octobre, le président du Parti socialiste Asanuma Inejirô a été poignardé à mort lors d’un débat électoral à la télévision nationale par Yamaguchi Otoya, un jeune de 17 ans. Il est à noter qu’après son arrestation, celui-ci s’est pendu après avoir écrit sur le mur de sa cellule “Shichisei hôkoku” (Autant de fois que je reviendrai dans ce monde, je donnerai ma vie à mon pays.), les célèbres dernières paroles d’un samouraï du Moyen-Âge et la même devise figurant sur le bandeau de Mishima lorsqu’il s’est suicidé.
“A cette époque, ses idées l’ont amené à se brouiller avec ses collaborateurs de longue date au théâtre, les Bungaku-za, à propos de sa pièce Yorokobi no koto [La harpe de joie, 1964], concernant un complot terroriste et l’infiltration de la police par un communiste radical. De nombreux membres de la troupe étaient des sympathisants de la Chine maoïste et ont refusé de monter la pièce sans ajustements. Dégoûté par la remise en question de sa liberté d’expression, il a définitivement coupé les ponts avec le groupe”, explique son biographe Damian Flanagan (Yukio Mishima, coll. Critical lives, éd. Reaktion Books, 2015, inédit en France). Plus surprenant encore, il avait également des relations assez difficiles avec des groupes ultra-nationalistes. “Dans son roman de 1960, Après le banquet (Utage no ato, trad. Gaston Renondeau, Gallimard, coll. Folio, 1979), il a dressé un portrait peu flatteur d’un homme politique de droite existant. Il est devenu la cible d’une affaire d’atteinte à la vie privée qui a duré des années et qui a été mentalement épuisante. Pendant ce temps, il s’est brouillé avec les autres artistes de sa coterie littéraire, Hachi no kikai [Le cercle de l’arbre en pot], lorsque l’écrivain Yoshida Ken’ichi, fils de l’ancien Premier ministre Yoshida Shigeru, ne l’a pas soutenu lors de la controverse liée à son roman”, ajoute-t-il.

Au printemps 1961, Mishima Yukio a fait l’objet de menaces de mort de la part de l’extrême droite. Tout a commencé à l’automne précédent, lorsque la revue mensuelle Chûô Kôron a fait paraître Fûryû mutan [Un rêve élégant] de Fukazawa Shichirô, une satire historique évoquant une révolution de gauche qui se termine par la décapitation de la famille impériale. La réaction des groupes ultra-nationalistes a été telle que non seulement l’auteur mais aussi de nombreux autres écrivains et critiques de gauche qui avaient pris son parti ont dû se cacher. Quant à Mishima, il a été visé par des menaces de mort lorsqu’une rumeur évoquant son intervention personnelle en faveur de la publication de la nouvelle s’est répandue. Dans les jours qui ont suivi, des voyous ont commencé à repérer sa maison en vue d’éventuelles attaques, et on dit qu’il a patrouillé son jardin toutes les nuits pendant des semaines, armé d’un sabre de samouraï, pour se protéger.
“Pour beaucoup de gens de moindre importance, toutes ces histoires auraient été écrasantes, mais Mishima Yukio a continué, constamment, à expérimenter ingénieusement de nouvelles formes littéraires. En effet, ce qui me frappe le plus dans la dernière période de sa vie, c’est son éthique de travail implacable. Il a non seulement construit ce chef-d’œuvre de haute littérature qu’est La Mer de la fertilité (Hôjô no umi, trad. de l’anglais par Tanguy Kenec’hdu, Gallimard, coll. Quatro, 2007) mais aussi un grand nombre de pièces fascinantes – dans les styles occidental et Kabuki – ainsi que des romans psychédéliques comme [Vie à vendre] (Inochi urimasu, trad. Dominique Palmé, Gallimard, coll. Du monde entier, 2020), ainsi qu’un flot apparemment sans fin de commentaires culturels et historiques, de critiques littéraires et de romans destinés au marché féminin. Sa productivité a été tout à fait étonnante, jusqu’à son dernier jour”, poursuit Damian Flanagan.
L’écrivain a dit un jour : “Je suis sûr que mes actes sont plus difficiles à comprendre que mes romans.” C’est pourquoi certains séparent sa littérature de ses pensées et de ses actions politiques. Son biographe estime que toutes ses œuvres littéraires sont indépendantes, construites autour d’un mélange dense d’influences allant des tragédies grecques aux romans de l’époque Heian (794-1185) en passant par ceux de Raymond Radiguet et George Bataille, ce qui signifie que l’on pourrait discuter sa relation avec la littérature et les idées du monde entier. “Cependant, il est également vrai qu’il était un individu tellement fascinant, et que sa vie était si évolutive et dramatique, qu’inévitablement chacune de ses œuvres littéraires est une sorte de puzzle. Bien sûr, il n’y avait pas qu’“un” Mishima. Il a toujours évolué en tant que penseur et personne, apparemment sans intérêt pour la politique avant de donner sa vie pour ses nouvelles convictions politiques en 1970. C’était un homme extrêmement complexe et il a manifesté cette personnalité de tant de manières différentes qu’il n’y a finalement pas moyen d’aller au fond de ses livres ou de sa vie”, estime Damian Flanagan.
Selon lui, il existe toujours un lien dans les œuvres de l’auteur entre la politique, l’esthétique et les questions existentielles. “Dans ses premières œuvres, des années 1950, les idées politiques sont plus latentes, suggérées plutôt qu’ouvertement exprimées. Les idées sur la beauté et l’identité occupent le devant de la scène. Dans Le Pavillon d’or (Kinkaku-ji, trad. Marc Mécréant, Gallimard, coll. Folio, 1975), par exemple, on peut voir le temple comme une vision transcendante et indestructible de la beauté, mais on peut aussi le lire politiquement comme un symbole de l’empereur lui-même, comme quelque chose d’élémentaire, de sacré et d’indestructible dans la culture japonaise. Lorsque les personnages de la maison de Kyôto traversent tous des crises existentielles, ils cherchent à confirmer leur identité par différents moyens : par des fantasmes sado-masochistes, par l’art et par la politique de droite. Mishima lui-même, à ce moment-là, était beaucoup plus intéressé par l’esthétique que par la politique. En fait, on pourrait dire avec plus de justesse qu’il était plus intéressé par le potentiel esthétique de la politique. Dans sa nouvelle de 1961, Patriotisme, la toile de fond est l’échec des jeunes officiers de l’armée en février 1936 qui voulaient dissiper les nuages – des politiciens et des industriels corrompus – qui obstruaient la lumière du soleil impérial. Pourtant, ce n’est pas l’arrière-plan politique qui l’intéressait : il s’agissait simplement d’un moyen pour mettre en scène une scène de sexe et de suicide stylisés”, analyse son biographe. “Il voulait parvenir à cette fin dramatique et magnifique pour lui-même et il s’est rendu compte de plus en plus qu’il avait besoin de la politique pour donner à sa fin un certain pouvoir et un sens. Son dernier jour a été plus un coup de théâtre soigneusement mis en scène qu’une tentative de coup d’Etat. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que la situation politique des années précédentes qui avaient fait de lui un militant de droite, n’avait aucune signification. Une fois qu’il a réalisé la nécessité d’en finir avec la politique de manière magnifique, il s’est jeté de tout cœur dans l’examen des questions politiques”.
La fin des années 1960 a été marquée par la guerre du Vietnam, la Révolution culturelle en Chine et l’agitation des étudiants dans le monde entier. Il y avait un sentiment palpable de troubles sociaux et politiques, un réel sentiment que les institutions de longue date allaient s’effondrer et qu’un nouveau monde – bon ou mauvais – était en train de naître. “Mishima se place au milieu de ce maelström, rêvant d’être abattu par des insurgés communistes dans le cadre d’une garde prétorienne défendant l’empereur, tout en imaginant dans un roman comme Chevaux échappés (Honba in La Mer de la fertilité, trad. de l’anglais par Tanguy Kenec’hdu, Gallimard, coll. Folio, 1980) ce qu’il aurait ressenti en tant qu’extrémiste de droite dans les années 1930. Il a commencé à imiter consciemment les officiers insurgés de la rébellion de février 1936. Il a rêvé de mourir lors des émeutes d’octobre 1969 contre la guerre du Vietnam et a ressenti une déception lorsqu’elles ont été facilement réprimées par la police, ce qui lui a laissé le loisir de trouver un autre stratagème pour organiser sa propre mort. Et pourtant, pendant tout ce temps, il a pu se détacher froidement des tumultes politiques et écrire des œuvres non politiques”, note Damian Flanagan.
Son patriotisme a pris un nouveau tour lorsqu’il a rassemblé entre 80 et 100 étudiants de droite et a formé sa milice privée. Au début, elle s’appelait Armée de défense nationale, mais il en a ensuite changé le nom pour celui de Tate no Kai (La Société du bouclier). Son but avoué était de s’opposer au communisme, de maintenir l’esprit national et de défendre l’empereur. “J’ai particulièrement visé les étudiants des universités où le conflit ou le traumatisme s’était produit”, avait déclaré l’écrivain dans une interview donnée dans un assez bon anglais. “Une telle minorité d’étudiants ne pouvant pas être impliquée dans le mouvement de gauche s’est sentie très isolée. Dans un certain sens, ils avaient foi dans leur propre Japon et dans l’esprit japonais, mais le mouvement étudiant de gauche les a complètement niés. Dans la presse, La Société du bouclier était souvent présentée comme un groupe de petits soldats habillés en uniforme de groom. Mishima avait dépensé une petite fortune pour ces uniformes, conçus spécialement par Igarashi Tsukumo qui avait dessiné des uniformes pour le général de Gaulle”, rappelle son biographe.
Sa milice avait
même son propre hymne :
Les jeunes guerriers samouraïs se sont levés et ont vécu leur renaissance
La lumière de l’aube brille sur nos joues
Rouge comme le soleil levant sur notre drapeau de la grande vérité
Marcher courageusement Tate no Kai
Son groupe a peut-être été ridiculisé par les médias et l’opinion publique, mais une grande partie de l’establishment politique et militaire avait des sentiments beaucoup plus chaleureux à son égard. “De nombreux hommes politiques et membres du gouvernement issus du Parti libéral-démocrate ont eu des réunions avec lui et sa milice. Il a même été discrètement encouragé par des fonctionnaires de haut rang à se présenter aux élections”, rappelle Damian Flanagan. Parmi les personnalités rencontrées, figurait Nakasone Yasuhiro, qui devait devenir ministre de la Défense en 1970 et Premier ministre en 1982. Il a également rencontré Satô Eisaku, qui était alors chef du gouvernement. Il a obtenu le soutien des deux hommes. Nakasone lui présente un officier supérieur des forces armées, et Satô, chose incroyable, lui a donné de l’argent en provenance d’hommes d’affaires de droite. Finalement, Mishima s’est brouillé avec le premier car il voulait que le Japon possède l’arme nucléaire alors que Nakasone ne voulait pas aller aussi loin. Entre-temps, les militaires japonais ont accueilli la Tate no Kai à bras ouverts, ce qui lui a permis de s’entraîner régulièrement aux côtés des forces régulières. “En effet, le jour de sa mort, une petite délégation de cinq hommes de la Tate no Kai a pu prendre un général en otage au quartier général des forces d’autodéfense parce que Mishima s’était arrangé pour le rencontrer dans son bureau afin de lui présenter quelques recrues prometteuses de la Tate no Kai”, raconte son biographe.
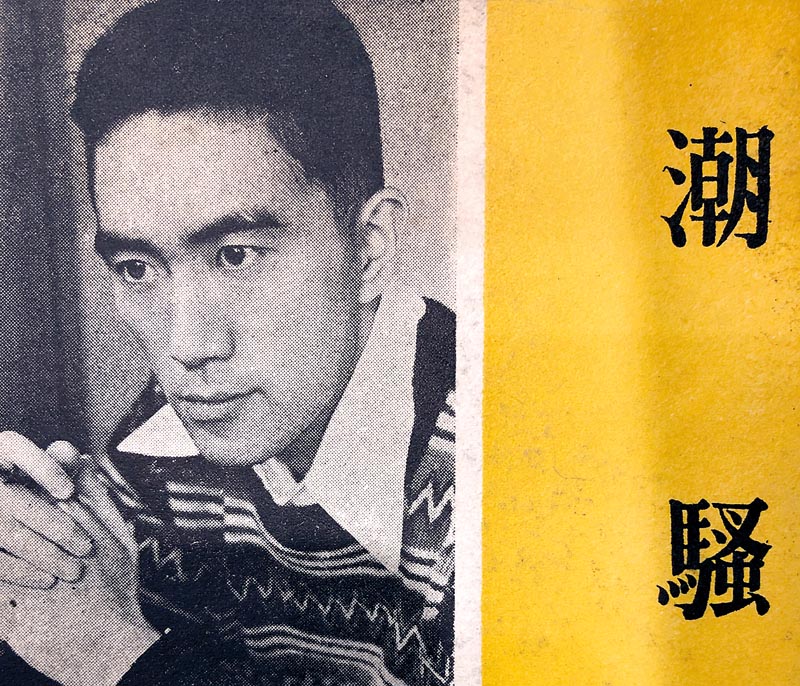
“Pas de manifestations de rue pour nous ; pas de pancartes ; pas de cocktails Molotov ; pas de conférences ; pas de jets de pierres. Jusqu’au dernier moment, nous refuserons de nous engager dans l’action car nous sommes l’armée la moins armée mais la plus spirituelle du monde. Certaines personnes se moquent de nous en nous appelant des petits soldats. Nous verrons bien”, a déclaré Mishima à propos de sa milice.
Finalement, le jour de sa mort, l’écrivain a été impitoyablement raillé par les membres des forces d’autodéfense qui s’étaient rassemblées pour écouter son discours, et pendant de nombreuses années, le reste du pays a essayé de l’oublier. Cependant, selon Damian Flanagan, il reste l’un des géants de la littérature japonaise moderne et jouit toujours d’une forte connexion avec la jeunesse actuelle. “Au cours des 150 années qui se sont écoulées depuis l’entrée du Japon dans le monde moderne avec la restauration Meiji de 1868, deux écrivains d’une capacité naturelle exceptionnelle se sont distingués par leur tête et leurs épaules : Natsume Sôseki et Mishima Yukio. Si vous deviez ne lire que deux écrivains japonais, ce seraient ceux-là. Superficiellement différents, leur sujet est au fond le même : l’engagement traumatique du Japon dans la modernité”, affirme-t-il.
“Presque tous les autres écrivains japonais de cette longue ère de modernité s’en sont inspirés sous une forme ou une autre. Par exemple, j’ai écrit ailleurs que même un écrivain comme Murakami Haruki – qui prétend avoir “à peine lu Mishima” – a en fait été profondément influencé par lui. Non pas parce qu’il a copié son style, mais parce qu’il est allé dans l’autre sens. Le japonais magnifiquement stylisé et beau de Mishima signifiait que Murakami devait écrire dans une prose fortement influencée par les Américains, dépouillée de toute référence culturelle japonaise, pour essayer d’échapper à son influence. Où que l’on regarde dans les premiers romans de Murakami, on sent la présence imminente de Mishima : il est comme un éléphant dans la pièce. Vu d’aujourd’hui, ce sont vraiment Natsume et Mishima qui comptent, et ce sont ces deux écrivains que j’encourage les jeunes générations, non seulement au Japon mais dans le monde entier, à continuer à lire et à explorer”, conclut-il.
Mario Battaglia

