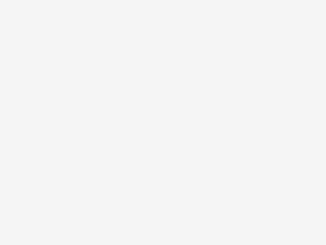Le polar japonais sort de l’ombre
Valeur sûre de la littérature contemporaine, le roman policier a pourtant été ignoré par les éditeurs français. Ces derniers semblent désormais s’y intéresser, comme en témoigne la récente vague de traductions. Petit tour d’horizon chez les maîtres du mystère nippon.

A chaque moment clé de leur histoire,
les Japonais ont trouvé dans le roman policier un moyen d’exorciser leurs peurs.
Tokyo est la cité du ‘mystère’ comme elle est celle de la ‘destinée’. Le Tokyo de l’endroit (omote) est complètement différent du Tokyo de l’envers (ura) ». C’est en ces termes que Hasegawa Tôgai présentait la capitale japonaise dans son essai intitulé Tôkyô no kaibô (Autopsie de Tokyo) paru en 1917. L’atmosphère qui régnait dans la première ville du pays était « fiévreuse » pour reprendre le terme de la féministe et poétesse Takamure Itsue. Ce qui explique sans doute pourquoi l’écrivain Yumeno Kyûsaku recommandait alors aux Japonais de lire des romans policiers, car ils constituent « le meilleur traitement contre la diphtérie ». Il utilisait cette métaphore médicale pour décrire la situation chaotique du Japon au début du siècle dernier lorsque celui-ci devait à la fois digérer les apports de son ouverture sur le reste du monde et s’imposer pour éviter de passer sous l’influence des Occidentaux. Cette période particulièrement agitée a été favorable à l’émergence de la littérature policière nippone au tournant des années 1920 avec entre autres Edogawa Ranpo dont le premier manuscrit La Pièce de 2 sen fut publié en avril 1923 dans la revue Shinseinen. Cette dernière a joué un rôle crucial dans la propagation du genre pendant plus de trente ans, contribuant à l’éclosion d’une école japonaise du roman policier, laquelle trouvait son inspiration dans une société en pleine mutation.
De nombreuses valeurs du passé disparaissaient à mesure que l’urbanisation s’accélérait, contribuant à créer un certain malaise au sein de la population dont les auteurs de roman policier se sont délectés. En rapportant dans leurs écrits les peurs et les angoisses de leurs contemporains, les auteurs ont suscité un intérêt croissant pour leurs œuvres auprès d’un public qui y trouvait un moyen de se rassurer. Comme aimait à le rappeler Yumeno Kyûsaku, « la littérature policière, c’est le non-sens, l’humour, l’aventure, le grotesque, le mystère et bien d’autres choses encore ». Chacun pouvait trouver satisfaction grâce au roman policier. C’était d’autant plus facile que les éditeurs ont lancé à la fin des années 1920 le livre à un yen (enpon), c’est-à-dire des éditions bon marché dont la littérature policière a largement profité. Edogawa Ranpo a raconté que la vente d’un recueil de ses œuvres dans cette collection lui avait valu de payer plus de 16 000 yens d’impôts, une fortune à l’époque. Ce premier âge d’or du roman policier dans l’Archipel a pris fin avec la militarisation de la société et la censure qui l’a accompagnée. La plupart des auteurs, Edogawa en tête, ont d’ailleurs cessé d’écrire de la fiction.
La meilleure façon d’explorer la société
A partir de 1945, le retour de la paix et la démocratisation de la société sous l’influence américaine accompagnent le retour du polar sur le devant de la scène. Il faut dire que l’époque est aussi compliquée que dans les années 1920. Le marché noir, le crime organisé et une société qui se cherche sont des sujets de prédilections pour des auteurs comme Kayama Shigeru ou encore Takagi Akimitsu. Avec le retour de la croissance et d’un Japon triomphant sur le plan économique dans les années 1950-1960, plusieurs écrivains passent au crible la société japonaise qui s’embourgeoise et joue à l’autruche quand un problème surgit. Matsumoto Seichô va devenir le chef de file de ce nouveau courant baptisé « courant social » (shakaiha) dont Niki Etsuko fut l’une des pionnières avec son roman Neko wa shitteita (Le Chat savait). Dans Le Vase de sable (trad. par Rose-Marie Makino-Fayolle, éd. Philippe Picquier, 1987), Matsumoto dénonce, par le biais d’une enquête sur le meurtre d’un quinquagénaire, la discrimination dont font l’objet ceux qui sont jugés différents par le reste de la société.
Tandis que le Japon se hisse au sommet de l’économie mondiale au lendemain des Jeux olympiques de Tokyo, en 1964, le roman policier connaît une crise. La disparition de l’icône Edogawa Ranpo en 1965 y est peut-être pour quelque chose, toujours est-il que les Japonais se passionnent moins pour les intrigues criminelles, préférant rêver à des voyages à l’étranger ou au dernier modèle automobile sorti. Cela n’empêche pas pour autant l’émergence d’une nouvelle génération d’auteurs qui explorent de nouvelles voies. Nishimura Kyôtarô, créateur de l’inspecteur Totsukawa, profite ainsi de l’engouement des Japonais pour les déplacements en train pour s’imposer comme le maître du polar ferroviaire. Il a publié plus de 400 titres. A près de 80 ans, il n’entend pas s’arrêter avant d’en avoir écrit 500. En France, Les Dunes de Tottori (trad. par Jean-Christian Bouvier, éd. Seuil, 1992) est le seul roman ferroviaire signé Nishimura à avoir été traduit.
L’éclatement de la bulle financière à la fin des années 1980 a mis en évidence un profond malaise dans la société japonaise dont se sont nourris plusieurs écrivains de polars. Comme à l’époque des premiers écrits d’Edogawa, les Japonais semblent trouver dans la littérature policière de ces dernières années à la fois un miroir de leurs angoisses et un antidote efficace. C’est ce qui explique le succès de Miyabe Miyuki qui avec Une Carte pour l’enfer (trad. par Chiharu Tanaka et Aude Fieschi, éd. Stock, 1994) s’intéresse aux sociétés de crédit qui ont largement contribué à la faillite de l’économie nippone. Dans le même temps, d’autres auteurs comme Ishida Ira (Ikebukuro West Gate Park, trad. par Anne Bayard-Sakai, éd. Philippe Picquier, 2005) portent un regard sans concession sur cette société incapable de redonner l’espoir à une jeunesse désœuvrée. Grâce au roman policier, il est bien plus facile de découvrir ce Japon de l’envers (ura). Et on ne peut que se féliciter de voir les éditeurs français, peut-être lassés de l’école scandinave, se lancer ces derniers mois dans l’exploration du filon nippon.
Odaira Namihei