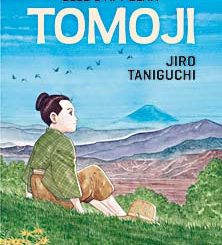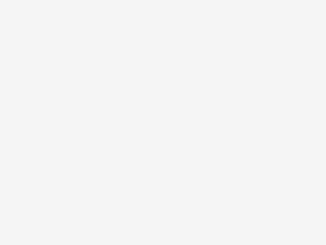La jeune romancière nous a accordé un entretien dans lequel elle évoque son rapport à la littérature et au manga.

Récompensée par le prix Akutagawa 2011, l’équivalent du Goncourt, pour son roman Kikotowa (voir la note de lecture) et par le prix des Deux magots, Asabuki Mariko est à 26 ans un des grands espoirs de la littérature japonaise. Pleine d’énergie et de finesse, elle nous a parlé des mots et des images.
Quelle a été votre réaction en apprenant que vous étiez lauréate du prix Akutagawa et du prix des Deux magots ?
A. M. : Sur le moment, j’ai été bien sûr très heureuse. Cependant, je considère que l’écriture d’un roman revient à adresser un paquet ou un ensemble de lettres à “vous”. Dès lors, j’ai l’impression que ces prix matérialisent le fait que ce paquet est finalement arrivé à destination .
Qu’est-ce qui vous influence lorsque vous écrivez ?
A. M. : Lorsque j’écris, je ne tiens pas compte de ce qui se passe au niveau de la littérature de façon générale. Je suis en face de mon texte et je ne m’intéresse qu’à lui. Je ne veux pas être influencée par ce qui vient de l’extérieur. Néanmoins, on ne peut pas éviter le travail de lecture même lorsqu’on rédige. Dès lors, ce qui s’écrit dans la littérature japonaise, mais aussi dans celle venue de l’étranger, entre d’une façon ou d’une autre dans ma réflexion.
Quel a été le livre que vous avez aimé le plus lorsque vous étiez enfant ?
A. M. : Si je me limite aux livres qui ont exercé sur moi une certaine influence, je citerai Life Story de Virginia Lee Burton [inédit en français] qui raconte l’apparition de la vie sur terre. Quand je l’ai lu étant petite, ce livre m’a fait beaucoup d’effet. Il avait un côté inquiétant. Pourtant il m’intéressait, car il établissait les lois de la nature alors que pour moi, il existait un certain chaos dans le monde qui nous entourait. Ce contraste me passionnait. C’est la raison pour laquelle j’ai aussi dévoré toutes sortes d’encyclopédies et que j’ai lu les livres de Stephen Hawking. Au niveau littéraire, je citerai Winnie l’Ourson d’Alan Alexander Milne qui n’a rien à voir avec la version de Disney. Je l’ai lu en deux fois. Quand j’étais petite, il me faisait peur. Je l’ai relu plus tard et j’ai alors pu l’apprécier. A l’âge de 10 ans, j’ai aussi lu Nansô Satomi Hakkenden [La Légende des 8 chiens du clan Satomi d’Awa, inédit en français] qui raconte l’histoire de huit guerriers portant chacun une tache de naissance et dont la mission consistera à sauver le clan Satomi. Ce livre est l’œuvre de Takizawa Bakin. J’ai découvert, en le lisant pour la première fois, que sur la couverture on avait indiqué “traduit en japonais”. Ça m’avait paru bizarre puisque l’auteur était lui-même Japonais. J’ai donc consulté le texte original auquel je n’ai pas compris grand chose. Cette expérience m’a appris que la langue était de nature changeante.
On dit que vous êtes une grande fan de manga. Avez-vous eu envie d’écrire des scénarios ?
A. M. : Je n’ai jamais eu l’expérience d’écrire pour des manga, mais si j’en avais la possibilité, j’en serais ravie, car cela me permettrait de dépasser le cadre très linéaire de la littérature. Quand on écrit un roman, il y a un début et une fin, et il est difficile de sortir du chemin qui les relie. Le roman est une forme d’expression temporelle et il est difficile de s’en échapper. En revanche, l’image peut sortir de cette limite temporelle. C’est pourquoi lorsque j’écris, j’essaie de faire surgir des images susceptibles de bousculer la linéarité de l’écriture. Je suis donc intéressée par d’autres modes de représentation comme les installations multimédia ou le manga. Le manga m’attire parce qu’on peut parfois au moyen d’une seule case changer le sens d’une histoire. J’adore aussi les onomatopées et le manga en regorge. Avec le manga, on peut aussi représenter l’innommable de façon simple, alors qu’en littérature, cela demande plusieurs lignes voire plusieurs pages pour arriver au même résultat. Cela ralentit la vitesse de la pensée à la différence du manga qui lui donne plus de rythme. C’est donc pour moi une source d’inspiration. Parmi les auteurs que j’apprécie, il y a les dessinatrices qui appartenaient au groupe de l’an 24 [nées en 1949, elles ont beaucoup innové notamment dans, le shôjo manga, le manga pour les filles] comme Ôshima Yumiko ou Yamagishi Ryôko. Je peux aussi citer les auteurs qui ont participé à l’aventure du mensuel alternatif Garo, en particulier Tsuge Yoshiharu. La première fois que j’ai lu les histoires de Tsuge, j’ai été bouleversée. J’ai alors pris conscience de l’immense travail qui avait été déjà accompli avant même ma naissance. J’aime aussi Hanawa Kazuichi et son chef-d’œuvre Dans la prison (Keimusho no naka, éd. Ego comme X). C’est un auteur qui est capable de composer une histoire complexe avec des phrases et des dessins, tout en laissant au lecteur la liberté de lire son récit de manière très libre. Il a un tel talent que cela me fait presque peur. (rires)
Selon vous, y a-t-il une limite entre la fiction et la réalité ?
A. M. : La fiction dépend de la réalité, mais l’inverse est vrai aussi. Il y a donc une sorte d’interdépendance entre les deux. Je pense que la conscience des individus se présente sous la forme d’une espèce de bouillie. Il existe bien sûr une linéarité temporelle – hier, aujourd’hui et demain -, mais dans la tête de gens, ça ne se passe pas aussi clairement que cela. Ainsi on peut penser à quelque chose qui s’est passé il y a 10 ans comme si c’était arrivé hier. Il y a donc dans notre tête un ordre temporel, mais en même temps, il y a quelque chose qui brouille cette organisation temporelle. De même au niveau de la mémoire, la fiction et la réalité ont parfois tendance à se mélanger. Ainsi deux personnes peuvent croire que quelque chose s’est passé, alors que cela ne s’est jamais produit. Je trouve que c’est très intéressant de pouvoir décrire avec les mots ce genre de situation.
Avez-vous tenu un journal intime ?
A. M. : Je n’ai jamais écrit de journal intime parce que je n’ai jamais vraiment eu le désir d’écrire ce qui se passait réellement. En revanche, il m’arrive d’écrire ou de noter ce que j’appellerai des expériences de fiction. En d’autres termes, je note des visions, des pensées qui me viennent sur l’instant.
Quel est votre mot préféré et pourquoi aimez-vous ce mot ?
A. M. : Je ne sais pas si c’est vraiment mon mot préféré, mais je dirais bôyake. En fait, c’est un mot qui n’existe pas en japonais. Pourtant j’étais persuadée de son existence. Je l’assimilais au terme yûyake (crépuscule). Pour moi, bôyake était une version plus belle de yûyake. Alors quand j’ai appris que ce terme n’existait pas, ça m’a surprise. Je ne savais pas que j’avais inventé un mot. Je peux citer un autre exemple dans le même registre avec le verbe karagaru. Je croyais qu’il existait et je l’ai même utilisé dans un roman qui a reçu un prix littéraire. (rires)
Propos recueillis par Odaira Namihei avec la complicité de Ryoko Sekiguchi
Note de Lecture
 Towako rêve. Kiko ne rêve pas”. C’est par cette phrase que débute Kikotowa [éd. Shinchôsha, inédit en français], le roman d’Asabuki Mariko. Deux femmes que tout sépare se retrouvent après 25 ans de silence, dans la résidence secondaire de Kiko, où elles avaient l’habitude de passer leurs vacances ensemble. Kiko y est venue jusqu’à l’âge de 8 ans, accompagnée de sa mère et de son oncle, tandis que Towako, la fille de la concierge, les rejoignait. Aujourd’hui, les souvenirs de ces jours passés, loin de s’estomper, défilent dans les pensées de Towako au point qu’elle ne distingue plus ce qui relève du rêve ou de sa mémoire. Le quart de siècle qui l’a séparée de Kiko s’est écoulé comme un songe éphémère. Les retrouvailles, appréhendées par chacune des femmes, se font naturellement, d’une façon assez déconcertante pour un lecteur occidental. Les deux femmes se retrouvent sans cérémonie, se confient et partagent un bout de leur temps, avant de se quitter sans une larme. La frontière entre le rêve et la réalité, tout comme celle qui se dresse entre passé et présent ou celle qu’on établit entre souvenir et songes, sont abolies dans ce roman. La distinction entre le corps des deux femmes, à son tour, disparaît, comme si la continuité des cheveux de l’une se trouvait par évidence sur la tête de l’autre. Kiko et Towako deviennent une : Kikotowa.
Towako rêve. Kiko ne rêve pas”. C’est par cette phrase que débute Kikotowa [éd. Shinchôsha, inédit en français], le roman d’Asabuki Mariko. Deux femmes que tout sépare se retrouvent après 25 ans de silence, dans la résidence secondaire de Kiko, où elles avaient l’habitude de passer leurs vacances ensemble. Kiko y est venue jusqu’à l’âge de 8 ans, accompagnée de sa mère et de son oncle, tandis que Towako, la fille de la concierge, les rejoignait. Aujourd’hui, les souvenirs de ces jours passés, loin de s’estomper, défilent dans les pensées de Towako au point qu’elle ne distingue plus ce qui relève du rêve ou de sa mémoire. Le quart de siècle qui l’a séparée de Kiko s’est écoulé comme un songe éphémère. Les retrouvailles, appréhendées par chacune des femmes, se font naturellement, d’une façon assez déconcertante pour un lecteur occidental. Les deux femmes se retrouvent sans cérémonie, se confient et partagent un bout de leur temps, avant de se quitter sans une larme. La frontière entre le rêve et la réalité, tout comme celle qui se dresse entre passé et présent ou celle qu’on établit entre souvenir et songes, sont abolies dans ce roman. La distinction entre le corps des deux femmes, à son tour, disparaît, comme si la continuité des cheveux de l’une se trouvait par évidence sur la tête de l’autre. Kiko et Towako deviennent une : Kikotowa.
Leur souvenir le plus précieux est celui de Haruko, la mère de Kiko, morte brutalement 25 ans plus tôt. Il jaillit dans l’esprit des deux femmes qui ont atteint l’âge mûr comme la défunte. Asabuki Mariko nous embarque dans un univers très féminin. Elle nous fait découvrir ou redécouvrir l’approche tout à fait nippone des relations humaines : un Japonais se pense toujours en lien avec les autres. Malgré les différences individuelles, la conception japonaise est pratiquement imperméable à la déchirure individuelle et spatio-temporelle. L’absence du registre dramatique dans Kikotowa constitue la mise en scène de cette pensée. Ce roman est, avec son style simple tout en étant très littéraire, une excellente lecture pour un public français.
Ajiwa Hiro