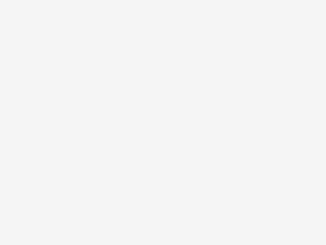Sur le bateau nous étions presque toutes vierges. Nous avions de longs cheveux noirs, de larges pieds plats et nous n’étions pas très grandes.” C’est par ces mots que débute le nouveau roman de Julie Otsuka. La romancière américaine d’origine japonaise livre un second roman qui ressemble à une sorte de compte rendu portant sur la vie de Japonaises qui, au début du siècle dernier, avaient quitté l’archipel pour fuir la pauvreté et se marier avec des compatriotes partis quelques années plus tôt pour faire fortune aux Etats-Unis. C’est en 1890 que l’immigration nippone vers l’Amérique débute. Ils sont 148 candidats cette année-là. Vingt ans plus tard, ils seront plus de 150 000. Mais leur présence suscite de nombreux problèmes. Voilà pourquoi, l’immigration japonaise vers les Etats-Unis sera officiellement suspendue en 1924.
Après son premier roman, Quand l’empereur était un dieu, publié chez le même éditeur en 2004 qui abordait la façon dont les ressortissants d’origine japonaise avaient été maltraités et enfermés dans des camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, l’écrivain poursuit sa quête sur ses racines. “Je me suis aussi fondée sur ce que je savais de l’histoire de ma propre famille. Mon grand-père, soupçonné d’être un espion à la solde du Japon, a été arrêté par le FBI le jour de l’attaque contre Pearl Harbour [7 décembre 1941] et envoyé dans des camps dans le Montana, au Texas et au Nouveau Mexique. Ma mère, mon oncle ainsi que ma grand-mère ont été internés durant trois années à Topaz, dans l’Utah. Ma famille a toujours été très discrète sur ce qui s’est passé pendant la guerre et d’une certaine façon, l’écriture de ce roman m’a permis d’aller au-delà de ce silence”, nous avait-elle déclaré, en 2004, au moment de la sortie de sa première fiction “sérieuse” comme elle l’avait souligné. A l’instar de cette dernière, Certaines n’avaient jamais vu la mer a été un travail de longue haleine pour la jeune femme. “Il a fait lentement son chemin en moi”, explique-t-elle. Huit années pour livrer un ouvrage de 140 pages qui prend le lecteur aux tripes. Pourtant, et c’est là la grande force de ce récit, l’écrivain ne tombe pas dans le pathos, optant pour un style épuré et une distance avec le sujet qui lui permet d’éviter d’employer un vocabulaire destiné à émouvoir le lecteur. Cela n’empêche pas l’émotion d’être présente, bien au contraire.
A la manière de ces objets en céramique qui donnent l’impression d’être bruts et qui suscitent néanmoins une impression de beauté, le second roman de Julie Otsuka ne laisse pas indifférent. Dans son premier roman, elle avait déjà entamé ce travail stylistique visant à dépouiller le plus possible son texte de toute sensiblerie de façon à laisser au lecteur la liberté de s’approprier les personnages dont la plupart n’avait pas de noms. Avec Certaines n’avaient jamais vu la mer, elle ne nomme aucune des femmes dont elle raconte le destin sur cette terre étrangère qui leur réserve de mauvaises surprises. La différence fondamentale, cette fois, c’est l’omniprésence du “nous”. “Nous ne parlions guère. Mangions peu. Nous étions douces. Nous étions bonnes. Nous ne causions jamais de problème et les laissions faire de nous ce qu’elles voulaient. Nous ne les embêtions pas pas avec nos questions. Nous ne répondions ni ne nous plaignions jamais. La plupart d’entre nous étaient des filles simples de la campagne qui ne parlaient pas anglais et par conséquent en Amérique, nous la savions, nous n’avions pas d’autre choix que de récurer les éviers et frotter les parquets”. Ces quelques phrases résument bien l’esprit du roman qui interpelle le lecteur au plus profond de sa conscience. Il ne peut pas rester insensible devant ce rapport circonstancié sur la vie de ces individus qui apparaissent un beau jour dans son quotidien et auxquels il accorde peu d’intérêt sinon un certain dédain. En définitive ces Japonaises auraient bien pu être les Sénégalaises, les Roms ou les Tunisiennes qui nous entourent sans que nous y fassions attention. Et puis, un jour, elles disparaissent comme les Japonais qui sont partis du jour au lendemain en 1942. “Les Japonais ont disparu de notre ville. Leurs maisons sont vides, murées. Leurs boîtes aux lettres débordent. Tout ce que nous avons c’est que les Japonais sont là-bas quelque part, dans tel ou tel lieu, et que nous ne les reverrons sans doute jamais plus en ce bas monde”. Avec son dernier chapitre, Julie Otsuka boucle la boucle et nous ramène au début de Quand l’empereur était un dieu et du premier chapitre intitulé Ordre d’évacuation n°19. La romancière a ainsi remonté le temps tout en soulignant de façon simple que la question de l’immigration n’a guère évolué depuis plus d’un siècle dans nos sociétés. Mais elle ne donne aucune leçon, laissant au lecteur le soin de tirer lui-même les enseignements de son attitude vis-à-vis de l’étranger.
Odaira Namihei