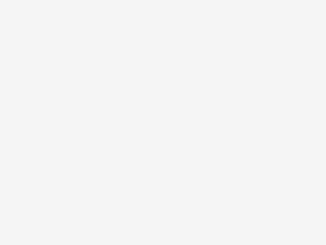A l’occasion de la sortie attendue du film Saudade, Tomita Katsuya et le scénariste Aizawa Toranosuke racontent leur Japon.

Entièrement auto-produit, Saudade commence dans une langueur toute brésilienne et nous entraîne peu à peu dans l’univers fermé des immigrés sur fond de hip-hop et de bruits de marteau-piqueurs. Le nouveau film de Tomita Katsuya au titre plein de mélancolie a été présenté dans plusieurs festivals européens. Le long de la Nationale 20, qui relie Tôkyô à la préfecture du Yamanashi, les personnages, aussi réels dans la vie qu’à l’écran, évoluent dans une ville de campagne transformée en centre commercial où leurs seules alternatives de travail sont les chantiers, les bars à hôtesses et le pachinko [jeu électronique qui consiste à faire glisser des billes de fer]. A travers le destin d’Amano, un jeune rappeur qui rempli des sacs de sable et tourne sa frustration contre les immigrés, on découvre la vie des nikkei, les Nippo-Brésiliens, descendants de Japonais de la troisième génération.
Dans le huis-clos d’une ville fantôme aux rideaux de fer toujours descendus, il y a aussi les filles thaïs embauchées dans des “pubs” pour concurrencer les bars à hôtesses made in Japan. En abordant le thème de l’immigration féminine, Tomita nous fait pénétrer dans le monde flottant du mizu shôbai ou “commerce de l’eau”. Il fait ainsi un pied de nez à l’univers glauque du business de la spiritualité à travers un trafic d’eau de source qui “désintoxique” . Pris au piège dans les zones grises d’un système où ils resteront toujours des marginaux, les personnages vont se croiser sans jamais vraiment se comprendre. De la nostalgie du pays natal à la haine de l’étranger, Saudade se savoure comme un bon morceau de hip-hop, “un cocktail où se mêlent le sang, les larmes et la sueur”.
Alissa Descotes-Toyosaki
Saudade se déroule dans votre ville natale du Yamanashi, est-ce-qu’elle est particulière au Japon ?
Tomita Katsuya : Non, l’histoire aurait pu se passer dans n’importe quelle autre petite ville. Le décor y est le même, l’histoire aussi. La vie sociale des campagnes s’est organisée autour de la voiture il y a longtemps, mais depuis le milieu des années 90, avec la pression des Etats-Unis et la globalisaton, certaines lois qui jadis empêchaient la construction tous azimuts ont été abrogées. Cela a entraîné un changement radical dans le paysage rural. Les grands centres commerciaux le long des routes se sont developpés et les quartiers autour des gares, jadis pleins de vie, se sont transformés en espaces fantômes.

Vos acteurs interprètent presque tous leur propre quotidien et vivent dans cette ville , vous vous connaissiez tous avant le film ?
T. K. : Oui, les deux personnages de Seiji et Bing sont des vieux amis de l’école primaire. Ils continuent à travailler dans les chantiers. Le rappeur Dengaryu qui joue Amano est aussi un “freeter”, un travailleur à temps partiel, tout comme Aizawa ! Moi-même, je voulais devenir musicien de punk rock, mais ça n’a pas marché. Du coup, je suis devenu camionneur. D’ailleurs je continuais à exercer ce métier pendant le tournage de mon film, mais on m’a retiré le permis. J’étais trop fatigué et je me suis fait flasher par un radar.
Au Japon, la situation du cinéma indépendant est-elle vraiment critique ?
T. K. : Oui, c’est de pire en pire. Contrairement à la France, il n’existe pas de subventions pour les auteurs indépendants et les artistes en général.
Aizawa Toranosuke : En fait, on vous aide seulement si vous êtes connus ! Cela nous a obligé à nous autofinancer et cela a été très difficle.
T. K. : Mais grâce à la présentation du film à l’étranger, nous avons été vraiment récompensés de nos efforts. Je pense que les artistes doivent utiliser tous les moyens qu’ils ont pour se faire connaître, sans rien attendre de personne.
Pouvez-vous nous parler de l’histoire des Nikkei, les Nippo-Brésiliens ?
A. T. : L’émigration des Japonais au Brésil a commencé il y a environ 100 ans, sous la restauration de Meiji. A l’époque, le Japon était pauvre et c’est avec la bénédiction du gouvernement qu’environ 800 japonais sont partis. En fait, ils se sont devoués pour la patrie et se sont exilés dans l’espoir de revenir un jour au Japon. A l’époque, le Bresil était très prospère. Ils se sont implantés dans la région de São Paulo et ont travaillé dans les plantations de café. Petit à petit, ils se sont mis a leur compte, ont acheté des terres et fondé des familles. Ensuite, la donne a changé et le Brésil est entré en récession. Dans les années 1990, le Japon de la bulle économique avait besoin de main-d’œuvre jeune. Les Nikkei de troisième génération ont pu revenir au Japon grâce à un visa spécial, mais ils ont été ostracisés par une société qui avait oublié l’histoire et les a traîté comme des opportunistes.
Dans Saudade, il y a le cas de cette jeune fille nippo-thaï qui est confrontée au choix de sa nationalité, le Japon ne reconnaissant pas la double nationalité…
T. K. : Non, les descendants de Japonais doivent choisir à partir de 22 ans, ce qui les contraint à abandonner une de leur nationalité. Le Japon est un pays insulaire très puriste. On est Japonais ou on ne l’est pas ! Je trouve que cette manière de penser est arriérée et complètement puérile. Pour les non-descendants de Japonais, c’est encore pire et très peu de gens peuvent obtenir un visa de travail.
A. T. : Oui c’est très hypocrite. Les Chinois par exemple n’entrent pas au Japon comme travailleur, mais comme “stagiaires”. Les nikkei entrent comme “descendants de japonais” etc. Mais tout le monde sait que le Japon les accueille seulement parce qu’il a besoin de main-d’œuvre.
Y a-t-il beaucoup de filles originaires d’Asie du Sud-Est qui immigrent au Japon ?
T. K. : Oui, il y a d’abord eu le boom philippin dans les années 1980. C’était essentiellement des filles qui pouvaient entrer avec un visa “danseur-artiste”. Comme pour les nikkei, on s’est attaché à donner une appellation neutre voire flatteuse au visa même si l’on savait que ces filles étaient embauchées dans les bars d’hôtesses ou qu’elles finissaient dans des réseaux de prostitution. Après, il y a eu le boom des Thaïs dans les années 1990. A cette époque, la femme japonaise occupait une place plus grande dans la société et se montrait de plus en plus indépendante. Beaucoup d’hommes se sont alors tournés vers les filles d’Asie du Sud-Est plus fragiles en apparence et plus expressives sur le plan des sentiments.
Vous évoquez aussi le pachinko dans votre film. Est-ce que ce jeu constitue un phénomène social inquiétant à vos yeux ?
T. K. : Les salles de pachinko sont implantées partout. Officiellement, elles offrent aux gagnants que des lots comme des paquets de cigarettes, car les jeux d’argent sont interdits au Japon. Mais les habitués savent que les lots peuvent être échangés contre de l’argent dans des boutiques annexes. Il existe donc une espèce de zone grise. A la base, le pachinko n’était qu’un jeu de hasard auquel les enfants pouvaient jouer et gagner des chocolats ou des jouets. Mais le problème se pose quand le jeu devient une addiction. Le matin, des gens attendent devant l’entrée comme s’ils pointaient au bureau. Ce sont surtout des femmes au foyer qui sont devenues des pros du pachinko. Elles sont tellement prises par le jeu qu’elles oublient tout. Il y a eu des drames terribles, où des jeunes enfants sont morts de chaleur dans des voitures pendant que leur mère passait la journée dans les salles de pachinko.
Le film se termine dans la violence, est-ce le reflet de la société japonaise ? Qu’aurait-il fallu pour amener une fin différente?
T. K. : La fin est inspirée d’un fait divers qui s’est déroulé dans la préfecture de Kanagawa [au sud de Tôkyô]. C’est un cas isolé de violence ethnique, mais qui peut tout à fait se reproduire au Japon. Dans ce sens, Saudade est une fiction basée sur la réalité. Le film a aussi pour ambition d’apporter une vision future du Japon. Dans le film, le personnage d’Amano tombe peu a peu dans un délire de pérsécution à cause de sa situation de renégat et l’absence de communiction avec ceux qu’il croient être ses ennemis. Si par exemple, le groupe de rap d’Amano et celui de Dennis le Nippo-Brésilien s’étaient produits sur la même scène, je pense que le dénouement aurait été bien différent.
Quelle image avez-vous de l’immigration en France ?
T. K. : Je garde l’image de Zidane qui donne un coup de tête en pleine finale de la Coupe du monde de football en 2006 à un joueur qui l’avait provoqué. Peut-être que cela n’avait pas de rapport direct avec son identité algérienne, mais pour nous les Japonais, cet incident nous a beaucoup impressionnés. Pour ma part, j’ai ressenti la profondeur d’un problème lié à la condition des immigrés en France. Ici au Japon, on parle en ce moment des îles de Takeshima et de Senkaku qui sont revendiquées respectivement par la Corée et la Chine. Il n’est pas du tout impossible que ces conflits territoritoriaux se transforment un jour en des problèmes ethniques.
Le film a été tourné avant la catastrophe nucléaire de Fukushima, vous étiez au Japon à ce moment-là ?
T. K. : Oui, nous sommes partis à Fukushima presque tout de suite. Il fallait qu’on se rende compte de la situation par nous-mêmes. La zone interdite des 20 kilomètres était encore accessible et cela a été un énorme choc. On était très en colère. En plus, les médias préféraient envoyer des pigistes ou faire des interviews par téléphone plutôt que d’envoyer leurs journalistes sur place, tout en soutenant que la population de Fukushima ne risquait rien. Je me demande toujours qu’est-ce que je fous encore au Japon ! (rires)
Propos recueillis par A D.-T.