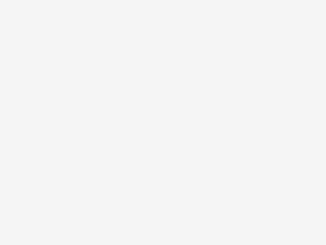Le metteur en scène s’est toujours attaché à interpeller ses contemporains. Son décès prive le pays d’une de ses voix discordantes.

Couronné, début octobre, par le titre de réalisateur asiatique de l’année lors du Festival international du film de Pusan, en Corée du Sud, Wakamatsu Kôji a profité de l’occasion pour rappeler quelques vérités alors qu’un autre cinéaste se serait contenté de remerciements de circonstance. “Seuls les films commerciaux bénéficient du soutien des pouvoirs publics en Asie. Voilà pourquoi la plupart des jeunes réalisateurs se lancent dans le cinéma commercial”, a-t-il déclaré, lui qui, depuis plusieurs décennies, s’était battu pour que le cinéma indépendant puisse exister et être distribué. Wakamatsu Kôji n’est plus. A 76 ans, il a été fauché, le 12 octobre, par un taxi dans une rue de Tôkyô comme il se rendait à la projection de l’un de ses films. Il est décédé le 17. Rebelle dans l’âme, l’homme a passé une grande partie de sa vie à produire des films dont l’un des principaux objectifs étaient d’amener les spectateurs à s’interroger et à réagir. Dans un pays balloté par une crise économique et politique sans précédent, il avait retrouvé ces dernières années sa verve de la fin des années 1960 et du début des années 1970 au cours desquelles il s’était engagé avec son compère Adachi Masao dans un combat politique à la limite de la subversion avec notamment son documentaire Sekigun-FPLP : Sekai sensô sengen [Armée rouge-FPLP : Déclaration de guerre mondiale, 1971] et L’Extase des anges (Tenshi no kôkotsu, 1972) dans lequel il décrivait les luttes violentes entre plusieurs groupes révolutionnaires. Cela lui avait valu d’être dans le collimateur de la police, en particulier après la prise d’otages et le règlement de compte interne au sein de l’armée rouge unifiée en février 1972 au mont Asama. Cet événement suivi en direct à la télévision par des millions de Japonais a traumatisé le pays pendant des années, mais pour Wakamatsu, toute la vérité n’a pas été dite. C’est la raison pour laquelle il est revenu dessus en 2007 avec son docu-fiction United Red Army (Jitsuroku rengô sekigun : Asama sansô e no michi), signant ainsi son grand retour. “Je me suis souvent demandé pourquoi ces étudiants, issus de grandes universités et dont l’avenir était tout tracé, s’étaient soulevés pour tenter de changer, ne serait-ce qu’un peu, la société japonaise. S’il y a prescription d’un point de vue juridique pour ce qui s’est passé à Asama, le cinéma, lui, ne connaît pas de limite de temps. Je me suis donc dit que j’étais le seul à pouvoir transmettre le témoignage de ces événements aux générations futures”, expliquait-il, en 2009, lors de sa sortie en France. Né dans la préfecture de Miyagi, dans le nord-est de l’archipel, Wakamatsu Kôji souhaitait que ses films soient de nature à interpeller la jeunesse japonaise qu’il jugeait amorphe. “Elle a cessé de penser”, aimait-il à rappeler. Lui qui, à 17 ans, avait abandonné ses études d’agriculture et fait de la prison pour avoir rejoint un groupe criminel, ne pouvait pas se résoudre à laisser s’éteindre la flamme de la révolte. Dans son magnifique 17 sai no fûkei [Paysage de mes 17 ans, 2004], il avait tenté d’explorer la psychologie d’un adolescent en rupture avec la société afin de donner des clés à ses contemporains comme il l’a encore fait dans son dernier film 25 novembre 1970, le jour où Mishima a choisi son destin (11.25 Jiketsu no Hi : Mishima Yukio to Wakamonotachi, 2011) présenté au Festival de Cannes 2012. Le cinéma indépendant a perdu un de ses leaders. La jeune génération, incarnée entre autres par Tomita Katsuya qui lui a rendu un vibrant hommage, le 20 octobre lors de la présentation en avant-première de son film Saudade, ou encore par Ishii Sôgo est là. Reste à savoir si elle aura les ressources morales et financières pour continuer à exprimer cette voix discordante si indispensable dans un pays qui n’aime pas les clous qui dépassent.
Odaira Namihei