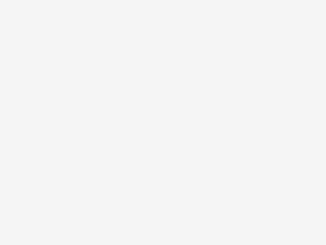Comme vous vivez à Minami Sôma et que vous vous intéressez aux problèmes sociaux et politiques, de nombreuses personnes estiment que vous êtes un auteur engagé. Avez-vous la même opinion de vous-même ?
Y. M. : Je ne fais pas tout cela parce que je veux m’engager politiquement. Il se trouve que la centrale accidentée s’appelle “Fukushima”, mais en réalité, c’est une installation opérée par Tokyo Electric Power Company (Tepco) et l’électricité qu’elle générait n’était pas destinée à la population de la préfecture de Fukushima, mais entièrement à celle de la région de Tôkyô. Lorsque j’ai commencé à réaliser cela, j’ai compris que cette catastrophe n’était pas arrivée dans la lointaine préfecture de Fukushima. J’ai commencé à comprendre que, en tant qu’individu ayant vécu toute sa vie dans la capitale, j’étais tout aussi responsable de la situation.
Qu’est-ce qui vous a motivé à venir vous installer dans la région ?
Y. M. : En écoutant les histoires de ces 420 personnes rencontrées pour mon travail à la radio, j’en suis venue à prendre la mesure de leurs difficultés quotidiennes. Non pas tant les problèmes liés à la radioactivité que les questions touchant l’économie locale. Dans cette région vivant essentiellement de l’agriculture, la catastrophe a rendu presque impossible la poursuite de cette activité. Même si les tests de césium sont normaux, personne ne veut acheter les produits locaux. Certains producteurs de lait et d’autres agriculteurs ont été poussés au suicide. En outre, dans les zones côtières de Fukushima, qui sont tout à fait différentes des villes en ce sens que de nombreuses familles composées de deux ou trois générations vivent sous le même toit : vous y trouvez des parcelles de terres autour desquelles s’organisent de véritables petits hameaux composés d’un bâtiment principal, une annexe, une maison pour les parents âgés qu’on appelle “inkyo”, un hangar, des terres arables, des rizières et des zones boisées. C’est là que vivent des familles élargies au sein desquelles il existe des liens extrêmement forts. Pour donner un exemple, on peut voir un enfant que sa mère allaite se retrouver dans la maison d’à côté où la mère lui donnera aussi le sein. Il existe aussi dans la région une spécialité appelée hokki gohan (palourdes au riz). Parfois une famille qui en prépare peut aussi vouloir manger du riz blanc. Pour cela, il suffit d’aller taper à la porte du voisin pour en emprunter. Il existe une solidarité très forte entre eux, complètement différente des relations en vigueur dans les grandes villes. Mais à la suite de la catastrophe nucléaire, il est souvent arrivé que l’on évacue seulement les jeunes vers d’autres préfectures en laissant derrière les parents âgés. Ce fractionnement des familles est un véritable problème. Je me suis donc dit que si je devais continuer à vivre tranquillement à Kamakura, au sud de Tôkyô, et à me rendre ici juste pour mon travail à la radio, je ne pourrais pas être en mesure de comprendre les difficultés que ces gens rencontrent dans leur vie quotidienne. Voilà pourquoi j’ai décidé de m’installer à Minami Sôma.
Dans Sortie parc, gare d’Ueno (JR Ueno Eki Kôenguchi) paru en France il y a tout juste un an, pourquoi avez-vous décidé d’écrire sur les sans-abri ?
Y. M. : J’ai commencé à écrire des romans à l’âge de18 ans et j’en ai aujourd’hui 48. Cela fait près de 30 ans. Dans les entretiens que j’ai accordés au cours de ces années, l’une des questions les plus récurrentes a été : “Pour qui écrivez-vous ?”. Et j’ai invariablement répondu que “J’écris pour les gens qui n’ont nulle part où aller”. Je continue à le faire parce que mes sentiments n’ont tout simplement pas changé. Cela revient à me demander pourquoi j’ai commencé à écrire en premier lieu. Parce que je n’avais nulle part où aller dans ce monde que ce soit à la maison ou à l’école. je me suis mise à écrire et à créer un autre monde. Je veux donc écrire sur ceux qui n’ont plus rien à eux, que ce soit les sans-abri et ceux dont les maisons ont été tellement polluées par la catastrophe nucléaire qu’ils ne pourront pas y retourner. Je ne peux pas avoir l’esprit tranquille si je n’écris pas sur ces gens.
Est-ce que votre dernier ouvrage publié au Japon, Neko no Ouchi [La Maison du chat, inédit en français] est fondé sur votre expérience depuis votre déménagement à Minami Sôma ?
Y. M. : Oui. Pour résumer brièvement, je pense qu’il existe toujours dans la vie un chemin pour échapper au désespoir. Depuis que je suis à Minami Sôma, j’ai remarqué avec quelle diligence les gens vivaient leur propre existence. Il y a une petite rue commerçante près de chez moi. Chacun des magasins qui la compose, que ce soit le marchand de chaussures, la boutique de vêtements, le boucher, le fleuriste ou le poissonnier, est géré entièrement par les membres d’une même famille. Et en les observant, vous pouvez constater qu’aucun d’entre eux ne roule sur l’or. Mais cela ne les empêche pas d’être diligent dans leur façon de travailler. Par exemple, si vous allez chez le cordonnier pour réparer un talon, il ne se contentera pas de le rafistoler. Il réalise un travail de qualité. Un jour, j’ai demandé au tailleur de transformer un de mes kimonos pour en faire une robe de soirée, mais il ne m’a pas facturé pour le service que cela demandait.
Il en va de même pour le poissonnier. Ailleurs, les sashimi sont généralement prédécoupés et emballés pour la vente. Mais à Minami Sôma, les gens font la queue à l’extérieur des poissonneries leur assiette à la main. Ils demandent du thon ou un peu de bonite en plus, et le poissonnier leur découpe et leur met sur l’assiette sous leurs yeux. Et ce n’est pas cher non plus ! J’ai eu un jour un poissonnier dans mon émission et je lui ai demandé si c’était pesant pour lui de faire tout cela. Il m’a répondu que non parce que ses clients apprécient cette différence. C’est comme ça que la vie se déroule ici. Tout le monde vit dans une communauté qui se serre les coudes.
Cela me met en colère de voir ces gens qui vivent en marge du cynisme économique ambiant être affectés si durement par une centrale nucléaire, laquelle est l’incarnation de ce système économique. Mais en même temps, j’ai été très touchée de les voir mener leur existence humble en dépit des difficultés et de leur tristesse d’avoir perdu des êtres chers. C’est la raison pour laquelle j’ai choisi de décrire de façon sincère des scènes de la vie quotidienne dans ce roman.
Plus de cinq ans après la tragédie de 2011, qu’en est-il ?
Y. M. : Je dirais que ces gens ont été oubliés. Immédiatement après la catastrophe, les médias ont afflué dans la région, à la recherche pour la plupart d’images fortes. Les journalistes demandaient aux gens s’ils accepteraient qu’on photographie leur maison et si quelqu’un répondait : “ma maison n’a pas été touchée par la vague”, ils ne cachaient pas leur déception. Une tragédie de cette nature, en dépit de ce qu’elle représente de malheur pour des individus, ne représente qu’un simple produit pour les médias. Pourtant les gens de la télévision et ceux de la presse écrite ne cessent de dire que des émissions sur les tremblements de terre ne font pas de bonnes audiences ou que les livres sur ce sujet ne se vendent pas.
Tôkyô a maintenant les yeux tournés vers les prochains Jeux olympiques et les gens semblent ne plus penser qu’à ça. Il n’en reste pas moins que de nombreux projets de reconstruction n’ont pas reçu de financement à venir, ou qu’ils ont été retardés en raison de la hausse du prix des matériaux de construction à cause de la préparation du rendez-vous olympique. Pour cette raison, de nombreuses victimes de la catastrophe vivent encore dans des logements temporaires. Dans mon émission de radio, une personne a fait ce commentaire incroyablement fort après avoir entendu que Tôkyô avait été choisi pour organiser les prochains Jeux olympiques : “Pour les gens de la capitale qui ressemble à un puissant éléphant, Minami Sôma n’est qu’une minuscule fourmi. Ils s’en fichent donc s’ils doivent nous écraser”. Il est clair que les événements de mars 2011 sont déjà oubliés là-bas et les populations locales sont blessées par ce qui s’apparente à un oubli.