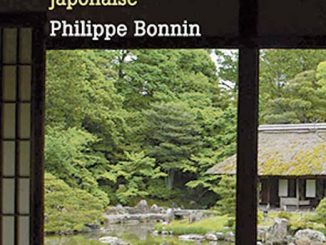Cette nouvelle figure dans un manuel scolaire pour les lycéens. Comment a-t-elle été choisie ?
Cette nouvelle figure dans un manuel scolaire pour les lycéens. Comment a-t-elle été choisie ?
K. H. : Ce sont les éditeurs de ce manuel qui tenaient absolument à la publier. Cela a été très difficile à réaliser. Si un lycéen ordinaire, qui n’est pas originaire de Fukushima, peut la lire de manière objective, un lycéen de Fukushima vivant en plus dans la zone des réfugiés par exemple, de quelle façon la lirait-il ? On pourrait lui dire que ce n’est juste qu’une fiction, mais ce n’est pas aussi simple. Après en avoir discuté avec les enseignants de Fukushima, certains d’entre eux m’ont dit que l’on ne pouvait pas enseigner ce qui est “Dieu”. Les enfants étaient encore trop sensibilisés par la catastrophe. Pour certains enseignants, c’était encore trop tôt ; et même à Fukushima, les gens ne pensent pas tous de la même façon selon les quartiers. Et il fallait encore tenir compte de l’état psychologique des enseignants eux-mêmes. C’était très délicat d’aborder ce problème dans un manuel scolaire. Mais la maison d’édition a insisté, en tenant compte de toute cette problématique. On pouvait s’attendre à des réactions négatives, mais malgré cela, les éditeurs ont décidé de continuer à publier l’ouvrage pour une nouvelle année. On m’a dit que cela continuerait encore l’an prochain.
Le roman Okina tori ni sarawarenaiyô [Pour ne pas être enlevé par un grand oiseau, inédit en français] sorti au Japon en 2016, raconte l’humanité vivant dans le futur. Le déclic de cette histoire semble être encore la catastrophe de mars 2011 ?
K. H. : Oui. C’est tout à fait vrai. Toutes les nouvelles technologies dépassent de loin les capacités humaines. Je pense non seulement aux centrales nucléaires, mais aussi aux manipulations génétiques. Une fois en fonction, on ne peut plus les maîtriser. Cela dit, l’humanité s’éteindra inéluctablement un jour. Tel est son destin, comme, d’ailleurs, celui de l’homme qui est mortel. Ce sont ces deux thèmes que j’ai voulu présenter dans ce roman.
En le lisant, on ne resent pourtant pas ce sentiment alarmiste.
K. H. : Non en effet. Ce n’est pas pour alerter les gens. Je ne suis pas faite pour ça. Cependant, si tout va mal, inévitablement on ne peut rien faire. Je ne prétends pas dire que c’est la seule vérité. Chaque romancier a son rôle à jouer : celui de tirer la sonnette d’alarme ou bien celui de dire clairement qu’il n’y a pas de raison de s’inquiéter ! Cela dit, ce serait toujours mieux de ne pas en arriver là.
On éprouve tout de même un regard chaleureux à l’égard de cette humanité du futur.
K. H. : Merci. Oui, il y a toujours un grand sentiment d’amour.
Qu’est-ce qui vous intéresse dans le Japon d’aujourd’hui ?
K. H. : Je m’intéresse surtout au peuple japonais. Quand vous êtes à l’étranger plus particulièrement, on pense à ce qui fait l’originalité des Japonais en bien comme en mal. Vivant au Japon, je ne cesse de me poser des questions en lisant les journaux ou en regardant la télé. Cela m’arrive depuis l’époque de la bulle économique (les années 1980-1990). Depuis mon enfance, le Japon n’a pas arrêté de changer. Il n’y a pas eu de grands changements, mais les Japonais n’arrêtent pas de procéder constamment à des mises à jour. C’est très étrange. Et c’est ce qui m’intéresse actuellement.
Propos recueillis par H. S.
Références
Kawakami Hiromi est née en 1958 à Tôkyô. Pendant qu’elle faisait ses études, elle commence à adresser ses nouvelles à des revues de science-fiction. Elle y fait paraître ses premières œuvres jusqu’à la disparition de la revue NW-SF en 1982. Après quatre années dans l’enseignement, elle se marie et devient mère de famille. En 1994, elle publie son premier recueil de nouvelles Kamisama. Au cours des années suivantes, elle reçoit plusieurs récompenses littéraires dont le prix Akutagawa, l’équivalent du Goncourt et le prix Tanizaki pour Les Années douces (Sensei no kaban, trad. par Elisabeth Suetsugu, 2003) chez Philippe Picquier. Le même éditeur a fait paraître, en 2016, Soudain, j’ai entendu la voix de l’eau (Suisei) toujours traduit avec la même finesse par Elisabeth Suetsugu.