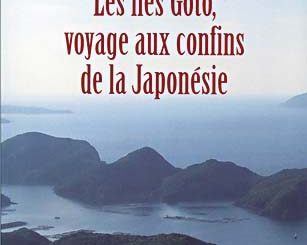En publiant des mangas en France et au Japon, percevez-vous des affinités culturelles entre ces deux pays ?
T. K. : Dans ce domaine, je pense de plus en plus qu’“être différent” n’est pas un problème dans les deux pays. On accepte ceux qui ont des difficultés ou qui ne fonctionnent pas comme les autres. “Etre différent” n’empêche pas de faire correctement son métier.
Cela tient-il à votre expérience ?
T. K. : En effet. J’ai toujours essayé de ne pas montrer qui j’étais réellement car je craignais que l’on me juge pour être sans morale. Je me suis efforcée de cacher mes différences. Mais mes lecteurs m’ont appris qu’ils acceptaient les auteurs sans juger leur vie et leur comportement original, même s’ils ont des failles. Ce n’est pas parce qu’un mangaka fait quelque chose de bizarre qu’on n’achète plus ses mangas. Les lecteurs nous restent fidèles.
Que vouliez-vous cacher ?
T. K. : Quand j’étais collégienne, je pensais souffrir d’un problème psychologique lié à des troubles neurologiques. Mes parents, n’ayant aucune connaissance dans ce domaine, ne m’avaient pas emmenée chez un spécialiste. J’étais instable sur le plan émotionnel et je souffrais par moments de dépression profonde. Je voulais donc cacher cette anormalité que j’avais trouvée en moi. Au Japon, à l’époque, les personnes instables étaient mises à l’index. Aujourd’hui, on a découvert que mon trouble était lié à mon physique. Je tombe facilement en état de déshydratation et mon taux de sucre dans le sang peut varier en raison d’un rein plus petit que l’autre. Depuis que je le sais, je fais attention et j’arrive à gérer mon état psychologique. Cela me permet de travailler plus facilement qu’avant.
On vous retrouve dans les personnages de vos mangas remplis d’humanité, fragiles et forts à la fois. Où se trouve la frontière entre vous et vos mangas ?
T. K. : Même en mélangeant mes propres expériences, j’évite de tomber dans le récit autobiographique. Ainsi, il m’arrive de m’amuser en créant des personnages me ressemblant. Ainsi trouver la frontière devient un jeu entre l’auteur et le lecteur. Cette ambiguïté est peut-être une des caractéristiques de mes œuvres.
En observant vos dessins et votre trait, on ressent un travail très manuel.
T. K. : Je dessine avec des crayons, des pinceaux et bien sûr un ordinateur. J’utilise principalement, un critérium avec des mines sélectionnées avec soin. Les pros devraient normalement se munir de divers outils de qualité. Ce n’est pas mon cas. Je ne dessine que ce que je peux dessiner avec ce simple critérium, c’est comme ça. Car j’ai l’habitude de bouger et de dessiner souvent en voyageant. Par exemple, quand je m’ennuie, je pars en Corée. Quand je suis en ville, au lieu de travailler à la maison, je m’installe dans un café. Ce n’est donc pas pratique d’utiliser des plumes et de l’encre. Le critérium est finalement un outil plus adapté à mon mode de vie. Pour les couleurs, je scanne le dessin avant de les appliquer.
L’histoire de vos œuvres se passe chaque fois dans une ville précise, comme Nagasaki par exemple. Cela a-t-il une importance particulière ?
T. K. : Nagasaki était un choix pour décrire une maison de plaisir de l’ère Edo, dans une ville où il y avait des étrangers. Etant originaire de Kumamoto, à Kyûshû, je connais mieux cette région que Tôkyô et je maîtrise sa langue locale. C’est aussi plus facile de se déplacer pour enquêter sur place. C’est plus rassurant de dessiner ce que je connais et ce que j’ai vu, c’est important de donner un effet réaliste. Dans ce sens, oui, le choix de la localité a son importance.
Les séismes qui ont violemment secoué Kumamoto en 2016 ont-ils changé votre approche professionnelle ?
T. K. : Tout de suite après, j’ai voulu faire une histoire racontant l’avenir de la région. Mais le projet n’a pas vu le jour, car la réalisation d’œuvres concernant ce genre de catastrophe réelle est très délicate à cause d’une certaine réglementation. Ça m’a refroidie et j’y ai renoncé. Je suis un peu compliquée. (rires)