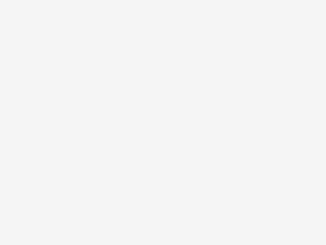Ce que vous dites est important car ce n’était pas la première fois que le Tôhoku subit un tsunami. Dans le passé, on trouvait sur les terrains des bornes qui indiquaient le niveau d’eau atteint par les précédentes inondations, mais les gens oublient, et sous-estiment le fait de vivre dans des zones à risque.
F. H. : Ces gens se comportent ainsi pour plusieurs raisons. Au Japon, par exemple, le culte des anciens est encore très important. Les personnes vivent d’habitude près du cimetière où repose leur famille. S’en éloigner signifierait rompre ce lien multigénérationnel avec sa propre terre et ses propres racines: il s’agirait d’une insulte, d’une blessure infligée à ses propres ancêtres.
Pour certains ça peut paraître étrange, mais parmi les choses qui blessent le plus les rescapés de Fukushima, c’est l’impossibilité de se rendre sur le tombeau familial et accomplir cette série de rituels qui font partie de nos traditions. Par exemple, la pierre tombale de ma famille a été endommagée par le tremblement de terre du 11 mars. La réparer a été un geste impératif de la part de mes parents. Ce lien avec le lieu d’origine est bien souvent plus fort que tous raisonnements sur la sécurité.
Revenons à votre livre. Il commence donc comme un reportage, mais la fiction démarre soudainement lorsqu’un des frères protagonistes de votre précédent roman Seizazoku [La Sainte Famille, 2008, inédit en français] apparaît comme par magie sur le siège arrière de la voiture que vous êtes en train de conduire. Ô chevaux, la lumière est pourtant innocente peut donc être considéré comme la suite de ce roman ?
F. H. : Je ne parlerai pas d’une suite, plutôt d’une idée récurrente. Chaque écrivain revisite souvent les mêmes thèmes, sous différentes formes. Dans mon cas, le désastre du 11 mars a généré une série de pensées qui m’ont porté à refaire vivre certains éléments de Seizazoku. J’ai atteint un stade où le simple reportage n’était plus suffisant à exprimer mes sentiments et j’ai dû avoir recours à des instruments narratifs, que je maîtrise mieux. C’est important de souligner que beaucoup de personnes ont fui Fukushima, mais des centaines d’autres personnes ont accouru pour aider, témoigner, ou simplement voir ce qui s’était produit. Les frères de Seizazoku peuvent donc être vus non pas comme les personnages d’une histoire, mais comme des individus réels, puisque leur regard peut représenter le regard de millions des gens.
Les animaux sont encore une fois protagonistes de votre roman. Pourquoi les trouvez-vous aussi fascinants ?
F. H. : Les chevaux sont au centre de l’histoire ainsi que les chiens, les chats et les bovins. Depuis la nuit de temps, ils côtoient les hommes et dépendent d’eux pour vivre. Ils observent ainsi les êtres humains d’une position très proche. Le regard d’un Japonais sur l’histoire de son propre pays sera toujours très subjectif, car il fait partie de cette histoire. Les animaux, au contraire, peuvent se permettre un regard objectif sur les choses. C’est pour cela que je les considère comme un medium narratif parfait.
A Fukushima, les animaux sont devenus les protagonistes de la période post-désastre car un grand nombre d’entre eux ont été abandonnés et livrés à eux-mêmes…
F. H. : C’est vrai, c’étaient des animaux domestiques et ils sont devenus sauvages. Quand je suis retourné la dernière fois à Fukushima, en décembre, ils étaient plus nombreux, car ils s’étaient reproduits entre-temps. Beaucoup de bénévoles vont les nourrir et essaient de tout faire pour qu’ils ne soient pas tués. La chose la plus intéressante est qu’aujourd’hui il y a un nombre impressionnant d’oiseaux, bien plus nombreux que dans le passé. Les animaux occupent ainsi tous les espaces abandonnés par l’homme.
Quel est le rapport entre Fukushima et les chevaux ?
F. H. : Durant des siècles, cette région était célèbre pour les prestigieux élevages des races équines. Pendant la période Edo (1603-1867), les paysans et les chevaux vivaient sous le même toit. Les habitations avaient une forme en « L »: les humains occupaient un côté de la maison, l’autre était réservé aux chevaux. Chaque animal possédait un nom. Je me rappelle que lorsque j’étais enfant, chez moi il y avait une écurie, même si à l’époque nous n’avions plus de chevaux. Cette culture a désormais presque disparu. Avec la modernisation de l’agriculture et l’emploi des machines, les chevaux ne sont plus nécessaires. Même l’élevage des chevaux de course est passé à Hokkaidô et les seuls restant sont employés dans le tourisme.
Vous êtes né à Kôriyama, quels souvenirs gardez-vous, de votre ville natale ?
F. H. : Quand j’étais enfant, la ville était célèbre pour ses yakuza (rires). Au fur et à mesure que le temps passait, c’est devenu le principal centre commercial de la préfecture de Fukushima et le deuxième centre urbain du Tôhoku. Le tremblement de terre a été un coup dur pour l’économie locale, mais maintenant on assiste à une reprise. La population a même augmenté, à cause des gens qui ont dû abandonner les zones les plus contaminées de la préfecture pour s’y réfugier.
Dans votre roman vous avez écrit : “Je n’ai jamais eu l’intention de rester dans ma ville. J’avais pris cette décision déjà à l’école primaire. Je ne peux pas dire que je détestais cet endroit, tout simplement, Kôriyama n’avait pas besoin de moi.” Que vouliez-vous dire ?
F. H. : C’est un peu difficile à expliquer. Un des facteurs qui m’a poussé à quitter Fukushima vient de la tradition locale. Je viens d’une famille de fermiers. Normalement, l’aîné succède au père dans la gestion de la ferme et assiste ensuite les parents devenus âgés, alors que le fils cadet est libre de s’en aller et de chercher fortune ailleurs. Depuis mon enfance je savais donc quel aurait dû être mon destin. J’ai vécu à la campagne jusqu’à 15 ans, puis, pour fréquenter le lycée, je suis parti en ville, j’ai commencé à côtoyer un milieu différent et à rencontrer de nouveaux amis. J’ai ainsi commencé à me détacher de chez moi avant de partir définitivement, à 18 ans, lorsque je me suis inscrit à l’université à Tôkyô.