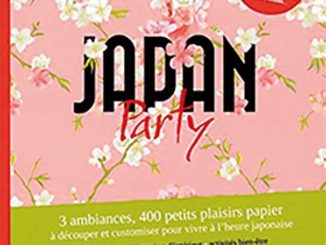Pour parvenir à maîtriser parfaitement l’ensemble des éléments indispensables à la création de son personnage principal capable de choisir, selon la requête de ses clients, le bon papier, le bon style ou encore le bon instrument d’écriture, l’écrivain s’est à la fois fiée à sa propre expérience, mais elle a également mené de nombreuses recherches afin de donner à son récit toute la crédibilité requise. Car on ne s’improvise pas écrivain public, surtout pas au Japon où la maîtrise de la calligraphie est impérative. Hatoko en témoigne : “Arriver à maîtriser l’écriture des cinquante hiragana et autant de katakana m’a bien demandé deux ans, je crois. C’est à partir de l’été de ma troisième année d’école primaire que j’ai vraiment commencé à m’exercer à tracer des caractères chinois, des kanji. (…) A la différence des hiragana et des katakana dont le nombre est limité, il y a une infinité de kanji. C’est comme un voyage sans fin ni but. C’est ainsi que j’ai passé mes années d’écolière à calligraphier sans arrêt.” Elle le fait sous le contrôle sévère de sa grand-mère, “l’Aînée”. Il se dégage aussi du roman d’Ogawa Ito, les notions d’héritage et de transmission d’un savoir-faire que l’on retrouve souvent au Japon dans de nombreux métiers d’art. Le rapport de maître à disciple existe dans de nombreux secteurs, y compris dans celui d’écrivain public. L’auteur décrit, avec force, cette relation déterminante sans laquelle rien ne serait tout à fait possible. “J’écoutais les explications de l’Aînée en faisant de mon mieux pour contenir mon impatience. Je devais être surexcitée car ce jour-là, je ne sentais même pas les fourmis dans mes jambes. Enfin, il a été temps de préparer l’encre. Avec la verseuse, j’ai déposé quelques gouttes d’eau sur le mont de ma pierre à encre. Fabriquer de l’encre ! J’attendais ce moment depuis longtemps. J’adorais la sensation froide du bâton d’encre entre mes doigts. J’avais toujours rêvé d’essayer”, raconte Hatoko qui se souvient de ce jour où, pour ses 6 ans, sa grand-mère lui offrit sa première leçon.
Cet apprentissage difficile et exigeant ne se fait pas sans heurts, mais il crée un lien inaltérable entre les générations. Ogawa Ito y attache beaucoup d’importance. “J’emploie volontiers le mot japonais “tsunagari” (lien)”, explique l’écrivain qui met ainsi en évidence “le lien entre les gens, la façon dont ils interagissent”. “Ce n’est pas quelque chose de conscient, mais je sais que la plupart de mes histoires se concentrent sur ce thème. Par exemple, pour La Papeterie Tsubaki, je voulais écrire sur Kamakura et sur les relations de voisinage plus que sur les liens du sang”, ajoute-t-elle. Le choix de cette ville située à une quarantaine de minutes en train de Tôkyô n’est pas non plus sans conséquence sur la mise en valeur des rapports humains dans ce roman. “Malgré sa proximité avec la capitale, Kamakura est un lieu spécial complètement différent. Déjà au niveau de la nature, il y a, à la fois, la mer et la montagne et c’est un endroit où l’on vit très proche de la nature. L’atmosphère est complètement différente et du coup, les relations de voisinage aussi. J’y ai vécu quelques mois et mon livre témoigne de mon expérience directe. C’est là-bas que j’ai réfléchi à l’écriture de ce roman et quand il a fallu que je décide du lieu où se déroulerait mon récit, Kamakura s’est imposé tout naturellement”, raconte Ogawa Ito. Le roman s’ouvre d’ailleurs sur un plan de la ville afin que le lecteur puisse se repérer dans les déplacements des personnages, mais aussi choisisse de s’y rendre pour se fondre dans cette atmosphère si éloignée du rythme trépidant de la métropole tokyoïte. “Mon intention était de dépeindre la vie quotidienne dans tous ses détails et d’essayer de toucher du doigt le bonheur qu’on ressent à vivre son quotidien, à faire les mêmes choses. C’est peut-être répétitif, mais on en tire de petits bonheurs qui sont importants et qui rendent notre vie plus riche”, confie la romancière, assumant ainsi la monotonie qui se dégage de son roman.
Sans vouloir se noyer dans une nostalgie d’un Japon en voie de disparition, Ogawa Ito veut juste mettre en évidence cette évolution de nos modes de vie où les échanges épistolaires, par exemple, ont quasiment disparu et pas seulement au Japon. “Avant dans les hôtels, on trouvait toujours un set avec du papier et des enveloppes. Mais dans celui où je suis descendue, il n’y en avait pas. Ça m’a rendu un peu triste car je me faisais une joie de découvrir quel type de papier il y aurait, mais il n’y avait rien. Ça, c’est un peu triste”, témoigne-t-elle. “C’est pour cela que j’ai eu envie d’écrire à ce sujet. Il ne s’agit pas pour moi de chercher à protéger, mais plutôt à perpétuer quelque chose, de le faire revivre. J’ai d’ailleurs reçu de nombreux courriers de lecteurs qui me disaient que ce roman leur avait donné envie d’écrire, de revenir au papier à lettre”.
A la lecture de La Papeterie Tsubaki, il est en effet difficile de résister à la tentation de fouiller dans ses affaires pour y retrouver un stylo plume et prendre une feuille pour se lancer dans l’écriture d’une missive. On se rend rapidement compte que nous n’avons pas le talent de Hatoko, mais le fait même de faire l’effort de se mettre devant une feuille de papier avec un stylo est déjà une conséquence inattendue. Différents exemples proposés dans le roman incitent à les suivre ou du moins à tenter l’expérience d’autant plus que la plupart des courriers rédigés par l’héroïne de cette histoire sont d’une rare simplicité. Ogawa Ito parvient à nous transmettre sa propre envie d’écrire par l’entremise de Hatoko. Elle lui fait d’ailleurs rédiger une lettre personnelle qu’elle va adresser, bien évidemment, à l’Aînée et dans laquelle elle ouvre tout son cœur. “Les mots qui étaient restés prisonniers, pieds et poings liés, cherchaient à se libérer”. Elle remet en perspective son lien avec sa grand-mère et certains lecteurs seront peut-être surpris de verser une larme devant les sentiments exprimés par la jeune femme. Malgré l’absence de la grand-mère qu’elle appelle pour la première fois “mamie” dans cette lettre qui n’arrivera jamais à destination, Hatoko sentait que le moment était venu de lui dire : “Je suis devenue écrivain public, comme toi. Et ce sera mon métier pour la vie”.
Gabriel Bernard

références
La Papeterie Tsubaki (Tsubaki bunguten), de Ogawa Ito, trad. par Myriam Dartois-Ako, éd. Philippe Picquier, 20 €.