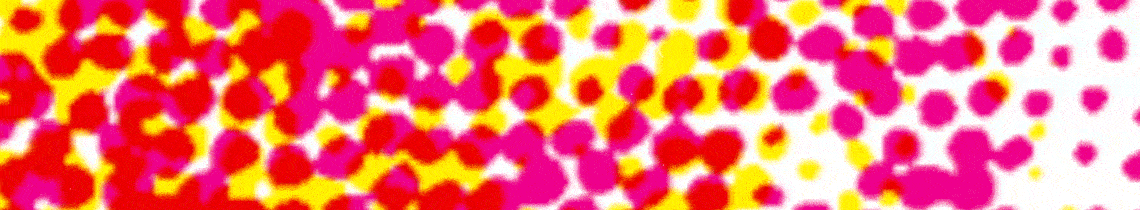Située entre Kyûshû et Okinawa, l’archipel d’Amami ne manque pas de charme à l’instar de cette île.
Au visiteur étranger qui s’aventure sur cette petite île de l’archipel d’Amami, il est souvent demandé : “mais qu’êtes-vous donc venu faire à Kikai, il n’y a rien ici !? Même les Japonais ne viennent pas !”
Il est vrai que Kikai est une île qui se mérite. Le ferry qui la relie cinq fois par semaine à partir de Kagoshima, quitte le grand port du sud de Kyûshû à 17h30 pour n’arriver que le lendemain à 4h30. Onze heures sur une mer souvent très agitée pour se retrouver au petit matin sur une île encore plongée dans le noir et endormie.
L’archipel d’Amami est un groupe d’îles formant la partie nord des îles Ryûkyû, entre Kyûshû et Okinawa. L’île de Kikai a fait partie du royaume de Ryûkyû jusqu’en 1609, date à laquelle elle est passée sous domination du domaine de Satsuma. En 1871, après l’abolition du système des domaines féodaux, l’île a rejoint la préfecture de Kagoshima. Malgré de belles falaises recouvertes d’une végétation dense, Kikai est une île corallienne relativement plate, en témoigne son point culminant situé à 214 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Les îles de la chaîne d’Amami sont communément classées par leurs habitants en deux catégories : celles, majoritaires, où le redoutable habu, une grande vipère venimeuse, est endémique et celles qui, comme Kikai, n’ont pas à se soucier des serpents. Autrefois, les décès dus à une morsure de habu étaient fréquents. Son venin, actif en permanence, peut entraîner la perte d’un membre même plusieurs décennies après la morsure, et ce malgré les traitements. Le habu, qui peuple tout l’archipel des Ryûkyû, fut auparavant révéré comme un dieu de la forêt, symbole de la connexion sacrée des îles avec la nature. Mais de nos jours, la préfecture de Kagoshima encourage l’élimination des serpents, qui jouent pourtant un rôle important dans la chaîne alimentaire, en offrant 3 000 yens par prise. Les habu sont aussi considérés comme les protecteurs des forêts et de la nature dans le sens où ils ont longtemps empêché l’homme d’y pénétrer. Les îles où règnent les serpents ont conservé de grandes forêts primaires, d’une exceptionnelle diversité écologique. Au contraire, l’absence de habu à Kikai a permis à l’agriculture de se développer et l’île a été transformée au fil du temps par et pour les agriculteurs.
Ses terres arables, riches en minéraux, permettent de produire du sésame blanc, dont
Kikai s’enorgueillit d’être le premier producteur national, d’excellentes bananes, des fruits tropicaux, mangues ou fruits de la passion et, surtout, de la canne à sucre. Autrefois, cette dernière était produite pour le fief de Satsuma, tant et si bien que les habitants d’Amami qui la produisaient n’avaient pas le droit d’en goûter le sucre. La grande majorité de la surface de la petite île, qui ne fait que treize kilomètres de long et quatre de large, est aujourd’hui consacrée à la production de sucre de canne. D’importants fonds publics ont été investis dans la construction d’un système d’arrosage complexe et de larges réservoirs d’eau pour cette mono-culture, imposée par le gouvernement pour des motifs de rentabilité économique. Contrairement au riz ou aux cultures de subsistance, qui ont progressivement disparu, la canne à sucre résiste bien aux typhons, très réguliers à Amami. Même après le passage de la pire des tempêtes, il est encore possible de récolter la plus grande partie des cannes couchées à terre par les vents violents.

Le paysage typique de Kikai est donc constitué de vastes champs rectilignes de cannes, une belle plante qui atteint plus de deux mètres de hauteur. La culture artisanale de sésame blanc est une des autres traditions locales, mais la plante est elle, très sujette aux intempéries, et les quantités produites relativement modestes. Ainsi les confiseries à base de sésame, omiyage (souvenir) populaire de l’île, sont confectionnées avec du sésame importé du Pérou ou de Bolivie. Si l’agriculture a prospéré, c’est aux dépens du milieu naturel, la préservation de l’environnement n’ayant jamais été une priorité.
Longtemps considérées comme le bien le plus précieux de l’île, presque toutes les sources naturelles d’eau sont aujourd’hui polluées par les pesticides, ne laissant qu’une seule encore potable, au grand désarroi des habitants. Il n’est pas rare non plus de voir de majestueux gajumaru, le banyan géant chinois (ficus microcarpa), pourtant l’arbre choisi comme symbole de l’île, méchamment amputé par les services de la voirie ou les agriculteurs.
Par le passé, à Amami, chaque ménage possédait une porcherie dans son jardin. Les porcs étaient nourris avec les restes de nourriture, les déchets végétaux et le son de riz des champs. La pratique a disparu dans les années 1960, par contre, de nombreux habitants élèvent toujours des chèvres dont la viande occupe encore aujourd’hui une place importante dans les plats traditionnels. Ces dernières étant nourries de plantes sauvages, aux vertus médicinales, leur viande est considérée comme fortifiante et bénéfique pour la santé, car elle absorbe indirectement les effets des plantes. Elle est consommée surtout après le printemps, le plat le plus populaire étant la soupe salée à la viande de chèvre.
À Kikai, où les jours sans pluie sont rares et où seules la pêche et l’agriculture permettent de subsister, l’isolement sur un minuscule rocher de corail a façonné le caractère de ses six mille habitants. Ils vivent depuis des générations repliés sur de petites communautés soudées. Les nombreuses festivités saisonnières, qui rythment le calendrier insulaire, sont une bonne occasion de découvrir les traditions conviviales et la remarquable hospitalité des gens de l’île. Lors de danses festives traditionnelles, lentes et répétitives, au son du tambour et du sanshin, l’instrument par excellence des Ryûkyû et précurseur du shamisen japonais, de grands cercles se forment et le village entier se retrouve.

Kikai, posé tout au bord de l’immense océan Pacifique, avec son panorama ouvert sur une étendue d’eau infinie, est aux premières loges en cas de typhon. Comme dans tout l’archipel des Ryûkyû, les habitations et les cultures sont traditionnellement protégées des vents destructeurs par de massifs murs de pierres. Kikai étant un plateau corallien, ces murs ont la particularité d’être faits de coraux, c’est d’ailleurs la principale attraction du village d’Aden, situé sur la côte est de l’île, car ils y sont assez bien préservés. Dans ces imposants murs de pierre sont parfois incrustés d’étonnantes bornes en pierre, les ishigandô. Il s’agit à l’origine d’une coutume chinoise originaire de la province de Fujian. Ces tablettes ornementales, sur lesquelles sont inscrits les idéogrammes chinois 石敢當 pour exorciser les mauvais esprits. On peut aussi trouver ces pierres mystérieuses dans le reste du monde chinois et dans tout le Japon, mais elles sont particulièrement nombreuses à Okinawa et Amami. Elles sont souvent placées aux intersections de rues, en particulier aux croisements, qui sont souvent considérés comme un endroit spirituellement dangereux. Sur l’île de Kikai, certaines de ces pierres se sont creusées au fil des siècles d’empreintes de doigts, l’on suppose qu’autrefois les habitants signaient ces pierres magiques lorsqu’ils passaient devant pour se protéger du mauvais sort.
La monotonie des champs de canne à sucre et des routes rectilignes est parfois interrompue par des monticules qui n’ont pu être aplatis et transformés en terre agricole. Ce sont des formations rocheuses qui sont recouvertes de grands arbres, et où personne ne semble s’aventurer. Ces endroits mystérieux abritent souvent des muya, des tombes horizontales creusées sous une falaise dans lesquelles le corps des défunts était déposé. Il s’agit d’une ancienne coutume d’inhumation par exposition aux éléments, dite fûsô, littéralement funérailles au vent, courante dans tout le royaume des Ryûkyû, du Moyen-Âge jusqu’au XXe siècle. Depuis l’établissement d’un crématorium en 1966, l’incinération a entièrement remplacé cette coutume, mais ces tombes, et les ossements et poteries qu’elles abritent, sont encore visibles dans tous les recoins de l’île.
Le culte des ancêtres et le culte animiste de la nature représentaient les principales croyances des habitants de Kikai, les rituels religieux étant dirigés, comme à Okinawa, par des prêtresses, les Noro. Les gens du peuple faisaient appel à des Yuta, des chamanes, pour résoudre leurs problèmes spirituels et prendre conseil.
Les contes et légendes, souvent terrifiants, ont forgé l’âme des habitants et certaines superstitions ancestrales perdurent. Ainsi, à l’entrée du sanctuaire Sumiyoshi d’Aden se trouve un grand rocher, dans les aspérités duquel sont disposées d’innombrables petites pierres blanches. La pratique remonte à une légende très ancienne qui raconte que la malédiction serait tombée sur une famille qui avait placé une pierre sacrée dans un endroit impur, la porcherie de leur maison. On raconte que si un enfant, ou une personne transportant de la viande, passe devant le grand rocher, l’esprit maléfique prendrait le dessus, il leur faut donc le contourner. Les autres personnes peuvent passer devant, mais en plaçant un caillou dans un des creux du rocher et en le vénérant, ce que, de nos jours encore, chacun s’empresse de faire.
S’il n’y a rien à Kikai pour attirer les circuits touristiques, elle offre néanmoins aux voyageurs éclairés d’autres surprises, comme une route des papillons, la présence de nombreuses tortues de mer qui viennent se nourrir sur le récif de corail, ou encore la chance d’entendre le cri formidable du pigeon vert des Ryûkyû, un oiseau rare que l’on trouve à Amami et Okinawa, seule espèce de pigeon connue comme étant endémique au Japon. L’île a préservé son atmosphère authentique et paisible, propice aux rencontres sincères et à la découverte d’une culture très différente de celle du Japon des cartes postales.
Eric Rechsteiner

S’y rendre
En bateau : ferry Kagoshima-Kikai, cinq fois par semaine, onze heures de traversée et entre 9 000 et 18 000 yens, selon la classe.
Par avion : vols ANA, JAL, Skymark et Peach de plusieurs grandes villes du Japon jusqu’à Amami-Ôshima, puis liaison jusqu’à Kikai, le vol de ligne le plus court du Japon, 26 kilomètres en environ 15 minutes.