
Pour ses 80 ans, le romancier, poète, essayiste et traducteur livre son regard sur huit décennies d’histoire de son pays.
Durant quarante années d’écriture depuis la parution en 1984 de son premier roman Natsu no asa no seisôken [La stratosphère des matins d’été, inédit en français], une adaptation personnelle de Robinson Crusoé, Ikezawa Natsuki a publié une trentaine de romans et recueils de nouvelles, près d’une dizaine de recueils de poésies ainsi que de très nombreux essais critiques tant sur des questions de société que littéraires.
Ses textes, toujours parfaitement documentés, scientifiquement et historiquement, brouillent les pistes du réel et de l’imaginaire pour poser des questions métaphysiques.
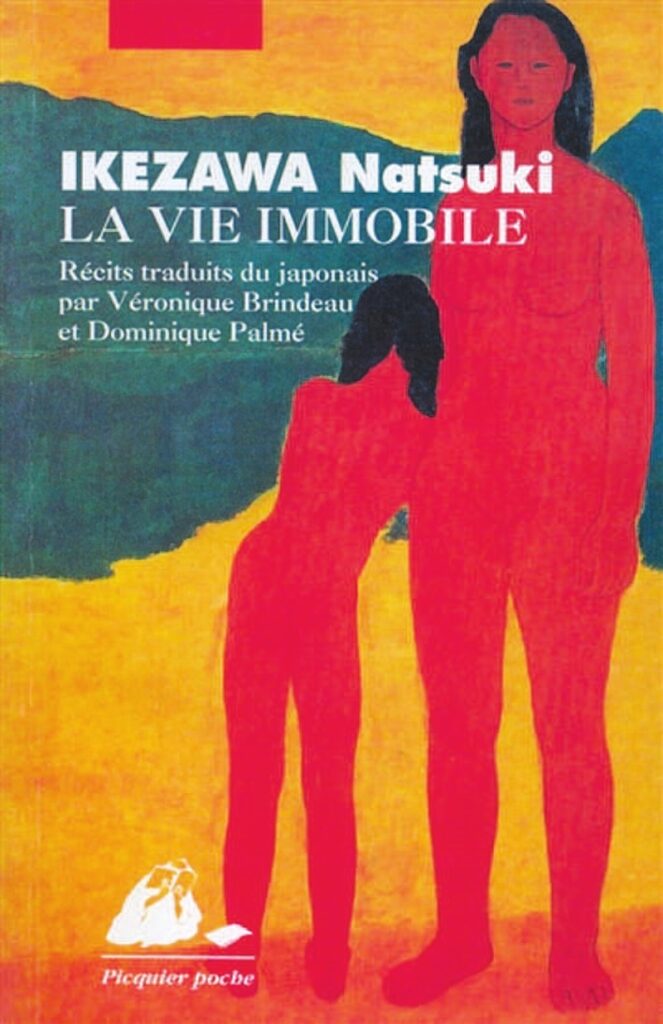
Son père, Fukunaga Takehiko, est un des romanciers les plus célèbres des années 1950-60, traducteur de Sartre et Baudelaire, et sa mère, poète, publie sous le nom de Harajô Akiko. A partir de l’âge de 6 ans, le jeune Natsuki sera élevé à Tôkyô par le second mari de sa mère dont il porte le patronyme, Ikezawa. Après des études de physique qu’il abandonne avant d’obtenir un diplôme, il vit un temps en traduisant des auteurs tels que Kurt Vonnegut, John Updyke, Jack Kerouac, Richard Brautigan et en écrivant des poèmes et des critiques littéraires. Dans sa vingtième année il commence à voyager, d’abord en Micronésie, puis, passionné par la civilisation grecque, il part y vivre entre 1975 et 1978. De retour au Japon, il fait la traduction pour les sous-titrages des films de Theo Angelopoulos. En 1987, avec La Vie immobile (Sutiru raifu, Editions Picquier), il obtient le prestigieux Prix Akutagawa dont il sera plus tard juré pendant quelques années. De nombreux autres prix littéraires suivront, parmi lesquels le prix Mainichi pour La Sœur qui portait des fleurs (Hana o hakobu imôto, éditions Picquier). En 1994, il s’installe à Okinawa d’où il peut exercer ce regard “décentré” très personnel qu’il définit comme “un moyen d’examiner la civilisation contemporaine en sortant du cadre et en élargissant la perspective”. Immédiatement après l’attentat du 11 septembre 2001, il publie quotidiennement sous forme de courts essais ses réflexions sur l’évolution du monde sous le titre Bienvenue dans ce nouveau monde. Il poursuivra cette publication jusqu’en 2003. En 2002, après un séjour en Irak pour des recherches sur la civilisation mésopotamienne, il publie en lecture libre, sur Internet, Sur un petit pont en Irak (Iraku no chîsana hashi o watatte), récit d’un voyage pour “savoir sur qui tomberaient les bombes dans le cas où il y aurait une guerre”. Après un séjour en France, à Fontainebleau, entre 2004 et 2008, il retourne dans son pays natal : Hokkaidô et, récemment, il s’installe à Azumino dans la préfecture de Nagano. Son anthologie personnelle de la littérature mondiale (Sekai bungaku zenshû) en 30 volumes qu’il dirige entre 2007 et 2011 aux éditions Kawade Shobô Shinsha rencontre un tel succès que le même éditeur lui propose de publier une anthologie personnelle de la littérature japonaise (Nihon bingaku zenshû) : 30 volumes sont ainsi parus entre 2014 et 2018.
Avant que vous nous disiez ce que vous pensez du Japon d’aujourd’hui racontez-nous un peu votre vie car la suivre, c’est aussi voir une partie de l’histoire japonaise de l’après-guerre. Qu’est-ce qui vous semblerait définir cette époque ?
Ikezawa Natsuki : Une différence fondamentale par rapport à l’avant-guerre, c’est que le Japon a cessé d’être un envahisseur. Pendant toute ma vie, à part les quelques jours qui ont suivi ma naissance, le Japon n’a jamais fait la guerre.
Et puis, il y a eu la Constitution. En 2003, face aux polémiques qui reprenaient de la vigueur concernant sa révision, j’ai proposé de revenir au texte anglais de base et d’en faire une nouvelle traduction en japonais moderne, plus facilement accessible à tous et j’ai publié Kenpô nante shiranai yo to iu kimi no tame no Nihon no kenpô [Toi qui dis : La Constitution ? Connais pas ! Alors ce livre est pour toi, Home-sha 2003, inédit en français]. La Nouvelle Constitution a été promulguée en 1952, quand j’étais en primaire. Depuis l’enfance, ce texte m’était familier et je le lisais de temps en temps. Mais c’est en faisant ce travail de traduction que j’en ai vraiment saisi le sens et la valeur. Le texte anglais qui a servi de base inclut des concepts développés par les sociétés européennes tels que les droits de l’homme, la nation, la société, la loi. La Constitution japonaise est ainsi basée sur la pensée du philosophe anglais John Locke, sur l’esprit de la Révolution française et l’idée de philanthropie et de tolérance défendue par le président américain Abraham Lincoln dans le fameux discours de Gettysburg en 1863. Plutôt qu’un texte rédigé spécifiquement pour le seul Japon, c’est un texte littéraire basé sur des valeurs universelles de la modernité globale. C’est parce que le Japon l’a adopté qu’il a pu retrouver une place dans la société internationale, y être reconnu, se reconstruire et mener son développement économique. Pour éviter que le gouvernement s’oriente de nouveau vers une dictature, les auteurs ont pris soin de donner au peuple la possibilité de contrôler le pouvoir de l’Etat par la loi.
Quels sont vos premiers souvenirs ?
I. N. : Je suis né à Otaru, sur l’île de Hokkaidô, mais à partir de 6 ans j’ai vécu dans les environs de Tôkyô avec ma mère et son second mari dont j’ai pris le nom, Ikezawa. Peu à peu, la vie quotidienne se stabilisait socialement, et familialement pour moi. Mais la guerre n’était pas très loin. Le Japon était sous occupation américaine et, dans un camp militaire proche, on entendait les coups de fusil des entraînements. Pendant la guerre de Corée, j’ai aussi vu passer des chars dans la rue. On savait que des avions décollaient régulièrement d’Okinawa.
Pendant le primaire, nous vivions à l’étroit, comme tout le monde nous étions pauvres. Ma mère qui maîtrisait l’anglais a travaillé un moment comme vendeuse dans un magasin sur une base militaire américaine.
A cause du baby-boom, les classes surchargées étaient divisées en deux, un groupe suivant les cours le matin, l’autre l’après-midi. Le sport et les sorties scolaires sont redevenus pratiques courantes. Un de mes grands plaisirs, c’était les livres. Tous les éditeurs publiaient des collections de plusieurs dizaines de volumes. Par exemple La Littérature du monde pour garçons et filles en 50 volumes parue entre 1953 et 1956. Des textes tels que Le Tour du monde en 80 jours, L’Ile au trésor, Robinson Crusoë, Peter Pan, Les voyages de Gulliver étaient traduits par d’illustres traduteurs. Il y a eu aussi les 16 volumes de la collection de Livres illustrés du monde et les 30 volumes de La littérature jeunesse du monde. A partir de 1959 beaucoup de périodiques pour enfants et adultes étaient aussi publiés.
Quand j’étais au lycée, les manifestations contre le Traité de sécurité nippo-américain se multipliaient déjà et les polémiques sur la Constitution que certains disaient produite par les étrangers étaient courantes, mais, en même temps, le cinéma américain était très présent :
Vacances romaines présenté dès 1954, West Side Story etc. Avec ma classe, en 1954, nous sommes allés voir Le magicien d’Oz. Mon premier livre lu en anglais fut A l’est d’Eden (East of Eden) de John Steinbeck ; le film avait été présenté au Japon dès 1955. Je l’ai vu plus tard, plusieurs fois.

Comment êtes-vous devenu l’écrivain prolixe que vous êtes ?
I. N. : J’ai quitté l’université avant l’obtention d’un diplôme, en 1969. Je faisais des traductions de l’anglais pour gagner ma vie, mais aussi pour comprendre comment on écrit un roman. La période de haute croissance était une époque favorable pour l’édition et aussi pour les reportages et les voyages… En 1970, l’archipel d’Okinawa était restitué au Japon et les relations avec la Chine rétablies. En 1972, j’ai découvert la Micronésie, j’avais 27 ans et à partir de là je ne cesserai plus de voyager dans tous les continents, à commencer par Okinawa, l’Inde, le Sri Lanka. L’époque où l’idée de “monde” se limitait à l’Amérique et aux principaux pays européens a pris fin après la Seconde Guerre mondiale et la terre entière a commencé à être vue comme un seul monde. En même temps que l’ère impérialiste prenait fin, j’ai donc commencé à voyager et j’ai toujours été attiré non par les pays développés, mais par les “îles entourées par la mer”, les lieux dits “en voie de développement”, les petites communautés. A l’époque, beaucoup de voyageurs allaient en Europe ou aux Etats-Unis, mais j’avais l’impression de pouvoir me représenter sans grande suprise dans ces lieux touristiques et je ne voyais pas l’intérêt de faire ce que tout le monde faisait… Je suis souvent allé à Hawaï, en Alaska, en Arizona, mais je ne suis encore jamais allé à New York, par exemple.
A 30 ans, je suis parti vivre en Grèce et y suis resté 3 ans. Mais le retour dans la société de consommation de Tôkyô a été un fort choc culturel. J’ai connu ce que j’appelle “le traumatisme du trop de bonheur” : en Grèce j’avais vécu tellement de riches expériences et à un rythme qui me convenait si bien. Et puis le Japon avait bien changé pendant que j’étais au loin : j’y découvrais la pop culture, l’armée rouge, le scandale Lockheed, le jeunisme qui commençait à se développer.
En 1987, mon deuxième roman La Vie immobile a reçu le prix Akutagawa, mais il était loin d’atteindre les millions de ventes de La Ballade de l’impossible (Noruwei no mori) de Murakami Haruki ou Kitchen (Kicchin) de Yoshimoto Banana parus vers la même époque.

