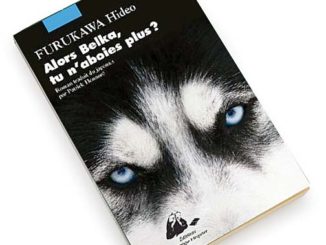Catherine Cadou a côtoyé le réalisateur pendant des années. Elle termine un documentaire qui lui est consacré.

Que reste-t-il de Kurosawa aujourd’hui ? C’est précisément le thème du film que j’ai entrepris de tourner douze ans après sa mort, à l’occasion du centième anniversaire de sa naissance. Ayant été son interprète et la traductrice de ses films pendant ses quinze dernières années de création, j’ai eu la grande chance de le côtoyer presque au quotidien. Il m’est donc difficile d’admettre les clichés les plus communément colportés à propos de ce géant qui était surtout et avant tout un cinéaste intrépide et obstiné. L’idée de mon film Kurosawa la voie m’est venue il y a précisément un an, lors du Festival de Venise 2009. Pour inaugurer l’année du Centenaire du cinéaste, on y avait organisé un symposium avec tous les docteurs es-Kurosawa qui, en accord avec la vox populi, glosaient sur la disparition du réalisateur du radar des jeunes Japonais en âge d’aller au cinéma. C’est alors qu’un « jeune » cinéaste japonais plutôt timide s’est fait violence et a levé la main pour intervenir et protester. Il raconte dans mon film : « Presque malgré moi, j’ai levé la main, me suis présenté et, le cœur battant, et dans une tension extrême, tremblant comme une feuille, j’ai parlé très brièvement (une minute) de mon expérience Kurosawa ». Il a conclu son intervention vénitienne, en disant que tout son cinéma était inspiré par cette séance inoubliable où il avait vu Les Sept samouraïs sur un écran géant dans sa version intégrale de plus de trois heures. Ce cinéaste, c’est l’auteur des Tetsuo, Tsukamoto Shin’ya, l’idole des jeunes amateurs de films cultes du Japon, de France et d’ailleurs. En l’écoutant et surtout en voyant vibrer ce disciple improbable d’une incroyable passion pour son grand prédécesseur, j’ai eu envie de lui donner la parole, à lui et à ces cinéastes du monde entier qui brûlent du feu sacré du cinéma et qui ont tous, d’une manière ou d’une autre une dette envers Kurosawa. En effet, Kurosawa, ce n’est pas « seulement » ses films et la façon dont ils ont été ou sont reçus au Japon, hier ou aujourd’hui. Comme le confirme Miyazaki Hayao, également dans mon film, « dire que l’on ne voit plus les films de Kurosawa aujourd’hui au Japon, c’est faux. Tous ceux qui s’intéressent au cinéma voient encore ses films. Le seul problème, c’est qu’il est difficile de les voir sur grand écran. »
En fait, je suis partie d’une histoire simple, celle du premier film de Kurosawa, La Légende du grand judo (Sugata Sanshirô) qu’il a tourné en 1943. Il y raconte l’histoire de celui qui ouvre un michi, une voie, celle de l’agilité, de la souplesse (jû), le judo… En recourant, dès le début, à tous les éléments du langage de son cinéma qu’il a développés et enrichis par la suite, sans se lasser, film après film, Kurosawa a créé une œuvre étonnante, à facettes multiples, si foisonnante qu’il est difficile de savoir laquelle est la plus représentative. Selon les pays, il est plus connu pour ses films en costume ou pour ses films dits sociaux, où il peint magistralement la société japonaise de l’immédiat après-guerre.
Les onze cinéastes que j’ai rencontrés pour mon film, qu’ils soient Japonais, Coréens, Chinois, Iraniens, Grec, Mexicains ou Américains s’accordent pour dire qu’avec sa façon unique de conter les histoires, il a été un de ceux qui ont le mieux incarné le 7e Art. La question n’est donc pas de savoir s’il est encore vu par un public nombreux, mais bien plutôt de se souvenir qu’il est bon de voir ses films, car ils ont encore aujourd’hui quelque chose à nous dire sur nous et nos sociétés.
Catherine Cadou