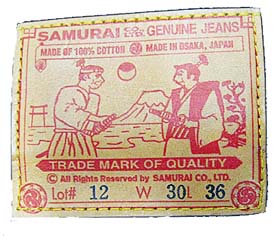Apparemment, le cinéma japonais se porte bien. Une production en hausse, de plus en plus d’écrans. Mais que cache cette réalité ?

L’avènement du numérique a très sensiblement diminué les coûts de production et favorisé l’émergence de nouveaux réalisateurs. Toutefois, une bonne partie des films que l’on diffuse aujourd’hui dans les salles de cinéma sont des productions bas de gamme qui tendent vers une certaine uniformisation. Désormais, on ne présente pratiquement plus d’œuvres originales et innovantes comme il en existait à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Depuis que j’ai réalisé Dogra Magra en 1988, les possibilités de tourner se sont évanouies pour moi”. C’est en ces termes que le cinéaste Matsumoto Toshio, une des figures de l’ATG (Art Theatre Guild of Japan), résume la situation du cinéma japonais actuel. La Maison de la culture du Japon à Paris lui rend notamment hommage du 7 juin au 23 juillet dans le cadre d’un cycle consacré à cette association de cinéastes qui a beaucoup contribué à l’exploration de nouveaux territoires cinématographiques.
De plus en plus de films produits chaque année
Comme d’autres, Matsumoto Toshio constate avec un peu d’amertume les changements observés au cours des deux dernières décennies et qui ont totalement bouleversé le monde du cinéma. D’une part, le nombre d’écrans a pratiquement doublé en 20 ans. En 1990, on en avait recensé 1 836. Fin 2010, ils étaient 3 412 dans tout l’archipel. Cette inflation d’écrans s’explique en grande partie par la multiplication des complexes cinématographiques (shinekon) dont le nombre n’a cessé de croître depuis 2000. A l’époque, sur les 2 524 écrans, 1 123 appartenaient à des complexes. A la fin de l’année dernière, sur les 3 412 écrans, 2 774 faisaient partie d’établissements multi-salles où l’on se rend pour voir des films, mais surtout consommer des spectacles dont Matsumoto Toshio dénonce le côté uniforme. Parallèlement à l’augmentation du nombre d’écrans, on a constaté un quasi doublement des sorties de films japonais. En 1990, il y en avait eu 239. Vingt ans plus tard, 408 productions japonaises ont été projetées dans les salles obscures de l’archipel. Dans le même temps, le nombre de films étrangers distribués a baissé, passant de 465 en 1990 à 308 en 2010. A première vue, c’est une bonne nouvelle de voir les productions nationales supplanter les œuvres venues d’ailleurs (essentiellement de Hollywood). En d’autres termes, la part du cinéma japonais est aujourd’hui de 53,6 % contre 41,4 % en 1990. Cette évolution qui a permis aux productions nippones de reprendre des parts de marché s’explique notamment par une mutation des modes de financement du cinéma. Outre l’arrivée des chaînes de télévision toujours en quête de programmes pour compléter leurs grilles, on a vu émerger les comités de production (seisaku iinkai) au sein desquels on retrouve plusieurs investisseurs désireux de mutualiser les coûts. C’est en soi une bonne chose, mais rien ne permet d’affirmer que ce nouveau mode est bon pour le cinéma. En effet, la formule est une garantie pour les investisseurs qui n’ont pas à s’engager de façon excessive au niveau financier. Mais ces derniers souhaitent, compte tenu du système de distribution axé sur les complexes cinématographiques, que les films produits attirent le plus grand nombre et soient une source de profits. C’est pourquoi bon nombre des longs métrages qu’ils financent sont des adaptations de manga à succès (voir Zoom Japon n°2, juillet-août 2010) sous forme de dessins animés ou de fictions. L’un des derniers exemples en date est Gantz Perfect Answer de Satô Shinsuke avec Matsuyama Kenichi. Adapté de la série à succès signée Oku Hiroya [éd. Tonkam], le film est sorti le 23 avril, attirant quelque 424 000 spectateurs et générant plus de 550 millions de yens de recettes au cours des deux premiers jours de son exploitation. Même si tout le monde s’accorde pour dire que le film n’est pas une réussite cinématographique, la formule a une nouvelle fois fonctionné, ce qui n’est pas sans agacer certains observateurs comme Saitô Morihiro. Celui-ci dénonce depuis plusieurs années l’appauvrissement du cinéma japonais et un système pernicieux à long terme. A force de présenter des films conçus selon des recettes purement commerciales, leur contenu s’appauvrit, ce qui contribue à faire disparaître l’originalité des salles de cinéma. Voilà le défi auquel le 7ème Art japonais est confronté et qu’il va devoir relever s’il ne veut pas finir par disparaître. En effet, d’un point de vue technique, la plupart des films produits dans l’archipel sont irréprochables. Les techniciens japonais sont de grands professionnels et bon nombre des jeunes réalisateurs ont été formés dans la pub ou à la télévision. Ils savent parfaitement rester dans les clous en ce qui concerne les budgets et construisent leurs œuvres comme s’ils tournaient un téléfilm. Voilà qui satisfait les producteurs parmi lesquels figurent bien souvent des chaînes de télévision qui trouvent ainsi des contenus pour leur grille de programmes. Les distributeurs ne s’en plaignent pas non plus. Eux qui participent aussi aux comités de production ont l’assurance que les films seront d’un point de vue commercial presque sans risques. Bref tout le monde s’y retrouve, y compris les spectateurs (jeunes dans leur majorité) qui découvrent sur grand écran des longs métrages adaptés de leurs mangas préférés avec des acteurs qu’ils ont déjà pu apprécier dans des films publicitaires ou sur le petit écran. Le seul perdant dans l’histoire, c’est le cinéma qui finira par ne plus avoir la capacité de surprendre et d’innover. Bien sûr, il existe encore des cinéastes qui osent et qui font des films innovants. Mais ils n’ont guère les moyens d’être vus en dehors de petits cercles. Or un film qui n’a pas la possibilité d’être diffusé parce qu’il ne satisfait pas au mode de fonctionnement actuel constitue une perte à long terme pour le cinéma dans son ensemble. Une conclusion qu’un réalisateur aussi talenteux que Matsumoto Toshio ne démentira pas.
Odaira Namihei