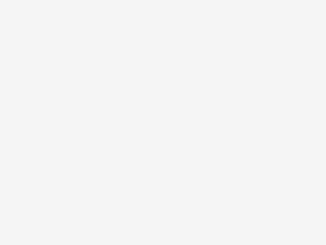Ômiya Kôichi raconte le tournage de son documentaire sur le séisme du 11 mars qui sera projeté le 15 octobre à La Pagode.

Qu’est-ce qui vous a poussé à réaliser ce film ?
Ômiya Kôichi : Je suis moi-même originaire du Tôhoku, la région frappée par le séisme du 11 mars. Mes parents y vivent encore. Si le tremblement de terre avait eu lieu dans une autre partie du pays, j’aurais peut-être réagi autrement. Je me suis rendu une fois dans la région avant le tournage de Mujô Sobyô [無常素描, Esquisse de l’impermanence]. Deux semaines après le séisme, je me suis rendu en compagnie d’un preneur d’images chez des connaissances dans la préfecture d’Iwate qui a subi d’énormes dommages. Mais à ce moment-là, nous n’avons tourné que quelques heures, puis nous sommes partis. Et puis, nous ne pouvions pas séjourner plus longtemps. “Pourquoi ? Pourquoi ne pouvions-nous pas continuer à tourner ? C’est quelque chose dont je veux m’assurer”, me suis-je alors dit. C’est une de mes premières motivations pour ce projet. J’avais aussi la sensation que la mémoire de ceux qui avaient quitté les zones sinistrées s’estomperait peu à peu. J’avais même le sentiment qu’ils voulaient tout oublier. J’étais moi-même dans les mêmes dispositions. La peur de l’oubli constitue une autre des raisons qui m’ont amené à tourner Mujô Sobyô. En définitive, ce sont des motivations très personnelles qui sont à l’origine de ce documentaire. Fin avril, 49 jours après la catastrophe, j’ai repris la route du nord-est. Selon les rites bouddhistes, le 49ème jour est aussi le jour où l’on prie pour le salut de l’âme des morts. Mujô Sobyô, c’est donc l’enregistrement des voix des sinistrés une cinquantaine de jours après le séisme. Aujourd’hui, plus de six mois après avoir terminé ce film, je n’arrive toujours pas à oublier ces images. Je n’ai pas d’autre choix que de les accepter. Je crois que mes premières réactions qui ont consisté à vouloir quitter les zones sinistrées et à chercher l’oubli étaient liées au fait que je ne pouvais pas accepter la réalité du tremblement de terre.
Pouvez-vous nous raconter comment vous avez vécu la journée du 11 mars ?
Ô. K. : Le 11 mars, je passais une journée tranquille à mon bureau de Tôkyô quand le séisme s’est produit à 14h46. Les Japonais sont habitués aux tremblements de terre. La secousse forte et longue de ce jour-là n’a pas été extraordinaire. Pourtant, elle a suscité un sentiment de peur. De nombreuses personnes sont sorties et se sont rassemblées sur les parkings. “Puis-je vous tenir la main ?” m’a demandé une femme que je ne connaissais pas. Nous sommes restés sur le parking main dans la main. En regardant les fils électriques s’agiter comme des cordes à sauter dans le ciel azur, je me souviens de m’être demandé si ce n’était pas la fin… La secousse a peut-être duré trois minutes. J’ai reçu un message de ma femme inquiète, me demandant de la contacter rapidement. J’ai remis un peu d’ordre dans le bureau avant de partir à pied chez moi. Sur le chemin du retour qui m’a pris 4 heures à pied, j’ai appris à la radio qu’un gigantesque tsunami avait déferlé. “Eloignez-vous des zones côtières ! Eloignez-vous des zones côtières !” ne cessait de répéter d’une voix froide l’animateur radio. Une fois arrivé à la maison, je me suis collé devant mon téléviseur sans pouvoir en bouger. Il y avait encore peu d’informations en provenance du nord-est. On parlait surtout des difficultés que les Tokyoïtes rencontraient pour rentrer chez eux et de l’explosion dans une raffinerie. A la tombée de la nuit, les images des régions touchées par le tsunami ont commencé à être diffusées. Celles qui m’ont le plus impressionné, ce sont les quartiers qui flambaient dans la nuit. Au lieu de voir de l’eau comme on aurait pu s’y attendre après un tsunami, c’est le feu qui dominait. Ce n’était pas seulement la ville qui brûlait, la mer elle aussi était en flammes. C’était littéralement une mer de feu. Le commentateur qui présentait ces images prises d’hélicoptère a expliqué qu’il s’agissait de la ville de Kesennuma dans la préfecture de Miyagi. Pour moi qui ai grandi dans cette région, ce nom a réveillé beaucoup de souvenirs.

Quel est le rôle de l’écrivain Genyû Sôkyû dans votre documentaire ?
Ô. K. : Je souhaitais faire intervenir une personne capable de parler de cette catastrophe, mais cela ne pouvait pas être un homme politique ni un scientifique. Cela a été très important pour le film d’obtenir le soutien de Genyû Sôkyû. Il est aussi moine. Le bouddhisme est une religion, mais de façon générale, les Japonais ne manifestent guère d’intérêt pour la religion. Cela dit, dans le Tôhoku, c’est moins le caractère religieux du bouddhisme que sa spécificité locale qui importe dans la mesure où il est vécu comme faisant partie d’un cycle de vie. Par ailleurs, le temple est un des éléments centraux de la communauté locale. Aussi cela a été une expérience très enrichissante de pouvoir nous rendre dans le temple où Genyû Sôkyû exerce sa charge. L’une des particularités de cette tragédie, c’est le faible nombre de blessés. C’est comme si cela s’était seulement résumé à une question de vie ou de mort. La mort a ravi de nombreuses vies. Quelque 15 000 personnes sont décédées et près de 5 000 autres sont encore portées disparues. Notre capacité à continuer notre vie est liée à la façon dont nous appréhendons tous ces morts. Face à cette catastrophe naturelle pour laquelle personne n’est fautif, les Japonais se sont retrouvés désemparés. La présence de Genyû Sôkyû est une réponse à cette situation. Le film commence avec lui, mais nous avons tourné l’entretien le dernier jour. Ce que nous avions enregistré jusque-là nous avait laissé un sentiment d’impuissance. Il nous a donc semblé important de commencer avec lui.
Pour quelles raisons avez-vous décidé de ne pas indiquer les noms des lieux et des personnes rencontrées dans votre film ?
Ô. K. : En supprimant ces informations, j’ai voulu donner un caractère universel au documentaire. Il est vrai que ce genre de données a son importance lorsqu’on veut distinguer un lieu d’un autre ou une personne d’une autre. C’est justement ce que je voulais éviter. Je souhaitais montrer que ce que nous avions sous les yeux avait touché indifféremment les personnes et les lieux. J’ai tourné Mujô Sobyô comme s’il s’agissait de montrer des images de guerre.
Quelles ont été vos impressions lorsque vous avez commencé à tourner dans ces régions dévastées ?
Ô. K. : Comme je vous le disais tout à l’heure, je m’étais déjà rendu dans les zones sinistrées juste après le séisme. Je pensais donc que j’y retournerais avec un certain degré d’immunité, mais ce ne fut pas du tout le cas. J’ai été une nouvelle fois accablé devant ce qui s’offrait à mes yeux. Au milieu de la désolation qui régnait partout, j’ai été particulièrement marqué par le chant des oiseaux, le bruit du vent et celui des vagues qui brisaient le calme environnant. J’avais devant moi un espace à l’intérieur duquel la vie quotidienne avait disparu. Ce qui en restait se résumait à des monceaux de gravats, empilement de morceaux de vie dont il fallait désormais se débarrasser. Je ne peux pas non plus oublier ce sentiment de malaise lorsque je tombais sur un bateau au sommet d’une colline et qu’au loin on pouvait voir des navires sur une mer d’huile. Les bateaux sont faits pour être sur la mer, bon sang…
Quelle a été votre rencontre la plus émouvante pendant le tournage ?
Ô. K. : J’ai été profondément touché par les fleurs qui éclosaient au milieu des gravats, les canards qui circulaient paisiblement au pied d’un pont à moitié écroulé, les expressions et les voix de tous les sinistrés que j’ai rencontrés, l’air et les odeurs que l’on ne peut pas enregistrer sur un film. Au Japon, il existe l’expression ichigo ichie (一期一会) selon laquelle “la rencontre que l’on fait aujourd’hui peut être la dernière”. Cela traduit bien la notion d’impermanence (mujô).
Propos recueillis par Odaira Namihei
Zoom Japon refait son cinéma
Pour la seconde année, Zoom Japon en partenariat avec le mythique cinéma La Pagode vous propose Rendez-vous avec le Japon. Chaque second samedi du mois, nous vous proposons de partir à la découverte de la société japonaise avec des inédits, des avant-premières et des classiques. A l’issue de chaque projection, un spécialiste vient partager ses connaissances en fonction de la thématique abordée dans le film. Au programme des trois premières séances de la saison 2 :
Le 15 octobre à 11h, Mujô Sobyô de Ômiya Kôichi en présence de Keiko Courdy, réalisatrice du Japan Webdoc Project. Le 12 novembre à 10h30, avant-première de Colorful de Hara Keiichi avec la participation de Ilan Nguyen, lecteur à l’Université des arts de Tôkyô. Le 10 décembre à 11h, Il était un père de Ozu Yasujirô analysé par la sociologue Ôshima Hiroko.