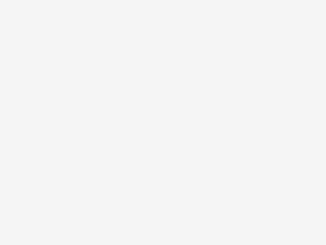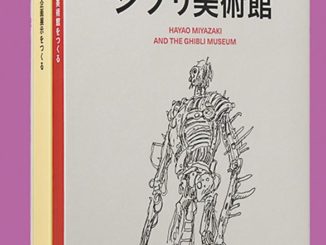Installée en Italie, la mangaka a justement choisi un personnage italien pour explorer l’histoire moderne du Japon. Passionnant.

L’éditeur Rue de Sèvres publie dans les prochains jours le premier volume de Giacomo Foscari, œuvre magistrale de l’excellente Yamazaki Mari rendue célèbre par Thermae Romae. Dans cette nouvelle série, l’artiste aborde la question de l’identité et explore l’histoire du Japon d’après-guerre au tournant des années 1960 à travers les yeux d’un enseignant italien. Une formidable leçon dont Zoom Japon vous offre en exclusivité les premières pages sur son site Internet : www.zoomjapon.info. Yamazaki Mari a répondu à nos questions concernant ce nouvel opus.
Dans votre parcours, vous êtes partie à l’étranger très jeune. Le fait de vous éloigner de votre pays vous a-t-il aidé à voir certains aspects de celui-ci d’un point de vue plus objectif ?
Yamazaki Mari : Oui bien sûr. Ma famille avait déjà beaucoup d’affinités avec les cultures étrangères. Depuis que je suis petite, et même lorsque j’étais encore au Japon, j’entendais ma mère et mon grand-père critiquer la société japonaise, et pointer du doigt ses incohérences. De ce fait, même en étant Japonaise, j’avais sans doute moins la sensation d’être en symbiose avec l’état d’esprit japonais que les autres.
La plupart de vos œuvres traitent des problèmes relatifs à l’identité, Giacomo Foscari (publié dans le mensuel Office You) est sans doute l’une des plus emblématique à ce sujet. Pouvez-vous me dire quel est votre avis sur la question de l’identité ? Y a-t-il une corrélation pour vous entre cette problématique et Tabe Mitsuharu, le personnage inspiré par l’écrivain Abe Kôbô qui apparaît dans votre manga ?
Y. M. : Bien qu’il soit d’origine japonaise, Abe Kôbô a passé son enfance en Mandchourie. Une fois rentré au Japon, on peut dire qu’il n’avait aucune appartenance sociale ou géographique. C’est un homme qui a vécu sans attache, avec une identité confuse. Quant à moi, j’ai également vécu longtemps à l’étranger, notamment en Italie. Quand bien même je suis Japonaise, je n’ai pas vraiment le sentiment d’appartenir à la société nippone. Je dois dire que ma propre identité est également confuse. Un lieu où l’on peut retrouver ses racines… Voilà une chose qui est floue chez moi. A partir du moment où, bien que née à Tokyo, j’ai finalement grandi dans une région où ma mère a préféré s’installer (à Hokkaido), les pistes se sont brouillées, et ce, même à l’échelle de mon propre pays d’origine.
Giacomo Foscari se déroule dans les années 1960, une période clé dans l’histoire moderne du Japon. C’était une époque animée par de vives polémiques politiques, et où le Japon était en plein essor économique. Si vous avez choisi cette période pour votre propre histoire, est-ce dû à la nostalgique de l’ère Shôwa (1926-1989) qui s’exprime dans de nombreux domaines ces derniers temps ? Ou vouliez-vous adresser un message particulier à vos contemporains en leur rappelant cette époque qui a été un tournant majeur pour le pays ?
Y. M. : Après m’être installée en Italie à 17 ans, j’ai rencontré de nombreux étrangers qui m’ont beaucoup marquée. Les milieux que je fréquentais regorgeaient de personnes venant d’horizons divers ; certains étaient originaires d’un pays où se déroulait une guerre civile, d’autres étaient réfugiés politiques… Le fait d’être confrontée à ces réalités sociales a finalement eu autant d’impact sur moi que l’apprentissage de la peinture. Avoir lu la littérature japonaise d’après-guerre à cette même période m’a clairement conduite à m’intéresser particulièrement au Japon des années 60-70. Il est vrai que je suis par ailleurs très attachée à l’ère Shôwa, et que certaines de mes œuvres se déroulent à cette période. Mais ce n’est pas une simple expression de nostalgie. J’ai focalisé mon attention sur cette époque, car il s’agit d’une période qu’il ne faut pas oublier, comme un monument qui sert de repère psychologique.
Depuis la catastrophe du 11 mars 2011, beaucoup de choses sont remises en cause au Japon, que ce soit le système politique, les lois préétablies etc. Je me suis alors demandée si les Japonais d’aujourd’hui n’avaient pas des perspectives semblables à celles qu’avaient les Japonais d’après-guerre, qui avaient, eux aussi, connu un fort traumatisme. Je me suis dit que c’était le bon moment d’apporter ma contribution à la réflexion générale.
En ce qui concerne vos sources d’inspiration pour Giacomo Foscari, je me suis demandé à sa lecture si l’ouvrage Japon de Fosco Maraini (paru en France en 1959 et au Japon en 2009) n’en avait pas été une.
Y. M. : Cela remonte à loin, mais je l’ai lu deux fois. Fosco Maraini n’est pas très connu au Japon. Mais lorsque je faisais mes études à Florence, il y vivait. Il a été un des premiers étrangers à faire des recherches sur les Aïnous. Son livre Japon est vraiment une réflexion profonde sur le plan de la culture comparative. J’ai lu aussi le livre de sa fille Dacia Maraini intitulé Le Bateau pour Kôbe (Le Seuil, 2003). C’est un de mes livres préférés.

C’est à l’époque où se déroule Giacomo Foscari qu’a été fondé le mensuel de référence Garo (éd. Seirindo, publié entre 1964 et 2002). Ce dernier a joué un rôle important dans le développement du manga, et a servi de lieu privilégié d’expression pour les auteurs. L’avez-vu lu ?
Y. M. : C’est bien parce que j’ai découvert les œuvres parues dans Garo que, lorsqu’on ma proposé l’idée de dessiner des mangas, je me suis dit : “S’il existe un tel univers peuplé d’œuvres aussi puissantes, je m’y plongerai avec plaisir !”. Les mangas grands publics, je ne les lis pas. Si je n’avais connu que des œuvres sans saveur à l’époque où j’ai commencé à en dessiner, je doute que j’aurai eu le courage de poursuivre dans cette voie, malgré les difficultés financières que mon choix engendrait.
Il est bien entendu regrettable qu’un tel magazine ait disparu, mais il y a pas mal d’auteurs contemporains qui ont hérité de l’esprit Garo. Le mensuel dans lequel je suis actuellement publiée Comic Beam (éd. Enterbrain), s’inspire clairement de Garo, et mes amis mangakas ont tous baignés dans la culture Garo. Bien que le titre n’existe plus, celui-ci continue à stimuler les créateurs d’aujourd’hui.
Dans un récent entretien avec Hiramoto Masahiro, vous avez dit : “Nous traversons peut-être actuellement une période obscure, comme l’a été le Moyen- Âge. Mais il ne faut pas oublier qu’il n’y aurait pas eu de Renaissance sans le Moyen-Âge”. Ces mots relatent-ils un certain optimisme de votre part ?
Y. M. : En effet. Je pense que faire face à un grand désespoir nous fait prendre conscience de tout ce qui précédait. Nous réalisons les valeurs inouïes des vestiges du passé, et c’est alors que, peut-être, l’être humain peut mobiliser son cerveau, son corps, toutes ses capacités pour se surpasser. Même si ce n’est là qu’une simple impression subjective, je pense que nous en avons besoin, puisque c’est ce genre de chose qui nous permet d’appréhender notre avenir avec beaucoup plus d’enthousiasme.
Propos recueillis par Gabriel Bernard
Référence :
Giacomo Foscari de Yamazaki Mari, vol. 1,trad. par Corinne Quentin, Rue de Sèvres, 12,50 €.