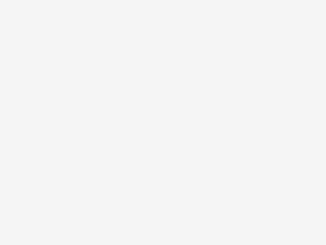Avec son nouveau film, le cinéaste a voulu réagir à l’évolution du discours politique dans l’archipel. Rencontre à Tôkyô.
Un cinéma d’art et d’essai à Tôkyô – Intérieur – nuit.

Les lumières de la salle de cinéma viennent de se rallumer. La salle est archicomble, des sièges pliants ont même dû être rajoutés derrière les nombreuses rangées de fauteuils rouges. Le public revient peu à peu à la réalité, il est comme assommé par les 110 minutes pesantes de l’univers de Nobi (Feux dans la plaine), le plus récent opus de Tsukamoto Shinya, le surdoué du cinéma japonais, farouchement indépendant, farouchement vivant. Sorti en juillet 2015 au Japon, le film a tourné dans presque 70 salles de l’archipel, et Tsukamoto Shinya s’est fait un point d’honneur à venir le plus souvent possible à la rencontre de son public. Aujourd’hui aussi, le réalisateur est sorti des coulisses pour une séance de questions – réponses.
Une jeune femme dans l’assistance : Ce film a été pour moi un véritable coup de poing, c’est un véritable choc, et je vous en remercie. J’aimerais connaître vos motivations, ce qui vous a poussé à faire ce film?
Tsukamoto Shinya : J’ai lu le roman éponyme de Ôka Shôhei dont j’ai tiré le scénario de Nobi lorsque j’étais lycéen. J’avais été frappé à l’époque par la description vivide et sans concession des souffrances endurées par les soldats abandonnés par leurs unités et livrés à eux-mêmes dans la jungle des Philippines lors de la déroute de l’armée impériale japonaise à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sans ordres, sans vivres et sans avenir, ils erraient dans la jungle en tentant de repousser le moment fatidique de leur propre disparition. À l’époque, sans avoir jamais bien sûr fait l’expérience moi-même de la guerre, j’avais ressenti dans mes tripes cette épreuve. Avec Pluie noire, (roman d’Ibuse Masuji porté au cinéma par Imamura Shôhei en 1989), Nobi est le livre consacré à la guerre du Pacifique le plus marquant de la littérature japonaise que je connaisse. Je n’ai jamais pu depuis oublier ce roman et lorsque j’ai commencé ma carrière de cinéaste, je me suis dit qu’un jour, il faudrait que je fasse l’adaptation de Nobi, pour retranscrire en images ces sensations si fortes du texte original. Mon ambition était de porter à l’écran ce contraste saisissant entre les couleurs verdoyantes de ce paradis terrestre que sont les Philippines, et la noirceur de l’âme humaine uniquement préoccupée de sa survie. Sans jamais montrer l’armée ennemie, j’ai fait un film dénonçant les atrocités de la guerre, l’effet qu’elle produit sur l’homme luttant pour sa survie, prêt à manger littéralement son prochain plutôt que d’être mangé lui-même.
(Flashback) Un café dans Tôkyô – intérieur – nuit.
Tsukamoto Shinya est en interview à l’occasion de la sortie de Nobi. Devant un cocktail sans alcool au yuzu, il répond aux questions du journaliste. Deux jeunes femmes assises à la table à côté font mine de ne pas écouter, mais ne perdent pas une miette de la conversation.
Le journaliste : Quelles ont été vos motivations ? Qu’est-ce qui vous a poussé à faire ce film ?
T. S. : C’était maintenant ou jamais. Pendant plus de 20 ans, j’ai rêvé de tourner ce film. J’ai commencé à y réfléchir sérieusement pendant le tournage de Tetsuo 2, en 1992. Mon ambition était de tourner une grande fresque historique, à la hauteur du roman de Ôka Shôhei, mais à l’époque j’avais à peine 30 ans alors j’ai remis ce projet à plus tard, en me disant qu’il fallait que je prenne d’abord de la bouteille, que je fasse mes preuves en tant que cinéaste. Je n’étais pas pressé, à l’époque, car je pensais que c’était un thème intemporel, que l’horreur de la guerre, telle que la décrit si bien Ôka, était profondément gravée dans l’histoire collective des Japonais. Il y a une dizaine d’années, j’ai interviewé plusieurs survivants de la guerre du Pacifique pour recueillir leurs témoignages avant qu’ils ne disparaissent. J’ai même participé à des missions de recherches des restes des soldats de l’armée impériale aux Philippines. À l’origine, j’avais estimé le budget nécessaire au tournage de cette fresque à environ 5 millions d’euros et je faisais régulièrement la tournée des producteurs pour trouver le financement. Je me serais ensuite contenté du tiers pour faire le film dans des conditions raisonnables, mais même cette somme-là, au fil des années, s’est révélée impossible à rassembler. Il faut dire que parallèlement, j’entendais de plus en plus les décideurs, les producteurs, me dire que l’époque n’était plus aux films de guerre soulignant la défaite. Je voulais tellement faire ce film que j’ai envisagé un temps d’en faire un dessin animé, pour surmonter les contraintes budgétaires et techniques d’un film de guerre, ou même de le faire tout seul, avec ma caméra, aux Philippines, sans personne d’autre. En définitive, j’ai lancé sur Twitter un appel aux bénévoles et le film s’est fait avec un budget proche de zéro.
Le journaliste : D’où provient ce sentiment d’urgence ?
T. S. : Bien que je ne sois pas très porté sur la politique, il y a 3 ans, j’ai ressenti un changement sémantique dans la façon d’évoquer l’idée même de la guerre. Jusqu’alors, quasiment tous les Japonais étaient convaincus que la guerre était le mal absolu et qu’il fallait l’éviter à tout prix. Mais on sent désormais un glissement dans le discours politique, le réarmement n’est plus tabou. (Ironiquement, Nobi est sorti au Japon pendant l’été 2015, au moment même où le gouvernement d’Abe Shinzô faisait voter les projets de loi relatifs à la sécurité du Japon, euphémisme pour le réarmement de l’archipel). Je voulais prendre date avant qu’il ne soit trop tard, rappeler aux jeunes générations ce que signifie réellement l’horreur de la guerre. Le gouvernement actuel me fait peur. Il a fait passer en force des projets de loi sans obtenir l’adhésion de la population. Ses explications ne sont pas satisfaisantes. Dans le film, j’essaie de ne pas prendre position, je veux que le spectateur garde sa liberté de jugement, mais à titre personnel, je considère que la guerre est vraiment atroce et ne se justifie jamais.

Le journaliste : Depuis vos débuts, vous accumulez les casquettes. Au générique de vos films, vous êtes non seulement réalisateur, mais aussi producteur, scénariste, cadreur, monteur, souvent acteur, et même distributeur. D’où vous vient cette frénésie, cette gourmandise ?
T. S. : Lorsque j’ai débuté dans le métier, je tournais en 8mm avec une caméra que mon père s’était achetée pour filmer des souvenirs de famille. Ma seule école de cinéma, ça a été les salles obscures. J’ai vu des dizaines de films pendant mon adolescence, dans des cinémas d’art et essai. Je suis resté marqué par Soleil vert de Richard Fleischer (1973), notamment, mais aussi par l’œuvre de Kurosawa Akira, Imamura Shôhei, ou Ichikawa Kon. Je n’avais bien entendu aucun budget pour tourner mes premiers films, et j’apprenais sur le tas, motivé par ma seule volonté de faire du cinéma. J’ai ainsi constaté que chaque étape du processus était essentielle pour venir à bout d’un projet. L’écriture du scénario est pour moi la tâche la plus ingrate, mais elle est primordiale, je ne peux pas la déléguer. Le travail de la caméra, le cadrage est un plaisir pour tout passionné de cinéma et c’est fascinant de regarder le monde à travers l’objectif de la caméra. J’aime bien le travail d’acteur, même lorsque je ne suis pas le réalisateur du film. Pour Nobi, le rôle principal était dévolu à quelqu’un d’autre, mais pour faire des économies, j’ai endossé le costume du soldat de première classe Tamura. Enfin, je considère qu’un film naît réellement au moment du montage, donc c’est vraiment une étape que je ne peux pas confier à qui que ce soit d’autre. À ma défense, je ne me suis jamais considéré comme un “réalisateur” de films, mais comme un “auteur”, c’est ainsi que je peux mener de front toutes ces fonctions. Au fil de ma carrière, j’ai eu la chance de travailler avec une équipe de techniciens et d’acteurs, la “Tsukamoto Gumi” (la bande à Tsukamoto), mais pour Nobi, je suis retourné à mes origines. Avec ce film, la boucle est bouclée.
Clap de fin.
Etienne Barral
Flashback
Tsukamoto Shinya place Ichikawa Kon parmi les cinéastes qui l’ont le plus marqué. Il se trouve que ce réalisateur a été le premier à adapter, en 1959, le roman d’Ôka Shôhei avec dans le rôle du soldat Tamura l’excellent Funakoshi Eiji. Nobi est sans doute avec Ningen no Jôken (La Condition de l’homme) de Kobayashi Masaki sorti la même année l’un des films les plus engagés contre la guerre jamais réalisés. Ichikawa Kon avait déjà abordé la question dans Biruma no tategoto (La Harpe de Birmanie, 1956). Mais sa vision de la vie militaire était alors beaucoup plus ambiguë que dans Nobi où il souligne avec force la déshumanisation et la dégradation des soldats japonais stationnés sur le territoire philippin dans les derniers mois de la guerre du Pacifique. Le cinéaste était parvenu à amener les spectateurs à se mettre dans la peau de Tamura et à vivre ses angoisses. Un tour de force qui intervenait dans le contexte très particulier de la mobilisation contre le renouvellement du traité de sécurité nippo-américain voulu à l’époque par le Premier ministre Kishi Nobusuke, grand-père d’un certain Abe Shinzô qui dirige aujourd’hui le gouvernement et a fait adopter, malgré une opposition massive des lois sur la défense qui vont permettre notamment aux troupes japonaises de participer à des opérations sur des théâtres extérieurs. Dans ce contexte, on comprend les motivations de Tsukamoto Shinya qui a souhaité traiter à sa manière un thème devenu sans doute abstrait pour la plupart de ses contemporains.
Odaira Namihei