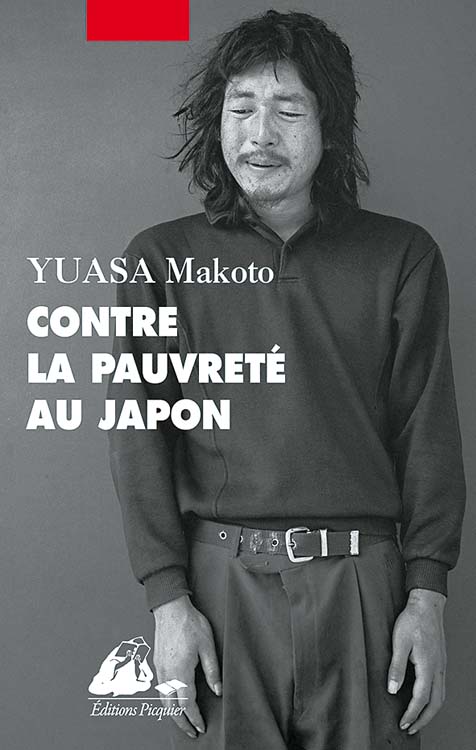
Contre la pauvreté au Japon, de Yuasa Makoto, trad. par Rémi Buquet, éd. Philippe Picquier, 20,50 €.
Comment en êtes-vous venu à vous pencher sur cette question ?
Y. M. : Quand j’ai commencé à m’intéresser à ce sujet, je ne pensais pas qu’il s’agissait d’une question de pauvreté, mais plutôt d’une forme de discrimination. C’est seulement en 2006 que j’ai mis le mot de “pauvreté” sur ce problème. Cela correspondait à la fin du gouvernement de Koizumi Jun’ichirô qui a mené pendant 5 ans de nombreuses réformes néolibérales, notamment en flexibilisant le modèle social nippon. A l’époque, lorsque j’évoquais cette question, on me rétorquait souvent que cela relevait de cas individuels et que ceux-ci étaient rares. Peu importe le nombre de cas soulevés, on m’expliquait qu’il s’agissait de cas isolés. En 2009, cela a changé quand le gouvernement a publié pour la première fois le taux de pauvreté. Il s’établissait alors à 16 %, ce qui faisait du Japon le quatrième pire pays de l’OCDE dans ce domaine juste derrière la Turquie, le Mexique et les Etats-Unis! Les choses ont alors changé puisque la société ne pouvait plus nier ce phénomène puisqu’il y avait désormais des chiffres officiels. On a aussi découvert que la pauvreté touchait beaucoup les femmes, les personnes âgées et les enfants. On a compris qu’il y avait des catégories de personnes pauvres et qu’il ne s’agissait pas, comme on l’avait dit, de cas isolés. La prise de conscience ne veut pas dire pour autant que la situation se soit améliorée. Il y a tout de même eu des lois et des mesures pour tenter de la corriger, mais sans grand succès.
Comment expliquez-vous que les Japonais aient tendance à nier cette réalité ?
Y. M. : Une des raisons qui me vient tout de suite à l’esprit, c’est qu’il est très pénible de reconnaître qu’il existe des problèmes dans la société. Il y a toujours cette tendance à vouloir croire que tout va bien. Et lorsqu’il y a des cas qui pourraient nous montrer que les choses ne vont pas si bien que ça, il est plus simple et facile de se dire que c’est ce que les personnes souhaitent. Lorsqu’on voit une personne sans abri, tout le monde se demande ce qui a pu lui arriver, pourquoi il dort dans la rue, s’il faut aller lui parler. Tout un tas de questions assaillent les gens et cela les met dans une position inconfortable. Et donc l’une des solutions consiste à se dire que c’est son problème. Ça devient plus simple d’expliquer les choses comme ça. On se dédouane de cette manière. Dans mon livre, j’évoque justement la question de la “responsabilité individuelle” (jiko sekinin). Normalement, ce terme veut dire le fait d’être responsable de ses actes, je pense que c’est tout à fait important d’essayer d’être responsable de ses actes. Mais dans le contexte actuel du Japon, il me semble que l’on utilise cette notion plutôt comme une excuse pour ne pas aider l’autre : si l’autre est dans la pauvreté, c’est de sa faute, ce n’est pas de la mienne. Ce n’est pas ma responsabilité, c’est la responsabilité de l’autre, c’est ce que j’appelle « tako sekinin » (en référence à l’expression jiko sekinin). Pour moi, c’est l’expression d’une irresponsabilité sociétale ou collective si vous préférez.
Le cas des “freeters” est intéressant puisque le terme, apparu au milieu des années 1980 désignait des jeunes refusant des contrats de travail classiques, fait désormais écho à la précarité.
Y. M. : Il faut se souvenir que ce terme a été forgé en 1985 par l’entreprise Recruit spécialisée dans le recrutement afin de désigner les personnes refusant d’être pieds et mains liés à une entreprise. Beaucoup d’entre elles se sont donc retrouvées sans contrat régulier. En réalité, je ne pense pas qu’elles refusaient d’avoir un contrat à durée indéterminée ou qu’elles ne voulaient pas devenir des salariés réguliers, mais elles ne souhaitaient pas consacrer leur vie à leur entreprise. Cette génération de jeunes refusait d’emboîter le pas de leurs parents qui avaient justement consacré leur existence à l’entreprise. Ils ont vu leur père travailler énormément, ils les ont vus se sacrifier quelles que soient les exigences de leur entreprise. Cette façon de travailler n’était pas celle que de nombreux jeunes envisageaient. Mais avec l’éclatement de la bulle financière au début de la décennie suivante et la crise qui en a découlé, le recours aux contrats non réguliers s’est imposé et a touché un nombre croissant d’hommes, ce qui était nouveau. Et si, au fond, beaucoup de personnes ne souhaitent toujours pas s’engager à vie pour une entreprise, leur précarisation s’est accentuée et le regard que la société leur porte est plutôt négatif.
En définitive, c’est lié au rapport que les Japonais entretiennent avec le travail. Peu à peu, le marché du travail au Japon s’est divisé en deux pôles. Il y a les travailleurs réguliers que je considère pour ma part comme des “super travailleurs réguliers”. Ils travaillent à temps plein, ils bénéficient d’une promotion à l’ancienneté qui tient compte des différents événements de la vie du salarié (mariage, naissance, éducation des enfants, etc.) et bénéficient d’une protection sociale très importante. En échange de cette protection, les personnes s’investissent énormément dans leur travail. A l’inverse, les travailleurs non réguliers ont une situation nettement moins avantageuse. Leur salaire est bien plus faible et ils ne bénéficient pas du même régime de sécurité sociale. Même s’ils accomplissent le même travail, compte tenu de leur statut, ils sont beaucoup moins protégés. Et il leur est très difficile de vivre avec un salaire horaire de 1 000 yens (8 euros). Il faut savoir qu’aujourd’hui 40 % des emplois au Japon sont des emplois non réguliers, ce qui est énorme.
Cette précarisation d’une partie de la population a de nombreuses conséquences négatives, l’une des principales étant, me semble-t-il, la baisse de la natalité dans la mesure où les naissances hors mariage sont rares dans l’Archipel. Et au Japon, se marier coûte cher.…
Y. M. : Tout à fait. D’ailleurs, j’ai rencontré, il y a quelques jours, des membres du Parti libéral-démocrate, la formation du Premier ministre Abe Shinzô, pour discuter du lien entre pauvreté et baisse de la natalité. En fait, tout le monde s’attendait à un troisième baby-boom. On savait depuis longtemps que le phénomène de vieillissement de la population était enclenché, mais plusieurs démographes estimaient qu’il y aurait un troisième baby-boom qui lisserait la courbe décroissante. Mais les chiffres sont têtus et montrent que celui-ci ne s’est pas produit et qu’il n’aura pas lieu. La raison principale de cette absence de rebond démographique est liée à la précarité et à l’accroissement du nombre de travailleurs non réguliers. On a ainsi quelques chiffres qui viennent le confirmer. On sait par exemple que les hommes et les femmes entre 35 et 40 ans qui vivent encore chez leurs parents et qui ne sont pas mariés représentent quelque 3 millions d’individus. Ces personnes-là sont des travailleurs non réguliers et n’ont pas les moyens de vivre en dehors de chez leurs parents. Ils ne font pas d’enfants. Et sans enfants, pas de baby-boom. Les responsables politiques semblent désormais chercher une réponse à ce problème-là, mais je pense que c’est bien trop tard. Ces gens appartiennent à la génération qui a connu ce qu’on a appelé “l’ère glaciaire de l’emploi” au milieu des années 1990 et en plus d’avoir à vivre avec des salaires bien plus faibles, ils ont vécu une absence de reconnaissance sociale. Dans la mesure où le modèle social japonais était basé sur l’idée que l’homme gagne tous les revenus du foyer, cela signifiait que, pour être un “homme”, il fallait être capable de remplir cette tâche. Par conséquent, tout homme incapable de le faire ne peut prétendre à ce statut. Il est donc important d’avoir en tête que ces personnes âgées aujourd’hui d’une quarantaine d’années et en situation de précarité ont vécu ces deux dernières décennies avec ces stigmates et qu’elles en ont beaucoup souffert. Je pense qu’il faut pour une personne autant de temps pour se rétablir que celui durant lequel elle a été en souffrance. Si cela fait 20 ans que ces personnes souffrent, il leur faudra aussi 20 ans pour s’en remettre. Elles auront alors une soixantaine d’années. Bien trop tard pour faire des enfants. Voilà pourquoi il est indispensable qu’il y ait un engagement de la société à leur égard pour les amener à s’y intégrer davantage au-delà de leur simple rôle économique. Il faut des lieux de sociabilité pour leur permettre au moins d’obtenir cette reconnaissance sociale qui fait défaut. Il faut leur redonner de l’énergie pour repartir. Sans cela, l’avenir démographique du pays est bel et bien compromis.

