Moins connu en Europe que son aîné Yoshiharu, il a aussi fait ses premières armes dans les mangas de location.
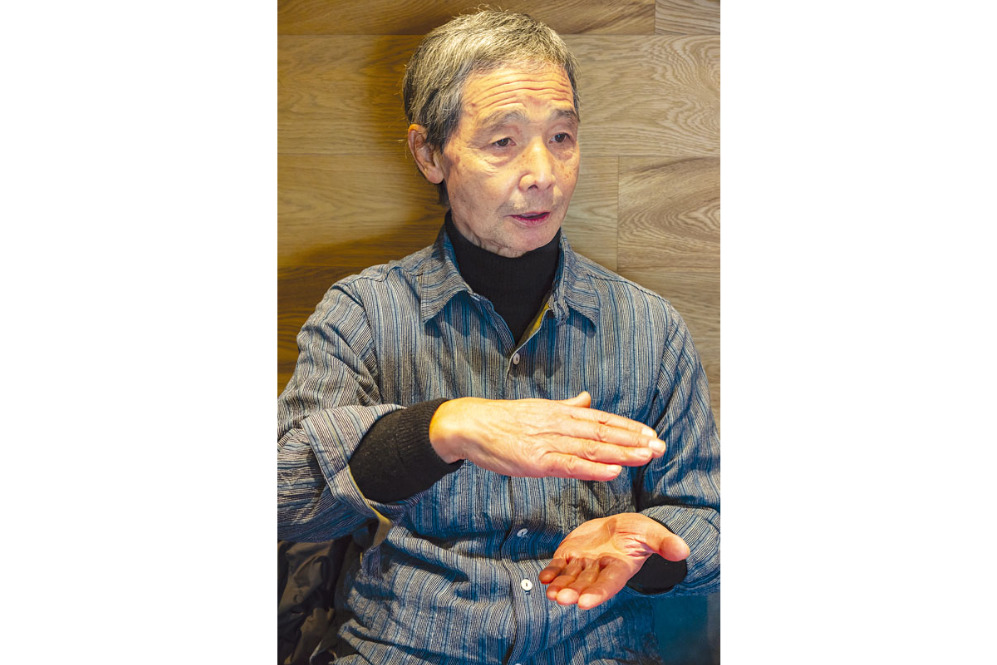
T suge Tadao est entré dans la légende. Bien que, jusqu’à très récemment, il ait été pratiquement inconnu en dehors du Japon, ce vétéran de la bande dessinée a été l’un des pionniers du manga alternatif et un collaborateur clé du magazine d’avant-garde Garo (voir Zoom Japon n°43, septembre 2014) entre la fin des années 1960 et le début des années 1970. A la différence de son frère aîné Yoshiharu (voir Zoom Japon n°87, février 2019), Tadao a largement dépeint, sur un ton non sentimental, la vie sordide des gens ordinaires et leurs luttes quotidiennes dans le Japon de l’après-guerre.
Quand avez-vous commencé à dessiner ?
Tsuge Tadao : Quand j’étais en CE1, inspiré par mon frère, j’ai commencé à dessiner les personnages de Tezuka dans la rue avec un morceau de craie. Même à l’école, j’avais l’habitude de dessiner sur le tableau noir. Puis, quand j’avais environ 12 ans, mon frère a commencé à travailler professionnellement comme dessinateur de bandes dessinées. Je rentrais de l’école et il me demandait de l’aider pour les parties faciles, comme l’encrage de certains dessins. C’était l’époque où Tatsumi Yoshiharu repoussait les limites du manga avec ses histoires grinçantes de gekiga [manga réaliste] et où des revues destinées à la location comme Meiro, Kage et Machi ont fait leur apparition. J’ai soumis à l’une de ces revues une de mes histoires – elle faisait environ huit pages – et, étonnamment, elle a été publiée ! J’ai été payé 1 000 yens (± 7 €) – une somme considérable à l’époque, surtout pour un jeune homme comme moi – et j’étais définitivement accroché. Je n’arrivais pas à croire que je pouvais être payé tout en m’amusant.
Vos premières bandes dessinées ont été publiées dans des collections de livres de location (kashihon manga) qui contenaient principalement des mangas de genre. D’après un essai écrit et publié par votre frère Yoshiharu en 1988, vous lui avez un jour montré le brouillon d’une de vos premières histoires, mais il l’a publié dans Machi comme étant sa propre œuvre.
T. T. : J’avoue que je ne m’en souviens pas. Je n’ai jamais reçu le numéro où mon histoire était censée figurer, donc je ne sais pas ce qu’il en est advenu. Mais je me souviens avoir reçu les honoraires pour le manuscrit. Autant que je me souvienne, les premières histoires parues dans un kashihon manga étaient Tejô [Menottes] et Kaitenkenjû [Revolver]. C’était une période particulièrement prolifique pour moi. J’ai écrit Kaitenkenjû en 1959, et au cours des deux années suivantes, j’ai publié plus de 20 œuvres. Ensuite, je n’ai plus rien fait jusqu’à ce que je rejoigne Garo en 1968.
J’ai lu quelque part que vous n’étiez pas particulièrement fier de vos histoires de shôjo manga.
T. T. : Disons que ce n’était pas le genre d’œuvres que je voulais créer. Mais sur le marché des kashihon, il fallait donner aux lecteurs ce qu’ils voulaient, et les histoires pour filles étaient très populaires. C’est la réalité d’une économie capitaliste. Après tout, les shôjo manga représentaient près de 60 % de la production totale des mangas de prêt.
Le shôjo manga typique des kashihon de l’époque raconte l’histoire d’une héroïne courageuse qui, malgré son malheur, parvient à une fin heureuse et dramatique. Pensez-vous que ces histoires ont été influencées par la situation d’après-guerre au Japon ?
T. T. : Oui et non. Il est certain que les shôjo manga étaient très différents des mangas pour garçons. Les garçons aimaient l’évasion, qu’il s’agisse d’action, d’aventure ou de science-fiction. En revanche, le contenu des bandes dessinées pour filles était extrêmement réaliste. N’oubliez pas qu’à l’époque, il y avait 100 000 orphelins de guerre au Japon. Cela dit, ces histoires se vendaient bien notamment parce que les filles aimaient les histoires qui font pleurer.
N’avez-vous jamais eu l’impression que la politique éditoriale des éditeurs de kashihon imposait trop de limites à votre art ?
T. T. : Peut-être qu’au début, c’était comme ça. Tezuka avait établi les lignes directrices pour dessiner les mangas, et tous les artistes suivaient son plan. Les bandes dessinées étaient des pièces morales sur le bien contre le mal, et vous saviez que les bons l’emportaient toujours sur les méchants. Ces règles étaient gravées dans la pierre et considérées comme allant de soi. Dans tous les cas, il était impossible qu’un éditeur accepte quelque chose de différent, qui s’écarte de ces règles. Puis le gekiga de Tatsumi est arrivé et les méchants ont commencé à gagner, pour ainsi dire.
Comme dans Les Salauds dorment en paix (Warui yatsu hodo yoku nemuru, 1960) de Kurosawa Akira, non ?
T. T. : Oui, quelque chose comme ça. J’exagère un peu, bien sûr, mais Tatsumi a vraiment changé les règles du jeu. Il a montré que la vie réelle était plus compliquée que le monde dépeint dans les bandes dessinées. Par la suite, la scène manga s’est diversifiée et des approches de plus en plus originales sont devenues populaires, comme les mangas d’époque de Shirato Sanpei sur l’oppression sociale et la discrimination, et Mizuki Shigeru dont l’approche était différente du gekiga mais visait toujours un lectorat plus adulte. Même mon frère Yoshiharu a été fortement influencé par Mizuki.
Vous avez dit que vous ne vous souciiez pas vraiment d’améliorer vos compétences en dessin. Avez-vous déjà envisagé d’abandonner votre emploi régulier et de devenir un dessinateur de manga professionnel à plein temps ?
T. T. : Evidemment, j’aurais été heureux de travailler en tant que mangaka, mais je n’ai jamais consciemment poursuivi cette carrière. De plus, ma situation familiale ne m’a pas aidé à cet égard : les auteurs de bandes dessinées travaillent dans la solitude de leur maison, passant des heures sur leurs histoires, mais ma maison était le dernier endroit où je voulais être. Quand je ne travaillais pas, j’étais dans la rue avec mes amis hooligans (rires). Ils avaient pourtant l’habitude de dire, “tu peux devenir un artiste de bande dessinée, ne perds pas ton temps à traîner avec nous”. Mais j’étais blessé par leur attitude. Je finissais par me promener seul dans le quartier, en attendant que mes deux frères rentrent du travail.
Quand avez-vous quitté la maison ?
T. T. : Quand je me suis marié, à 24 ans, j’ai déménagé dans la ville de ma femme, où nous avons vécu avec sa famille et j’ai rejoint l’entreprise familiale, pour travailler dans une quincaillerie et dans la vente de gaz, ce qui était bien mieux que ma vie précédente.
Et qu’est-il arrivé à vos mangas ?
T. T. : L’année où je me suis marié est aussi celle où mon frère a commencé sa collaboration avec le magazine Garo. Je crois me souvenir que mon frère avait dit aux rédacteurs que je dessinais aussi. Pour ma part, j’ai trouvé en Garo un nouveau type de magazine où l’auteur était vraiment libre de dessiner ce qu’il voulait et où la seule limite était son imagination. J’ai commencé à dessiner le soir après le travail, petit à petit, et l’une de mes histoires a atterri dans les mains de Takano
Shinzô (voir pp. 4-6), le rédacteur en chef de Garo, qui m’a envoyé une lettre m’invitant à travailler pour eux. Vous pouvez imaginer à quel point j’étais heureux. Au début, j’ai contribué à presque tous les numéros, et je voyais que le salaire que je gagnais était bien meilleur que celui de mon emploi régulier. A 27 ans, j’ai donc quitté mon emploi pour me consacrer entièrement au manga. Ce fut la période de création la plus prolifique de ma vie. Malheureusement, cela n’a pas duré, et j’ai fini par décider de reprendre mon ancien travail.
Votre première contribution à Garo dans son n°54 de décembre 1968, Oka no ue de Bisento van Gohho [Sur la Colline, Vincent van Gogh…], avait été conçue à l’origine comme une œuvre littéraire. Pourquoi avez-vous décidé d’en faire un manga ?
T. T. : Tout d’abord, pour des raisons pratiques. J’avais hâte de voir mon manga dans le magazine, et travailler sur ce thème était le moyen le plus rapide d’y parvenir puisque j’avais déjà écrit l’histoire. En outre, j’aimais vraiment le sujet et j’avais fait beaucoup de recherches sur Van Gogh. C’était une histoire qui me tenait à cœur.
Pourtant, votre production ultérieure a été très différente, car vous avez commencé à déterrer vos souvenirs d’enfance et d’adolescence. La plupart de vos dernières bandes dessinées mettent en scène un salarié d’âge mûr appelé Aogishi Yôkichi ou le genre de voyous qui peuplaient votre quartier de l’est de Tôkyô –en particulier un personnage appelé Keisei Sabu. Pourquoi avez-vous choisi de dépeindre leur vie ?
T. T. : Les gens comme Aogishi et Sabu étaient partout. Dans mon ancien travail, par exemple, j’ai eu l’occasion d’en rencontrer beaucoup, et j’ai eu l’impression de comprendre leurs motivations. Mon enfance marquée par la violence quotidienne à la maison m’a permis de devenir très bon pour lire le visage des gens. Chacun d’entre eux avait une histoire différente à raconter, un passé différent, mais ils partageaient tous les mêmes souvenirs de guerre. Rien qu’en les écoutant parler, j’étais capable d’imaginer leur vie. Mes histoires, à cet égard, n’étaient qu’une accumulation de tous ces souvenirs, filtrés par mon imagination. Raconter ces histoires était très amusant. Keisei Sabu, par exemple, était une personne réelle, mais pas aussi cool que je l’avais rendu. Je n’ai eu que quelques aperçus de lui, marchant ivre dans mon quartier. Plus que de le voir, j’ai entendu les gens parler de lui. Alors j’ai dû inventer le reste. Maintenant, étant un grand fan de cinéma qui a aimé des personnages comme Shane dans le western L’Homme des vallées perdues (Shane, 1953) de George Stevens, j’ai aimé l’idée du héros solitaire sauvant une fille avant de disparaître sans un mot, ou se battant pour défendre son sens de l’honneur à l’ancienne.
Cela me rappelle des acteurs comme Takakura Ken et Sugawara Bunta qui sont devenus des stars du cinéma yakuza dans les années 1960.
T. T. : Oui, ils étaient extrêmement populaires, même parmi les étudiants de la Nouvelle Gauche qui, théoriquement, ne partageaient pas la vision conservatrice de la vie de leurs personnages.
Vous n’avez jamais envie de dessiner à nouveau des bandes dessinées ?
T. T. : En fait, je suis en train de le faire en ce moment même ! (rires) En 2018, j’ai commencé une nouvelle histoire appelée Shôwa Maboroshi [Illusion de Shôwa], un récit tentaculaire qui commence peu après la guerre et qui met en scène tous mes personnages préférés du passé. J’ai produit neuf volumes jusqu’à présent.
Propos recueillis par G. S.

