A l’occasion de la sortie de Sayonara Gangsters en France, l’écrivain nous a livré son regard tranché sur le monde qui l’entoure.

Takahashi Gen’ichirô est un des écrivains les plus importants des trente dernières années et un des pionniers du roman post-moderne au Japon. De la fiction aux essais, de la critique littéraire aux articles sur le sport, en passant par le commentaire politique, l’auteur de 62 ans possède à la fois une position morale à toute épreuve et une extraordinaire imagination qui pousse le lecteur à abandonner toute rationalité pour se plonger dans les univers qu’il crée. Sa vie est tout aussi picaresque que celles qu’il présente dans ses histoires. Son engagement politique lorsqu’il était étudiant l’a conduit en prison et cette expérience derrière les barreaux l’a empêché pendant des années de s’exprimer avec des mots.
Gianni Simone
Quand avez-vous choisi de devenir écrivain ?
Takahashi Gen’ichirô : J’étais encore lycéen. Mais ma vie a emprunté de nombreux détours avant que je me décide vraiment à me lancer. J’appartiens à la génération 1968 et j’ai participé activement aux manifestations étudiantes. C’est en 1969 que le mouvement a atteint son apogée, l’année de mon entrée à la fac. Après mon arrestation et mon exclusion de l’établissement, j’ai travaillé comme terrassier pendant une dizaine d’années. Vous voyez toutes les routes du coin, j’ai trimé dessus (rires). Quand j’ai passé le cap de la trentaine, je me suis souvenu de mon vieux rêve.
Votre implication dans le mouvement étudiant a commencé avant votre entrée à l’université ?
T. G. : Oui. Le mouvement radical a même touché mon lycée à Ôsaka. Nous étions opposés à la guerre au Vietnam et nous partagions les mêmes idéaux révolutionnaires qu’en Europe ou en Amérique. Mais il y avait aussi quelques sujets spécifiques au Japon comme le traité de sécurité nippo-américain et l’occupation américaine d’Okinawa qui nous mobilisaient. Mais au fond, je pense qu’au-delà de ces questions nous exprimions une colère profonde. Nous étions très déçus par la société et le système éducatif. Nous avions atteint un point où nous devions entreprendre quelque chose.
Dans les années 1950 et 1960, les Japonais descendaient souvent dans les rues pour manifester. Une décennie plus tard, cela s’est brutalement arrêté. Comment expliquez-vous ce phénomène ?
T. G. : Le mouvement étudiant a provoqué une grande déception. Cela a entraîné la naissance de la Fraction armée rouge qui a mené une série d’attaques terroristes et a creusé un fossé entre l’opinion et la gauche. Dans le même temps, les conditions de vie au Japon se sont nettement améliorées. Et comme vous le savez, un peuple bien nourri cesse de se plaindre.
Vous avez été arrêté lors de manifestations. Combien de temps avez-vous passé en prison.
T. G. : J’ai été interpellé trois fois. La première arrestation m’a valu trois semaines de prison, la seconde une semaine. La troisième fois, ils m’ont gardé dix mois.
Est-ce à ce moment-là que vous avez commencé à souffrir d’aphasie ?
T. G. : Oui. Vous devez savoir que l’on ne pouvait recevoir la visite que d’une seule personne par jour et qu’elle ne pouvait rester que cinq minutes. Nous n’avions aucune intimité. Un garde était toujours présent. Dans ces conditions, j’ai fini par perdre ma capacité à parler même lorsque ma petite amie venait me rendre visite. Cela me prenait de plus en plus de temps pour pouvoir formuler ma pensée sous la forme de mots. Même après ma sortie de prison, j’ai eu du mal à retrouver l’usage de la parole dans la vie quotidienne. Cette expérience a laissé une blessure psychologique qui n’a toujours pas guéri à ce jour. Je me suis alors dit que ce que je ne pouvais pas m’exprimer oralement, je pourrais le faire par écrit. D’une certaine façon, ce que j’ai vécu est une bénédiction cachée.
Peut-on dire que votre style d’écriture a été affecté par cette expérience ?
T. G. : Complètement.
Est-il vrai que Sayonara Gangsters est en partie autobiographique ?
T. G. : Vous pouvez sans doute trouver des éléments de ma vie, mais tout est raconté de façon détournée. Cela s’explique par les difficultés que j’avais encore à m’exprimer. En d’autres termes, il fallait que je trouve un moyen de raconter ce qui ne venait pas naturellement. C’est ce qui explique ce style particulier. En fin de compte, tous les éléments autobiographiques sont camouflés ou rendus invisibles par la manière dont je raconte les choses.
Quand les critiques en parlent, ils utilisent souvent des termes comme post-moderne, méta-roman ou méta-fiction. Qu’en pensez-vous ?
T. G. : Je crois que si j’étais critique, je dirais la même chose. Il est vrai que j’ai été influencé par bon nombre d’écrivains post-modernes. Cela dit, je tiens à ajouter que je les ai toujours appréciés en tant qu’écrivains sans avoir en tête l’idée d’écrire une méta-fiction ou quelque chose de ce genre. Par ailleurs, le post-modernisme n’est pas une chose aisée à expliquer. Mon écrivain préféré est Italo Calvino. La plupart de ses œuvres peuvent être classées comme des méta-fictions, mais il s’est intéressé à tellement de styles et son œuvre a tellement de facettes qu’il est difficile de le qualifier d’écrivain post-moderniste.
Et vous, comment vous définiriez-vous en tant qu’écrivain ?
T. G. : J’aimerais tellement écrire comme Calvino. J’apprécie en particuliers ses Leçons américaines où il compare la légèreté et la lourdeur, et où il explique que son travail a été un long processus de soustraction visant à rendre ses histoires et sa langue plus légères. Dans mes livres, j’ai le même objectif. Mais c’est au lecteur de décider si j’ai ou non réussi (rires). En dehors de cela, j’ai toujours aimé la poésie moderne japonaise et je pense que mes racines créatives plongent davantage dans la poésie que le roman.
Dans le passé, le modernisme n’était guère populaire, n’est-ce pas ?
T. G. : En effet. La tradition littéraire japonaise a été représentée par le roman du moi et le naturalisme d’un côté, songez à Natsume Sôseki, et de l’autre, par le roman politique. Dans les deux cas, le contenu a toujours compté davantage que la forme et le style. Aussi, de ce point de vue, le modernisme était plutôt léger au niveau du contenu et éloigné de la réalité. Dès lors, il était peu pris au sérieux. Aujourd’hui, les choses ont peu évolué.
Sayonara Gangsters, votre premier roman, est paru en 1982. Pensez-vous qu’il soit actuellement plus difficile d’être écrivain qu’il y a 30 ans ?
T. G. : Cela dépend. Quand mon premier roman est sorti, il existait une distinction rigide entre la littérature, les mangas ou encore le cinéma. Si vous étiez romancier, vous deviez vous comporter d’une certaine manière. Il y avait aussi des obstacles technologiques et des limitations budgétaires. Un jour, j’ai demandé à mon éditeur d’inclure un disque flexible dans mon livre, car je souhaitais présenter le dernier chapitre sous cette forme. Il m’a répondu que c’était trop cher. En 1984, mon second roman Over the Rainbow contenait des photos et quelques innovations typographiques. On peut donc dire que les écrivains ont gagné une plus grande liberté sur le plan créatif. Avec l’avènement d’Internet, du téléphone portable et du livre électronique, il devient plus difficile de définir ce qu’est un roman. Dans le même temps, il y a tellement de gens qui écrivent maintenant qu’une première œuvre réussie ne garantit pas une carrière pleine de succès. Les éditeurs sont aussi devenus impatients. Ils n’ont pas le temps ni la patience de cultiver de nouveaux talents. La concurrence est tellement forte qu’au premier flop, ils vous laissent tomber pour un autre.
Du point de vue du style, lire vos livres, c’est comme emprunter des montagnes russes dans la mesure où vous aimez jouer avec la langue. Vous faites aussi de nombreuses références à l’histoire du Japon ou encore à sa culture populaire. Estimez-vous que vos romans sont difficiles à traduire ?
T. G. : En tant qu’écrivain, je dois accepter l’idée qu’une traduction est une approximation. Un traducteur peut coller plus ou moins au texte original, mais ce ne sera jamais la même chose. En d’autres termes, une traduction n’est pas une copie, mais bien une œuvre originale. C’est à la fois similaire et différent, et j’aime bien ça. Les traducteurs disent souvent que mes livres sont difficiles, mais je leur donne carte blanche. Tant qu’ils parviennent à transmettre le message originel, ils ont toute latitude pour jouer avec la langue comme je le fais.
Que pensez-vous de la position de la littérature japonaise dans le monde ?
T. G. : La littérature japonaise est particulière voire étrange. Tout d’abord, à la différence d’autres pays, le Japon a atteint le niveau post-industriel en un temps record. Nous n’avons aucune nouvelle frontière à explorer. Notre société semble avoir atteint ses limites et ce sentiment de crise - ce que j’appelle la fin du capitalisme - est présent dans bon nombre de romans. On peut aussi dire que les écrivains japonais sont un peu plus dingues que ceux des autres pays (rires). Ils semblent ne connaître aucune limite. Ils sont toujours en train d’expérimenter et de repousser les limites. En comparaison, les écrivains occidentaux sont plus conservateurs.
Est-ce que votre écriture a été influencée par les événements du 11 mars ?
T. G. : Totalement. Pendant des années, j’ai évité d’aborder des sujets politiques ou sociaux dans mes livres. En avril 2011, le quotidien Asahi Shimbun m’a demandé d’écrire un texte sur ce qui venait de se passer. J’ai estimé que c’était une chance pour moi d’exprimer mes idées sur la question. A ce moment-là, beaucoup de gens semblaient décidés à attendre et à réfléchir avant d’émettre une opinion. Pour ma part, il me paraissait urgent de parler rapidement au risque d’être maladroit et d’être critiqué. Depuis deux ans, je n’ai donc pas cessé d’écrire. Cela ne s’est pas fait sans stress et je suis épuisé. J’ai aussi compris que je n’étais pas vraiment fait pour écrire ce genre de choses.
D’après vous, quelle doit être la priorité du Japon ?
T. G. : Cela fait à peine deux ans que les événements du 11 mars se sont déroulés et les gens semblent déjà oublier. Juste après la catastrophe, il est apparu de façon évidente que le nucléaire était une énergie dangereuse et que tout le système était fondé sur une alliance pourrie entre le gouvernement et Tepco, la société en charge de la centrale de Fukushima Dai-ichi. Pour la première fois depuis 40 ans, les gens se sont exprimés au moyen de grandes manifestations dans les rues. En d’autres termes, les Japonais semblaient prêts à changer pour de bon. Et puis, il y a eu les élections de décembre dernier qui ont vu la victoire écrasante du Parti libéral-démocrate, le principal responsable du désastre. Aujourd’hui, on parle de redémarrer les centrales. Je pouvais m’attendre à cette victoire, mais j’ai été vraiment surpris par le conservatisme des Japonais et leur rejet du changement. C’est comme si rien ne s’était passé depuis deux ans.
La littérature est-elle en mesure de changer la société ?
T. G. : Ce n’est pas une question évidente à laquelle répondre. En tant qu’instruments de propagande, je ne pense pas que les livres soient en mesure de bouleverser les choses. Néanmoins l’écrivain a les moyens d’exprimer ce que les gens ressentent, mais ne parviennent pas à le rendre avec des mots. Il peut également montrer qu’il existe d’autres styles de vie possibles. En ce sens, une œuvre de fiction peut devenir quelque chose de très politique.
Pensez-vous que les écrivains actuels en font assez de ce point de vue ?
T. G. : C’est quelque chose de générationnel. Des écrivains plus anciens comme Ôe Kenzaburô appartiennent à une génération qui s’est engagée politiquement. Ils ont toujours réussi à exprimer leurs idées de façon claire et nette. D’un autre côté, vous avez des auteurs quadragénaires ou quinquagénaires qui ont fait l’expérience de l’échec du mouvement étudiant des années 1960. Ils se sont tenus éloignés de tous les sujets politiques. Les plus jeunes, en revanche, ceux qui ont aujourd’hui 20 ou 30 ans ont grandi dans une situation fort différente, dans une société où il est plus difficile de trouver un bon boulot et où les jeunes nourrissent de nombreux doutes à l’égard de l’avenir. Je pense que ces auteurs sont plus en colère que les autres. Ils expriment leurs inquiétudes dans leurs écrits.
La traduction française de Sayonara Gangsters vient de paraître en France et on annonce la publication d’un autre de vos romans à l’automne…
T. G. : Vous êtes bien informé. Il s’agit de Koisuru genpatsu [Nucléaire mon amour]*, l’histoire d’un réalisateur de film porno qui décide de faire un film X à but humanitaire afin de venir en aide aux sinistrés du séisme du 11 mars 2011. Je m’étais lancé dans l’écriture de ce roman juste après les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, car je voulais écrire autour de ce thème. Comme je ne parvenais pas à aborder la question comme je le souhaitais, c’est-à-dire d’une façon plus légère, j’ai mis de côté ce roman. Les événements du 11 mars 2011 m’ont donné l’occasion de le reprendre et de lui donner une nouvelle vie. Si on le compare à Sayonara Gangsters, le style est plus grotesque, mais il contient aussi des éléments autobiographiques puisque j’ai moi-même réalisé trois films érotiques par le passé. C’était en 1996. A l’époque, je m’étais rendu sur le tournage d’un film X pour les besoins d’un article. Le réalisateur, qui était l’un de mes amis, m’a proposé de le diriger plutôt que d’être un simple spectateur. C’est ce que j’ai fait avant d’en réaliser deux autres par la suite, même si cette expérience a été pour le moins embarrassante (rires). Cela dit, le cinéma japonais a en la matière une longue et riche tradition. Bon nombre de ces films réalisés dans les années 1980 et 1990 possèdent d’indéniables qualités artistiques.
Entre 1990 et 1997, vous avez cessé d’écrire des romans…
T. G. : En effet. J’ai connu un passage à vide ou plus exactement j’étais las d’écrire des romans, en particulier le genre post-moderne qui avait marqué mon œuvre au cours de la décennie précédente. J’avais l’impression croissante de perdre mon temps. J’ai donc décidé de faire une pause. Celle-ci a duré sept ans, une période au cours de laquelle j’ai passé le plus clair de mon temps sur les champs de courses (rires).
J’avais entendu parler de votre passion pour les courses de chevaux. Est-ce vraiment si intéressant que cela ?
T. G. : Oui à condition d’aimer les paris. C’est d’ailleurs cet aspect des choses qui m’a conduit vers les champs de courses. Puis peu à peu, je me suis intéressé à la culture de l’élevage des chevaux qui est apparue en Angleterre, notamment à la façon dont l’éleveur, comme s’il était Dieu, contrôle la lignée d’un cheval en vue de produire un pur-sang. C’est quelque chose que seul un aristocrate disposant de temps et d’argent peut entreprendre et réaliser. C’est un univers fascinant dont il est très difficile de se détacher à partir du moment où il a commencé à capter votre attention. Par chance, j’ai réussi à m’en extraire. Après tout, pour un écrivain, la vie est un pari.
Propos recueillis par G. S.
* Le roman paraîtra également chez Books Editions.
Critique :
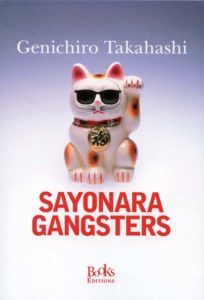
Bien que Takahashi Gen’ichirô affirme que la traduction “est une approximation”, on peut regretter que l’éditeur français de Sayonara Gangsters ait choisi de publier cet auteur à partir de l’édition anglaise. Cela est d’autant plus regrettable que Books Editions est une filiale du magazine Books spécialisé dans la traduction d’articles de la presse étrangère. On a l’impression de faire un grand bond en arrière du temps où, faute de traducteurs de japonais, les maisons d’édition françaises se tournaient vers les traductions en anglais pour diffuser la littérature nippone. Sachant que l’auteur s’est amusé avec la langue pour écrire ce premier roman, il est vraiment dommage d’avoir créé une nouvelle “approximation” en ne faisant pas appel à un traducteur du japonais pour sa parution en France.
En dépit de ce point noir, ce roman est une œuvre remarquable par sa construction narrative et par la capacité de l’auteur à nous transporter dans des univers étonnants entre réel et science-fiction. C’est un 1Q84 délirant écrit un quart de siècle avant le best-seller de Murakami Haruki. On y trouve également des éléments qui ont pu inspirer un mangaka comme Mase Motorô dans Ikigami, préavis de mort (éd. Kaze). Bref, une œuvre de fiction au sens noble du terme que Takahashi mène d’une main de maître.
Odaira Namihei

