Ce n’est pas un hasard de Sekiguchi Ryôko relate de façon touchante et forte la complexité des événements du 11 mars 2011.

Votre chronique est parue à l’automne 2011, six mois après le séisme. Comment s’est déroulée cette sortie ?
Sekiguchi Ryôko : C’est très étrange parce que, quand je sors un ouvrage de poésie, je peux dire à mes amis, qu’ils soient écrivains ou pas, que je viens de publier un nouveau livre. Dans ces cas-là, il y a une sorte d’agitation autour de ce petit événement. On vous demande quel est son titre et tout un tas de choses autour. Mais dans le cas de Ce n’est pas un hasard, je n’ai pas osé le dire ou je prenais plein de précautions avant d’en parler. Je me demandais si mes amis, en particulier les écrivains, imaginaient que ce livre était une sorte d’anecdote par rapport à mon travail habituel ou s’ils pouvaient croire que j’avais profité de cet événement pour écrire une œuvre vraiment anecdotique. Voilà pourquoi, pour la première fois de ma vie, je me suis sentie obligée de me justifier. Encore aujourd’hui, plus de six mois après la parution de ce livre, je pense que j’aurais vraiment bien aimé rester un simple poète ne s’intéressant qu’aux questions linguistiques. Puisque la tragédie s’est produite, je pense que mon livre devait être écrit au moins pour certains. Cela dit, j’aurais vraiment aimé être dans un monde où ce livre n’aurait pas de raison d’être. Je suis sûre que le poète de Fukushima Wagô Ryôichi [voir son interview dans Zoom Japon n°14, octobre 2011, pp. 4-5] pense la même chose. Le pays où nous avons besoin de poésie de cette sorte, c’est un pays qui est traversé par le malheur.
A un moment, vous écrivez : “Etre dans l’intensité de l’écriture, cela doit être un bonheur pour un écrivain. Cela devrait l’être. C’est la première fois que l’intensité de l’écriture n’est pas pour moi un bonheur mais une douleur que je m’impose”. Pourriez-vous expliquer cette douleur ?
S. R. : En général, lorsqu’un auteur se lance dans l’écriture d’un livre même s’il s’agit d’un ouvrage relatant un fait historique, il a tendance à se saisir de la thématique et d’en faire “son” sujet. Il devient en quelque sorte le propriétaire ou le dépositaire de ce sujet. Cette fois, à aucun moment, je n’ai pu me dire que c’était “mon” sujet. Il était à la fois le sujet des autres et d’une façon indirecte, il était aussi le mien. De fait, je me suis retrouvée dans une situation très particulière. J’avais beaucoup de choses à dire, mais je ne savais pas où situer mes phrases. J’ai eu aussi du mal à imposer ma voix dans ce livre. Vous avez sans doute remarqué la présence de nombreux noms propres. Ils m’ont apporté beaucoup. Mais au milieu de tout cela, il y a aussi ma voix et mes choix d’écrire ou de ne pas écrire certaines choses. C’est dans ces instants-là que la douleur est présente, car je me demandais en permanence si c’était le bon chemin que j’empruntais. Je faisais également face à un afflux constant d’informations vis-à-vis desquelles je me sentais en mesure de réagir, d’autant que j’étais en France où les médias rapportaient beaucoup d’âneries. Dans ce contexte, je ne pouvais pas non plus me poser comme la représentante des voix japonaises. Je n’avais aucune légitimité pour cela. Ce sentiment de gêne n’est pas lié aux événements du 11 mars. C’est quelque chose que j’ai toujours ressenti, en entendant, par exemple, un intellectuel arabe évoquer le Printemps arabe au nom de tous ceux qui étaient dans les rues, en ayant pour seule légitimité son origine. Je me suis donc posée la question de savoir si je ne faisais pas la même chose.
Avez vous trouvé une réponse ?
S. R. : Oui et non. Je sais très bien qu’il n’y a pas de réponse définitive à cette question. Et puis, je pense que même une personne vivant à Rikuzentakata ou Minami Sanriku et qui a perdu toute sa famille dans cette tragédie ne peut pas représenter toutes les voix de ceux et celles qui ont vécu la catastrophe. Car ce qui s’est passé le 11 mars, ce n’est pas une catastrophe, ce sont des catastrophes et des catastrophes de nature différente. Si celui qui habite à Rikuzentakata affirme qu’il a connu la pire tragédie de sa vie, l’autre qui vit à Fukushima peut lui rétorquer la même chose. Petit à petit, et notamment quand j’ai commencé à me documenter sur le séisme de 1923 qui a détruit la région de Tôkyô, j’ai compris que l’important n’était pas de savoir qui parlait, mais d’écrire un texte de plus, de laisser une trace supplémentaire, un témoignage qui servira non pas aux lecteurs d’aujourd’hui, mais à ceux du futur. En découvrant tout ce qui avait été écrit au moment du tremblement de terre de 1923, je me suis rendu compte que les récits rapportés par les écrivains de l’époque me parlaient aussi bien que s’ils avaient été rédigés la veille. A cette époque, de nombreux auteurs ont pris leur plume pour s’intéresser à cette catastrophe. Tanizaki Jun’ichirô a ainsi écrit des essais et des nouvelles. En lisant tous ces écrits, j’ai souvent été bien plus touchée que par les images des destructions. Il y avait dans leur écriture une puissance et une précision que je ne retrouvais pas dans les images. Voilà pourquoi je me suis dit que ce que j’avais décidé d’écrire finirait par avoir d’ici 10 ou 15 ans un sens en tant qu’archives et témoignages d’une période donnée. Et si cela peut avoir un sens, c’est aussi parce que je suis loin. J’ai compris que ce n’est pas forcément la proximité qui légitime le propos. Je crois d’ailleurs que, si j’avais été au Japon le 11 mars, je n’aurais probablement pas écrit ce livre, car j’aurais eu le sentiment d’avoir vécu la même catastrophe que les autres. En étant à 10 000 kilomètres de là, je me suis en permanence demandée si je vivais ou non ces événements. Je me sentais concernée tout en étant à l’abri.
Mais pour revenir à la question de la douleur, je pense qu’elle était présente parce que tout simplement je ne voulais pas parler du malheur arrivé à mon pays d’origine. En définitive, la question de « qui a le droit de parler de quoi » sur laquelle j’ai aussi beaucoup réfléchi est accessoire. J’avais surtout l’impression que rédiger un journal sur les catastrophes du 11 mars revenait à devoir établir un rapport sur l’état de santé de mon père qui se dégraderait de jour en jour.
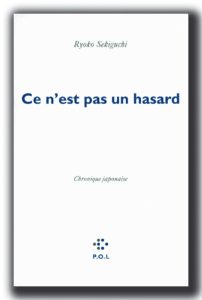
Quelles ont été vos motivations pour publier cette chronique sous forme d’un livre ?
S. R. : Il y avait une motivation sans doute pédagogique si je peux utiliser ce terme. Je sentais en effet un déséquilibre entre ce que je ressentais et que de nombreux Japonais ressentaient également et ce que les médias français rapportaient. Je voulais rétablir un certain équilibre. C’est l’aspect le plus “pratique” de la démarche qui m’a amenée à rédiger ce livre. Si cet ouvrage n’avait été composé que dans cette dimension, je pense que je ne l’aurais pas publié. J’aborde d’autres thématiques comme la veille ou la temporalité de la catastrophe qui ne pouvaient, selon moi, trouver leur expression que dans un ouvrage. Un article de presse n’aurait pas permis de les évoquer dans leur profondeur et leur durée, alors qu’il était beaucoup plus facile de faire un papier critique sur la façon dont les médias étrangers ont couvert le séisme. La temporalité de la catastrophe est une question qui était en moi depuis longtemps, un peu comme une nappe phréatique. C’est un sujet — la temporalité — sur lequel j’avais envie d’écrire depuis longtemps. Je pense que cette chronique est aussi le fruit de ce désir tout en ayant débuté par un pur hasard. Même si le titre du livre est Ce n’est pas un hasard, celui-ci n’aurait jamais existé sans de nombreux hasards. C’est un peu comme un dialogue qui s’est mis en place entre une envie profondément ancrée et des situations inattendues auxquelles je me devais de répondre. C’est la première fois que j’ai expérimenté une situation pareille. Cela a constitué une autre de mes motivations pour que ce texte prenne finalement la forme d’un livre. Un autre point important, c’est cette notion de veille. La plupart du temps, on évoque une catastrophe de façon rétrospective comme je l’ai fait au début. J’ai commencé à écrire après la première secousse et le tsunami. Mais très vite, au bout de deux ou trois jours, j’ai pris conscience que j’écrivais aussi par anticipation d’une catastrophe. Je rappelle que les spécialistes annonçaient une réplique de très forte amplitude sans oublier les risques d’explosion autour de la centrale de Fukushima. Je vivais donc avec cette sensation d’être à la veille d’un nouvel événement tragique sans pour autant être en mesure de le sentir puisqu’il n’existait pas. C’était très pénible. Je finissais par me dire qu’il valait mieux vivre une catastrophe que d’être dans cette situation de veille. Sans la tenue de cette chronique, il m’aurait été difficile d’appréhender ce sentiment. Aussi évident que cela puisse paraître, je me suis rendue compte que nous étions toujours la veille et que cela n’avait pas de fin. C’est à partir du moment où j’ai fait ce constat que j’ai décidé d’arrêter d’écrire et de publier le livre. Cette absence de fin est d’autant plus vivement ressentie que l’accident de la centrale de Fukushima Dai-ichi empêche même d’imaginer une fin. Fukushima, c’est un présent continu. Voilà pourquoi, il n’y a pas de fin à mon livre.
Comment votre livre a -t-il été reçu ?
S. R. : J’ai été très contente évidemment de savoir que les lecteurs français ont apprécié ce livre, et je dois dire que j’ai ressenti un vrai soulagement quand j’ai reçu des messages de Français installés au Japon qui me disaient avoir ressenti la même chose ou s’être identifiés à ce livre. Ces commentaires m’ont aussi fait prendre conscience de ma situation. Ma situation représentait à la fois celles des Japonais vivant à l’extérieur de l’archipel, mais aussi celles des étrangers installés au Japon.
Propos recueillis par Gabriel Bernard

