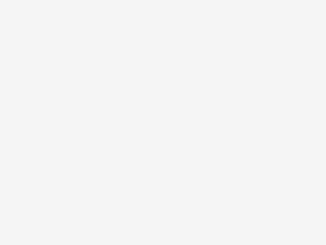Depuis deux ans et demi, 3 000 hommes travaillent dans des conditions éprouvantes. Certains ont accepté de témoigner.

Ne me prenez pas en photo. Je répondrai à vos questions, mais seulement à condition que vous ne divulguiez pas mon identité”. Le quadragénaire qui commence à parler se fait appeler Tôden George en référence à la société Tepco (Tôden en japonais), l’opérateur de la centrale de Fukushima Dai-ichi. Il a travaillé 3 mois dans la radio-protection des ouvriers d’ATOX, un sous-traitant de Tepco. Les “liquidateurs”, comme on appelle couramment les ouvriers de la centrale accidentée, se montrent souvent méfiants à l’égard des médias, par peur d’être démasqués et de perdre leur travail.
George a accepté d’être interviewé parce que leurs conditions de travail le révoltent profondément, et qu’il a décidé de les dénoncer coûte que coûte. “Au total, je suis irradié de 10 millisieverts. La dose limite annuelle pour tout ouvrier travaillant dans le nucléaire au Japon est 50 millisieverts”, soupire-t-il, l’air fatigué. Lorsqu’il travaillait à Fukushima, George partait de l’auberge dans laquelle l’employeur logeait ses ouvriers et montait dans une navette qui l’emmenait jusqu’au J-Village, un ancien stade transformé en centre d’accueil des ouvriers de Dai-ichi, à 20 km de la centrale.
Avant d’entrer dans la zone d’exclusion, tous les ouvriers doivent passer par le J-Village pour enfiler une première combinaison de protection. Puis ils montent dans une nouvelle navette qui les amène à la centrale. Le véhicule parcourt un terrain encore jonché de débris, trop radioactifs pour être déblayés. “Le temps de transport n’est pas compté dans le temps de travail, bien que vous soyez exposé aux radiations. La dose n’est même pas relevée”, raconte-t-il en grimaçant. “Il faut pourtant compter au moins 5 heures en tout pour le trajet aller-retour, le temps de mettre les combinaisons de protection, le débriefing avant d’aller sur le chantier et les tests quotidiens de contamination”.
Le calcul du temps de travail des liquidateurs est biaisé d’avance. Officiellement, George a travaillé 17 jours par mois, mais en réalité cela fait 22 jours, voire plus. Quant au salaire, il dépend du niveau de sous-traitance auquel l’ouvrier travaille. George, qui était employé au troisième niveau de la sous-traitance, n’était payé que 170 000 yens [1 324 euros] net par mois. Les combinaisons de protection, le carnet où sont relevées les doses d’irradiation et les examens médicaux étaient soustraits de sa paie. “Les entreprises sous-traitantes ont couramment recours à ce genre de pratiques qui leur permettent d’empocher l’argent”, dit-il tremblant, son carnet de relevé à la main. “Au bout d’un certain temps, ils ne prennent plus en charge les frais d’hébergement et des repas”. George, comme les autres liquidateurs que j’ai rencontrés par la suite, n’était même pas inscrit à l’assurance maladie publique, et n’avait accès à la mutuelle de son employeur qu’au bout de trois mois. En dehors des accidents de travail, les entreprises ne prennent rien en charge.

Quand on lui demande ce qui l’a fait le plus souffrir en travaillant à Fukushima, George répond d’un seul mot : “l’isolement”. En cas d’incident sur le site, les ouvriers de Dai-chi sont généralement les derniers à l’apprendre. La seule source d’information sur le site sont les écrans du bâtiment parasismique, où sont diffusées des vidéos de communication de Tepco. Les liquidateurs peuvent regarder la télévision une fois à l’auberge, où ils doivent partager leurs chambres à plusieurs. “Vous travaillez, déjeunez, retravaillez, rentrez, dormez en permanence avec les mêmes personnes”, poursuit-il. Bien que coupés du reste de la société, le manque d’intimité est une des choses les plus insupportables pour ces ouvriers.
Entre deux contrats d’intérimaire, George retourne à Tôkyô où il est né. C’est en voyant les Tokyoïtes vivre tranquillement qu’il sent monter sa colère. Si d’ordinaire ils mènent leurs vies comme si de rien n’était, ils ne se sentent pas concernés par ce qui se passe à Dai-ichi que lorsqu’ils apprennent qu’il y a eu des dysfonctionnements. Par exemple, en mars dernier, des rats ont provoqué une grave panne d’électricité, ce qui a paralysé une partie du système de refroidissement. “Alors ils se réveillent en sursaut : ‘Hou-là ! On n’est pas passé très loin !’ et s’inquiètent de leur sort. Mais nous, les liquidateurs, nous sommes irradiés à longueur de journée et c’est nous qui sommes en première ligne. Les gens de l’extérieur veulent toujours que les travaux avancent plus vite”. Pour que les travaux avancent plus vite, les ouvriers doivent prendre encore plus de risques. “Là-bas, on est 3 000 à lutter tous les jours dans des conditions inacceptables. Il est hors de question de faire grève, mais par moment, j’ai envie que la centrale explose une deuxième fois ! Pour que les autres, à l’extérieur, prennent conscience qu’on ne peut pas continuer comme ça”, confie-t-il.
Gobo, un trentenaire qui a travaillé 10 mois chez Sun-Seed, un sous-traitant d’ATOX, se sent lui aussi traîté comme de la chair à canon. Il se souvient : “Notre seule salle de repos se trouvait dans un préfabriqué, à côté du bâtiment parasismique de la centrale. Nous avions 2 ou 3 heures de pause imposée tous les jours, et nous étions censés manger et faire la sieste…Mais la radioactivité est de 4 000 cpm (curie par minute, soit 0,04 millisievert) ! Cela équivaut à la dose qu’on peut enregistrer à l’intérieur d’un réacteur fonctionnant normalement”.
Gobo était chargé de distribuer les équipements de protection aux ouvriers. Au début, tous les ouvriers recevaient une combinaison Tyvek, qui coûtait 1 400 yens [11 euros] pièce, un masque avec un filtre au charbon actif, des bottes et des casques neufs. Puis, à l’automne dernier, ATOX a décidé de les remplacer par des combinaisons à 700 yens [6 euros] pièce, en demandant la “coopération de chacun”. Au final, ils ont été obligés de se contenter d’un équipement à 300 yens (2,3 euros), à peine imperméable. Certains ouvriers ont fini par se mettre en colère. “C’est scandaleux !”, hurlaient-ils à Gobo. Mais ce dernier avait reçu l’ordre de ne distribuer les Tyvek qu’aux responsables d’ATOX et aux employés de Tepco. Lui-même n’y avait pas droit. La norme impose de jeter tous les équipements usagés après le passage dans la centrale. Mais ATOX recycle les bottes et les casques, en demandant aux intérimaires de les laver à l’eau et à l’alcool. “Il est indispensable d’améliorer les conditions de travail des ouvriers si l’on veut que le démantèlement avance correctement”, affirme Kirishima Shun, journaliste indépendant qui a lui-même été embauché comme intérimaire à Dai-ichi. Par “conditions de travail”, il entend également le contrôle des entrées du site et des réacteurs. Il a ainsi réussi, pendant ses pauses, à pénétrer seul dans les bâtiments des réacteurs accidentés 1, 3 et 4.

Kirishima s’est fait embaucher sans peine avec l’idée de pouvoir enquêter sur l’état de la centrale. Il a travaillé 10 mois sur le chantier à côté du réacteur numéro 4 et a pris des photos en cachette sans qu’aucun de ses supérieurs ne le suspecte. L’équipe de Kirishima remplaçait les canalisations dans lesquelles circulait l’eau contaminée. Les tuyaux d’abord utilisés, en chlorure de vinyle, étaient trop fragiles. La mauvaise herbe qui poussait dessous a fini par les percer, provoquant des fuites d’eau. Il a donc fallu les remplacer par des tuyaux plus solides, en polyéthylène. “N’importe quel ouvrier ayant déjà travaillé sur un chantier sait qu’il faut enlever la poussière avant d’emboîter des tuyaux. Mais mes coéquipiers n’avaient aucune expérience. Ils s’étaient retrouvés là parce qu’ils avaient perdu leur emploi de poissonnier ou de chauffeur de bus à cause de l’accident nucléaire”, explique-t-il. Résultat, la poussière accumulée dans les tuyaux a fini par boucher le circuit, l’eau s’écoulait mal et la température des réacteurs a dangereusement augmenté. Si 3 000 ouvriers sont nécessaires chaque jour pour assurer le démantèlement de la centrale de Fukushima, tous ont un plafond de dose considéré comme “recevable”. Celui-ci s’élève à 50 millisieverts/an, un niveau au-delà duquel il leur est légalement interdit de continuer de travailler dans une centrale nucléaire. La fin des travaux de Dai-ichi n’étant prévue que dans une quarantaine d’années, il est probable qu’un nombre de plus en plus élevé de personnes non formées à la filière vont devoir être ainsi recrutées.
“Actuellement, les ouvriers sont mal formés et maltraités. Le matériel est aussi de mauvaise qualité, en plus d’être souvent inapproprié aux radiations. Dans ces conditions, il est normal que les travaux finissent par être bâclés, et que les incidents se succèdent. Tout ça parce que Tepco essaie de réduire les coûts au maximum…”, assure Kirishima. L’industrie nucléaire n’est-elle pas une technologie de pointe ? A ces mots, le journaliste me regarde droit dans les yeux : “Si tu penses que pour les opérations menées à Dai-ichi, on a recours à des technologies très avancées, des robots et des machines magiques, tu te trompes complètement. Le site est géré par un système archaïque, c’est de la bricole. Même les machines fournies par Areva pour traiter l’eau contaminée n’ont pas cessé de tomber en panne. Mon collègue a failli être envoyé pour les réparer, une bouteille à oxygène sur le dos, dans un environnement d’un millisievert par minute”, lance-t-il, en haussant la voix. “Tu diras aux Français que c’est bien beau de vendre des machines, mais après, il faut assurer le service après-vente”.
Ajiwa Hiro