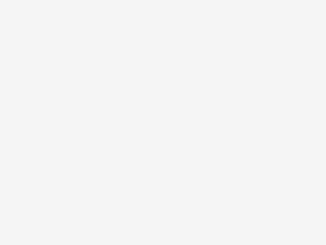Le 22 octobre prochain, à 20h30, Zoom Japon vous invite à découvrir la deuxième réalisation du jeune cinéaste.

Originaire d’Ôsaka, Yoshida Yasuhiro a fait ses études dans la prestigieuse université Dôshisha à Kyôto. Après avoir travaillé comme assistant du réalisateur Izutsu Kazuyuki et comme script, il réalise en 2007 son premier long métrage Kito, kito. Six ans plus tard, il tourne Tabidachi no shima-uta, Jûgo no haru [Le printemps de mes 15 ans] qui raconte l’histoire d’une adolescente vivant sur une petite île qu’elle va devoir quitter pour poursuivre ses études. Son troisième film, Enoshima Prism, est sorti au début de l’été au Japon. Yoshida Yasuhiro a 34 ans.
Gianni Simone
Quand vous étiez plus jeune, vous étiez plutôt amateur de manga que de cinéma.
Yoshida Yasuhiro : C’est vrai. Quand j’étais enfant, j’adorais les mangas et je rêvais de devenir mangaka. Je pensais à tout un tas d’histoires que je dessinais ensuite. Voilà pourquoi on peut dire aussi que mon intérêt pour le cinéma est une extension de mon amour pour l’expression visuelle.
Vos films ont une dimension documentaire…
Y. Y. : En effet, j’aime les réalisateurs qui font des films à la manière de documentaires comme Ken Loach ou Imamura Shôhei. Toutefois, celui qui m’a le plus influencé reste Izutsu Kazuyuki. J’ai travaillé sur ses trois derniers films et nous sommes très proches.

Comment vous est venue l’idée de réaliser ce film Tabidachi no shima-uta, Jûgo no haru [Le printemps de mes 15 ans] ?
Y. Y. : A vrai dire, c’est une idée de mon producteur. Il avait vu un documentaire sur un groupe de jeunes filles appartenant à un cercle de musique à Okinawa et m’a proposé d’en faire un film. Plusieurs scènes dans ce documentaire étaient très émouvantes et montraient l’amour entre les parents et les enfants sans qu’il y ait besoin de plus d’explications.
Votre premier long métrage Kito, kito abordait déjà le sujet de la famille.
Y. Y. : C’est un thème qui me parle sans que cela nécessite de ma part de gros efforts. En général, je ne cherche pas à faire des choses qui dépassent mes capacités. Il y a bien sûr d’autres sujets que je souhaiterais aborder dans le futur tout en restant dans les limites de ce que je comprends.
Cela dit, je suis quasi certain que vous n’étiez pas familier de Minami Daitô, cette petite île où se déroule l’histoire, et encore moins de sa culture.
Y. Y. : C’est la raison pour laquelle j’ai abordé le film en mixant fiction et documentaire. En d’autres termes, j’avais conscience tout au long du tournage d’être un “étranger” et ce que je ne voulais surtout pas faire, c’était de raconter des mensonges. Cela aurait été très gênant de ma part. Par ailleurs, les gens ont en général un lien fort avec le lieu où ils vivent. C’est encore plus vrai pour les habitants d’un endroit aussi petit et unique que Minami Daitô. Je me suis donc rendu à plusieurs reprises sur l’île avant d’entamer le tournage. Je me suis aussi documenté autant que je pouvais pour dresser un portrait aussi juste que possible de la vie sur cette île.
La relation tout en nuances entre la jeune héroïne et son père m’a rappelé celle que Hara Setsuko et Ryû Chishû entretenaient notamment dans le film Printemps tardif (Banshun) d’Ozu Yasujirô. Est-ce une coïncidence ?
Y. Y. : Je crains que oui (rires). Je dois dire que je ne suis pas un grand fan d’Ozu. En même temps, je respecte sa vision des choses et je pense que le cinéma japonais devrait regarder vers le passé. Les films d’aujourd’hui sont devenus de grosses machines, et ils ont perdu, au fil du temps, cette approche subtile de faire du cinéma, c’est-à-dire cet amour de produire avec soin des films comme pouvaient le faire Ozu et d’autres réalisateurs de la même époque glorieuse. Il n’y a pas de mystère si leurs films sont encore considérés dans le monde comme des chefs-d’œuvre.
Vos deux premiers films ont été tournés dans la préfecture de Toyama et sur cette petite île d’Okinawa. Est-ce un hasard ou êtes-vous attiré par la province et des régions peu attirantes ?
Y. Y. : C’est un hasard. Mais je dois reconnaître que tourner dans de tels endroits me permet d’avoir une intimité et une capacité de direction qu’il est difficile d’obtenir dans les grandes villes. A mes yeux, ce sont des lieux vraiment adaptés au genre d’histoires que je veux raconter. Evidemment, chaque projet est différent et tôt ou tard, je finirai par tourner à Tôkyô. L’essentiel est que chaque histoire s’inscrive dans un lieu particulier. Si on ne parvient pas à intégrer un peu de réalisme dans le récit, on est presque sûr d’échouer. Minami Daitô a ainsi un caractère bien à elle qui diffère de toutes les autres îles. Il n’y a pas de plage, juste la mer et une barrière de corail bien résistante.
Quelles sont les différences entre votre premier film et celui-ci ? Est-ce que votre approche du cinéma a évolué au cours des six années qui séparent vos deux œuvres ?
Y. Y. : Quand j’ai réalisé Kito, kito, je n’avais que 27 ans. J’avais déjà travaillé avec Izutsu Kazuyuki, mais diriger son propre film, c’est une tout autre affaire.
Comme l’équipe qui m’accompagnait était aussi inexpérimentée que moi, je ressentais beaucoup de pression car chacun attendait des instructions. En comparaison, Le Printemps de mes 15 ans a été beaucoup plus facile à faire. Une autre différence entre les deux films est liée au fait que dans Kito, kito, je me concentrais beaucoup sur les personnages principaux. C’est pour cela que l’histoire est parfois un peu dure. En revanche, dans Le Printemps de mes 15 ans, je voulais dresser un portrait de la vie sur l’île. J’ai donc passé beaucoup de temps avec la population locale pour expliquer pourquoi il était important qu’elle y participe. Sa présence contribue indéniablement à renforcer l’atmosphère du film.
Au niveau des acteurs, vous avez travaillé deux fois avec Ôtake Shinobu, une actrice expérimentée.
Y. Y. : J’avais beaucoup apprécié de travailler avec elle sur Kito, kito. C’est pour cette raison que je l’ai appelée pour Le Printemps de mes 15 ans et qui interprète le rôle de la mère de Yuna. Même si son temps à l’écran est relativement court, c’est un rôle très important. J’avais donc besoin d’une actrice douée, capable de présenter une palette d’émotion en un temps très court. D’une certaine façon, c’est la partie la plus difficile du film. En écrivant le scénario, je pensais déjà à elle.
Combien de temps vous a-t-il fallu pour mener à bien ce projet ?
Y. Y. : Le tournage a duré trois semaines, dont une semaine à Naha, sur l’île principale d’Okinawa. Mais au cours des 4 à 5 mois qui ont précédé la réalisation, je suis allé au moins deux fois par mois sur l’île.
Je suppose que ça a été dur pour tout le monde…
Y. Y. : Oui. Mais quand j’y repense aujourd’hui, je me dis que j’ai eu vraiment de la chance de participer à ce projet. J’ai pu me concentrer sur le film sans être distrait par d’autres choses. J’ai donc passé beaucoup de temps sur le film. De très tôt le matin à très tard le soir. Nous avons pu boucler le tournage en un peu plus de deux semaines avec un budget relativement faible. En revanche, la météo était très capricieuse. Il était impossible de prédire le temps qu’il ferait. En conséquence, nous devions changer notre plan de tournage en fonction de la météo. C’était vraiment quelque chose d’unique.
Six années séparent vos deux premiers films. Avez-vous l’impression qu’il est devenu plus difficile de faire des films ?
Y. Y. : Au contraire, je pense que c’est plus facile mais c’est beaucoup plus difficile de convaincre les gens d’aller les voir en salles. Comme vous le savez, aujourd’hui, on ne fait plus la différence entre voir un film à la télévision et le voir sur grand écran. On pense d’ailleurs que c’est plus confortable de le regarder chez soi. Ce qui m’irrite le plus aujourd’hui c’est d’entendre tous ces jeunes acteurs qui reconnaissent qu’ils vont rarement au cinéma. D’un côté, vous voulez travailler dans ce secteur et vous ne faites rien pour le soutenir. Il y a quelque chose qui cloche.
Propos recueillis par Gianni Simone
Critique
Le cinéma japonais nous réserve encore de bonnes surprises. Il y a celles que nous avons eu la chance de voir comme Shokuzai de Kurosawa Kiyoshi, celles que nous aurons la chance de voir comme Tel père, tel fils de Kore-Eda Hirokazu primé à Cannes (25 décembre) et celles qui ne parviennent pas à sortir de l’archipel, à moins d’un miracle. C’est le cas de Tabidachi no Shima Uta — Jugo no Haru [Le Printemps de mes 15 ans] signé du jeune cinéaste Yoshida Yoshiharu. Grâce à Zoom Japon, les amateurs du 7ème Art nippon pourront découvrir, le 22 octobre à 20h30, cette belle réalisation dans le cadre de Rendez-vous avec le Japon au cinéma La Pagode à Paris. Une projection unique et exceptionnelle qui permettra de vous familiariser avec le quotidien d’une petite île, Minami Daitô, située à 360 km de la principale île d’Okinawa. Peuplée de 1200 habitants, elle ne possède pas de lycée et les jeunes doivent la quitter pour poursuivre leurs études. Avec une grande sensibilité, Yoshida s’intéresse à la vie de Yuna (Miyoshi Ayaka), une collégienne appartenant au cercle de musique locale, qui devra, comme les autres avant elle, interpréter la chanson du départ Abayoi (Au revoir dans le dialecte local). Elle vit seule avec son père depuis que sa mère est partie sur l’île principale avec son frère et sa sœur aînés. Cette séparation et celle qui se prépare sont au cœur de ce long métrage parfaitement maîtrisé par Yoshida. Ce dernier parvient à donner une tonalité universelle à cette histoire tournée sur un petit bout de terre au milieu de l’océan. Le ton est juste. A aucun moment, les acteurs forcent l’émotion ou surjouent les scènes comme cela peut être le cas dans certains films. L’excellente Ôtake Shinobu, dans le rôle de la mère, en est le meilleur exemple. Quant à la jeune Miyoshi Ayaka, elle fait une belle démonstration de son talent. A ne pas manquer !
Odaira Namihei
Tabidachi no Shima Uta — Jugo no Haru, de Yoshida Yoshiharu (2013, 114 minutes). Le 22 octobre à 20h30 à la Pagode Tarif unique : 6€.