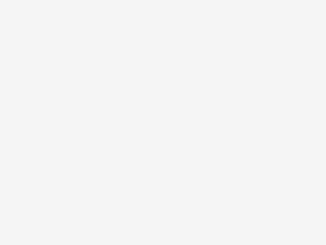Le Festival d’Angoulême vient de rendre hommage à l’auteur récompensé en 2012 par le premier prix Zoom Japon.

Rares sont les mangaka qui peuvent être associés à l’âge d’or du manga comme Kamimura Kazuo. Dans les années 1970, cet ancien élève des beaux-arts était synonyme de sérieux, de manga pour adultes et de femmes magnifiquement dessinées. Ses histoires étaient tellement populaires qu’à son apogée, il dessinait jusqu’à 4-500 pages par mois. Malheureusement, son activité frénétique et son style de vie ont été interrompus fin 1985 quand il a été hospitalisé pour une tumeur au pharynx. Il est décédé le 11 janvier 1986 à l’âge de 45 ans. Kamimura a laissé derrière lui une prodigieuse quantité de chef-d’œuvres qui mélangent romantisme, tension dramatique et érotisme. Plusieurs de ces œuvres ont été présentées au Festival d’Angoulême du 26 au 29 janvier. Nous avons rencontré sa fille Migiwa pour qu’elle nous parle de lui.
Il paraît que vous n’êtes pas une grande fan de manga ? C’est vrai ?
Kamimura Migiwa : Où avez-vous entendu cela (rires) ? Oui c’est vrai. Je n’ai jamais vraiment été attirée par la lecture. Surtout au moment de l’adolescence. Pas dessus tout, je n’aimais guère le style de vie de mon père. Il travaillait toujours à des heures impossibles, puis dépensait tout son argent à boire avec ses amis, revenant à la maison ivre pour dormir jusqu’au début d’après-midi. Je suppose que j’ai développé une forte aversion pour le monde du manga. En plus de cela, le genre gekiga (manga réaliste plutôt pour les adultes) très populaire dans les années 1970 avait un côté sordide avec des histoires désagréables remplies de sexe. Cela a contribué à me détacher du manga. A l’école, certains de mes camarades de classe se moquaient de moi, disant que mon père faisait des mangas. Bien sûr, je détestais cela et je pensais que mon père était responsable de cette situation.
Pourtant vous avez fini par travailler dans le manga puisque vous gérez le travail de votre père et la réédition de ses œuvres.
K. M. : Cela ne fait qu’une dizaine d’années que je m’en occupe. Avant, j’avais un autre travail et c’est ma mère qui s’en occupait. Mais compte tenu de son âge et du nombre croissant de demandes venant de l’étranger, j’ai décidé de la remplacer. Elle avait toujours détesté faire ça puisqu’elle n’avait jamais lu de manga, y compris ceux de mon père.
Etait-ce lié à leur contenu ?
K. M. : En partie oui. Parler de ses histoires ou même en lire étaient quelque chose de tabou à la maison. Ce n’est pas seulement qu’elle détestait le travail de mon père. Elle pensait avoir épousé un graphiste. Quand il est devenu mangaka, elle s’est sentie trahie. Elle a toujours été contrariée par ça et elle a par conséquent toujours réfusé de lire ses œuvres.
Appréciez-vous de vous occuper de l’héritage de votre père ?
K. M. : Au début, je m’en occupais sans grand enthousiasme jusqu’au jour où ma mère m’a expliqué que mon père s’inquiétait parfois de la façon dont son travail serait préservé après sa mort. De son vivant, j’avais l’impression qu’il ne s’en souciait guère, mais après en avoir discuté avec ma mère, j’ai compris qu’il voulait que son nom passe à la postérité. Cela m’a incité à tout faire pour que ses livres continuent à être distribués. Mais au Japon, ce n’est pas facile de réimprimer des ouvrages anciens. Seuls quelques éditeurs comme Mandarake se sont engagés à faire ce travail.
C’est devenu une sorte de mission pour vous ?
K. M. : On peut le dire, oui. Cela peut paraître étrange de dire ça, mais quand j’étais enfant, je sentais que mon père mourrait jeune. Il était pourtant toujours en forme. Il ne voyait jamais aucun médecin, mais je pensais que son style de vie excessif finirait par le tuer et qu’il serait de ma responsabilité de préserver son art. J’appartiens à un groupe dont les membres sont les enfants de mangaka décédés comme Tezuka Osamu ou Mizuki Shigeru (rires). On se rencontre deux fois par an pour discuter de la façon de conserver la masse énorme de papier que nos pères ont laissée derrière eux. Dans l’idéal, nous aimerions en faire don à un musée, mais pour le moment, nous conservons tout chez nous.